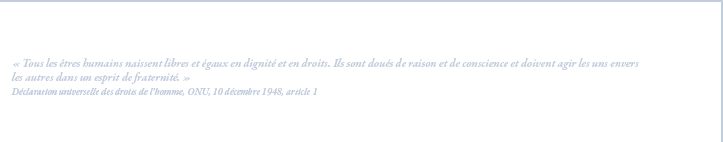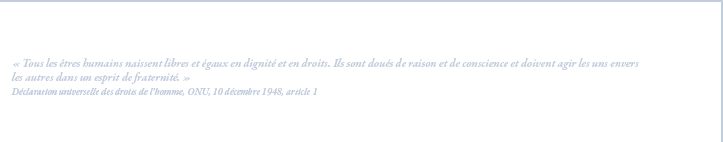Auprès des malades atteints de SLA et de leurs familles : une éthique de la réalité
Auprès des malades atteints de SLA et de leurs familles : une éthique de la réalité
Nadine Le Forestier
Praticien Hospitalier Neurologue, Centre SLA Ile-de-France, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Depuis une poignée d’années nous organisons au sein du centre SLA d’Ile-de-France, de façon encore irrégulière, des tables rondes de discussion sur les questions éthiques soulevées régulièrement lors de nos pratiques de soignants auprès des patients souffrant de SLA. Ces réunions sont ouvertes à tous, aux soignants du centre mais aussi des unités de réadaptation fonctionnelle, des services de moyen et long séjour, des unités mobiles de soins palliatifs ou services d’USP de l’Ile-de-France, aux philosophes, juristes, socio anthropologues, familles de patients et bénévoles du monde associatif.
L’étayage de la pensée sur l’étape qu’est l’annonce diagnostique, vérité immorale déclarée, montre que la responsabilité du soignant repose sur un paradoxe : respecter le patient et sa famille en leur annonçant l’inacceptable d’une dislocation existentielle. Il ne faut pas toutefois, dans l’ambition de parfaire cette étape essentielle du soin qu’est l’annonce, et en multipliant les réflexions et enquêtes, dériver vers une chosification de la procédure pour que cela se passe bien. Au mieux, cela se passe le moins mal possible mais le plus souvent de toute façon mal. L’annonce reste un double échec : celui du patient qui est acculé à l’écoute de l’inintelligible et celui du médecin qui se doit, dans un temps fini, de tenter de faire admettre au patient ce qu’il sait déjà, à savoir sa finitude et par quoi sa finitude est déclarée. Il est donné au patient et à sa famille à penser, à cet instant, la mémoire du futur. A la sortie du bureau de consultation, après l’annonce, le patient « se souvient ce qu’il va devenir ». Cette expérience sidérante sur le devenir obnubile le présent. Une pensée emmurée dans la mémorisation perdante du physique et du faire. Et pourtant, face à cet impensable qui aliène jusqu’à la liberté la plus infime d’être là sans quête, face à cette annonce axiomatique d’une « souffrance parce que la synthèse n’est plus possible », et contre la vague immanquable et envahissante de la culpabilité « qui est une fabrique de fausse monnaie » selon Philippe Sollers, les malades survivent. Ils ont du génie : que mobilisent-ils en eux, par quel recours et comment ?
Le médecin qui s’engage dans l’annonce s’efforce de porter cette lueur d’humanité qui permet de recréer l’ouverture dans la promesse d’un non abandon et d’un parcours jusqu’où le patient veut. Il y a interdépendance dans ce compagnonnage, dans cette relation de partage mettant en exergue une éthique du quotidien. Dans l’annonce du précaire et du provisoire il faut tout de même créer du robuste, du rationnel, du signifiant. « Cette annonce est impraticable » se plait à dire Emmanuel Hirsch considérant la pratique du moindre mal à cet instant comme mission impossible. Et pourtant la dynamique de cet instant, tout en marquant les limites d‘un savoir chétif et les frontières de ce qui peut être assuré et soutenu, doit permettre de faire comprendre aux patients et à leurs proches le solide du choix de dire et de révéler en s’exposant dans le soutien de la précarité. Les vulnérabilités multiples qui s’expriment dans l’engagement des soignants sont signes d’humanité plutôt qu’indécence d’oser exhiber un fragile espoir. Le prendre soin privilégie l’indispensable, s’ajustant à chacun pour qu’il y ait encore de la vie, du désir, du souffle d’existence. Arrimer le peu d’essentiel dans une culture de l’instant et réinstaller la simplicité, ce qui par essence restitue la place de l’autre.
Il n’est pas vain de dire qu’on fait la découverte de ce que l’on est dans les extrêmes, force qui défie l’évidence. Par la bienveillance, la justesse, le respect et la loyauté les soignants et bénévoles ont la conviction profonde d’une richesse : la présence d’une liberté insoupçonnée pour ces patients et familles éprouvées. Le silence permet de reconstituer la confiance et la relation, notamment dans les circonstances qui assurent l’intégrité de part et d’autre. Qu’est ce que l’on fait ensemble pour vivre la dignité ensemble ? Les malades savent que le médecin va mal, qu’il est en pleine culture du doute, de l’humilité dans le questionnement et que cela fragilise longuement. Les malades devinent que les bénévoles sont « passés par là » et sont à présent près d’eux, non pas pour témoigner mais pour épauler, écouter, accompagner et protéger.
Il ne peut y avoir de procédure dans « l’annonce et sa suite » car empêcher de douter est une culture de l’efficience destructrice. Parce qu’il est difficile d’être dur lorsque l’on est obligé de l’être dans un moment où compassion et soin (care et cure pour les anglo-saxons) s’enchevêtrent dans un savoir à révéler, le médecin s’expose à cet interstice fragile de la rencontre de sa subjectivité dans l’objectivité de l’instant, de la pudeur dans l’impudeur. Le moindre mal est donc d’éviter le pire, le mince espace résiste pour laisser s’engouffrer un souffle d’espérance.
C’est pourquoi la multiplicité des intervenants, médecins, soignants et bénévoles, aide à cette éthique du quotidien. Une éthique de la réalité.
Contact : [email protected]
 Réalités de l’annonce difficile : un observateur de la relation médecin/malade
Réalités de l’annonce difficile : un observateur de la relation médecin/malade
Bénédicte Chanal
Psychologue clinicienne, service de gastroentérologie/pancréatologie, Hôpital Beaujon, AP-HP
Situations à la fois extrêmes et quotidiennes
Je suis une observatrice tout à fait non neutre de la relation médecin/malade, psychologue dans un service de gastroentérologie pancréatologie, celui du Pr Philippe Ruszniewski. Je suis en charge d’accompagner psychologiquement les patients atteints de maladies graves, très graves et dont le pronostic est la plupart du temps létal à court ou moyen terme. Mon témoignage concerne donc des situations de rencontre entre un malade et son médecin où l’angoisse de mort est exacerbée. Ce sont donc des situations bien spécifiques mais je suis persuadée que tout médecin qui a pu travailler sa relation à ces malades graves, très graves, se retrouve plus armé pour toutes les rencontres à venir.
J’ai cette chance de me trouver à l’endroit même de l’expression de la souffrance, de la plainte de la personne malade. Par conséquent je me retrouve témoin de cette relation médecin/malade telle que le patient l’a vécue, l’a interprétée. Je dirai plutôt que je suis témoin des relations entre un médecin et un malade. De ma place, j’ai la possibilité d’observer l’évolution de ces relations tout au long de la prise en charge médicale. J’insiste sur ce point et j’y reviendrai, la relation que le médecin tisse avec son malade n’est pas un moment figé mais sans cesse en mouvement. Elle est faite d’investissements, de désinvestissements, de réinvestissements éventuellement.
Pour mieux appréhender la complexité de l’ajustement du médecin à son malade et inversement, je parlerais donc de ces situations à la fois extrêmes et pourtant quotidiennes pour certains services de soin où le médecin annonce une très mauvaise nouvelle au moment du diagnostic ou au moment de la découverte d’une récidive.
Toute personne gravement malade fait l’expérience de sa possible finitude. Expérience unique dans une vie qui vient bousculer les repères, les certitudes. L’être humain se trouve en situation de danger, de danger de mort pour laquelle il est incapable de trouver seul, des réponses à son problème.
J’ai tenté d’aborder la relation médecin/malade non pas du côté du traitement de l’information qu’il faut transmettre à un patient mais bien plus du côté de la nature du lien qui se créé dans une rencontre aussi extrême où l’information donnée vient faire émerger une immense détresse. Situation bien paradoxale pour un médecin que celle d’avoir à assumer cette contradiction où l’idéal du médecin bienveillant vient se heurter à la fabrication chez l’autre d’une immense souffrance.
Un état de détresse fondamental caractérise toute personne dont la vie est menacée. Quelques soient les mécanismes de défense psychique mis en place pour tenter de l’atténuer, l’étouffer, l’éviter, la contrôler, la maîtriser. C’est de cette détresse dont j’aimerai vous parler car c’est bien elle qui est au rendez-vous. D’ailleurs quand elle ne s’exprime pas, souvent le médecin la cherche. « Vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer ? » Il attend des manifestations émotionnelles tout simplement parce que la détresse signe la compréhension de la situation.
C’est bien parce que le médecin déclenche cette détresse fondamentale que la relation médecin/malade devient très complexe.
Besoin d’attachement
J’ai choisi de m’appuyer sur la très jolie théorie psychologique de « l’attachement » pour tenter de faire comprendre à quoi renvoie chez l’être humain cette détresse fondamentale, ce qu’elle attend comme réponse de l’Autre avec un grand A.
Je présente quelques éléments centraux de cette théorie pour ensuite tenter d’illustrer ce que nous pensons avoir compris par deux exemples tout récents tirés de ma clinique.
La théorie de l’attachement est créée par John Bowlby psychiatre psychanalyste Anglais des années 90. Elle est fortement inspirée par les observations de l’éthologie animale représentée alors par K. Lorenz et par Harlow.
Schématiquement Lorenz nous fait découvrir qu’il existe dans le monde animal un phénomène d’empreinte inné. Il va lier le petit à sa mère ou celui ou celle qui fait office de mère. Cette réaction se produit à un moment seuil de l’évolution du petit. Passé ce moment l’attachement n’aura pas lieu. Harlow, dans les années 70, s’intéresse à la relation du bébé singe à sa mère. Il nous montre que la réaction d’agrippement à la mère, réaction présente dès la naissance, est aussi vitale que de se nourrir. Lorsque le petit est privé de cet agrippement à sa mère, quand bien même il serait correctement nourri, il dépérit. L’agrippement est une réaction innée qui permet l’attachement à la mère et vice-versa.
Bowlby et d’autres psychanalystes plus récents nous expliquent que l’être humain est lui aussi équipé dès la naissance de compétences pour s’attacher à sa mère ex : la succion, l’agrippement ou l’accrochage à l’autre, les pleurs le sourire et l’orientation du regard. Le bébé s’attache à la personne qui prend soin de lui car il a besoin d’être rassuré, protégé. On retiendra qu’il s’agit d’un besoin primaire, vital. Il est tout simplement nécessaire, nécessaire à la survie.
Le besoin d’attachement est plus puissant pour l’homme que pour toute espèce animale de part sa néothénie c’est-à-dire sont état d’immaturité et donc de dépendance particulièrement longue.
Déjà, au début du 20e siècle, Henri Wallon philosophe homme politique et surtout grand psychologue affirmait que l’être humain naît « biologiquement social ». Il est biologiquement orienté vers l’autre.
Les psychanalystes nous montrent à leur tour que la pulsion d’attachement est inhérente à la nature humaine au même titre que les pulsions d’autoconservation. A ce titre elle permet la vie. Cette pulsion teintera les relations interpersonnelles que les individus seront amenés à établir au décours de toute leur vie.
Nous allons nous rapprocher de la situation qui nous intéresse me semble t-il grâce à cette citation du psychanalyste Didier Anzieu. Cette citation est tirée de son œuvre Le Moi-peau. Didier Anzieu nous dit :
« la pulsion d’attachement intervient chez les hommes, par la recherche d’un contact qui assure une double protection contre les dangers extérieurs et contre l’état psychique interne de détresse, et qui rend possible des échanges de signes dans une communication réciproque où chaque partenaire se sent reconnu par l’autre. » (Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995, p.52)
Annonces de la mauvaise nouvelle
J’ai choisi de faire partager deux échanges avec deux patients très différents. Ils racontent chacun à leur façon comment cette rencontre initiale de l’annonce d’une très mauvaise nouvelle vient réactiver la pulsion d’attachement. Ils nous font bien comprendre, je pense, comment le médecin dont la spécificité est de transmettre une information médicale qu’il maîtrise, se retrouve à chaque rencontre dans une situation nouvelle pour lui qui nécessite un fabuleux effort d’adaptation à l’autre.
Voici un petit morceau de l’histoire difficile de Mr R.
Je rencontre Mr R au début de son hospitalisation. Mr R est un homme de 60 ans agréable, posé, très intelligent et d’un abord très facile. Notre premier entretien porte sur tous les évènements qui se sont déroulés depuis seulement trois semaines, depuis les premiers symptômes douloureux. Il me raconte alors sa consultation d’annonce de diagnostic.
« Je sais qu’il (il étant le médecin bien sûr) m’a annoncé un cancer du pancréas mais je ne me souviens plus des mots qu’il a utilisé. Pourtant je lui ai posé énormément de questions, lui doit s’en souvenir. J’avais besoin de comprendre dans le moindre détail comment se développe cette tumeur, comment une chimiothérapie peut attaquer les cellules cancéreuses, comment elle peut tuer des cellules anormales et pas les bonnes etc. J’ai compris que je pouvais mourir de cette maladie, j’avais peur de mourir là sur le champs. J’ai eu le vertige, je me suis accroché à la chaise. Le médecin ne me quittait pas des yeux, je crois qu’il s’apercevait de mon malaise. Il est resté silencieux, j’ai pu remonter sur le ring. Notre échange a duré plus d’une heure. Je n’arrivais plus à le lâcher.
J’ai n’ai réussi à me lever pour partir que lorsqu’il m’a proposé de revenir le rencontrer pour reprendre la discussion si j’en éprouvais le besoin. C’est étonnant, je ne me souviens plus des mots, du contenu précis de la discussion et pourtant je sais qu’il a répondu dans le détail à toutes mes questions. Je sais seulement qu’il était attentif, qu’il prenait son temps, qu’il m’écoutait vraiment. C’était je crois ce qu’il y avait de plus important finalement, plus important que le contenu des réponses elles-mêmes. J’ai eu confiance d’emblée et pourtant à aucun moment il ne m’a garanti la guérison, je savais que j’allais en baver mais j’ai compris qu’il allait se jeter dans la bataille avec moi. Que j’allais quand même vivre sans savoir combien de temps encore. C’est une histoire folle. Il n’y a rien de rationnel là-dedans. »
Ce témoignage que je présente en premier est précieux pour moi. Précieux parce que j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cet homme. Il disposait d’une capacité exceptionnelle à décrire ses états intérieurs, cette capacité d’insight disent les psychologues.
Dans ce témoignage, il a réussi à illustrer mieux que quiconque les mouvements psychiques qui opèrent lors d’une annonce de diagnostic très sévère et comment l’attitude du médecin peut venir soutenir cette situation.
On voit comment la détresse du patient est vécue sur le mode du décrochement, le lien à la vie est sur l’instant même menacé de se rompre, le vertige vient mettre en scène dans le réel cette menace de mort. Le patient décrit un ensemble de réactions d’agrippement, réflexes pour ce qui est de s’accrocher dit-il à la chaise, mais aussi d’agrippement à l’autre, ici le médecin, qui parvient à s’ajuster par ses réponses. C’est bien pour maintenir le lien que le patient questionne encore et encore, ce flot de parole l’accroche à l’autre, l’accroche à la vie avec d’autant plus d’efficacité que le médecin répond systématiquement à toutes ses questions. Le regard du médecin qui pendant tout le temps du vertige ne faillira pas lui permet de se cramponner et de revenir. Enfin, et c’est peut-être le plus beau moment de cette histoire, le patient exprime la peur de « lâcher » le médecin au moment de la fin de l’entretien, manière toute projective d’exprimer la crainte primordiale d’être lâché. Peur de l’enfant en danger qui ne peut s’éloigner de sa mère. Le médecin est en place de pouvoir prolonger la vie. La fin de l’entretien marque la fin du portage, du soutien, de la réassurance peut-être le début de l’écroulement. Le médecin le comprend t-il ? Pas sûr, par contre il le sent, le perçoit.
Son invitation à revenir le rencontrer une deuxième fois va permettre symboliquement de maintenir ce lien. Ce besoin d’une deuxième fois, est bien perçu par certains médecins qui souvent proposent une deuxième rencontre.
Je crois beaucoup à la force symbolique de cette invitation à se revoir. Je ne suis d’ailleurs pas certaine que tous les patients invités à revenir reviennent réellement à cette autre consultation pour une reformulation des choses. Les médecins pourront peut être nous en dire quelque chose.
Relation d’emprise
Autre témoignage, celui de Mme B. une patiente « attachante mais difficile » me confie le médecin lorsqu’il me la présente.
Mme B âgée de 35 ans est atteinte d’une tumeur endocrine du pancréas. Elle fut opérée il y a un an. Les souvenirs de cette opération restent très traumatisants. Une année s’est écoulée et la vie a repris le dessus. Aujourd’hui le foie est atteint. Cet événement survient dans une période de vie affective particulièrement tumultueuse. Le médecin est très à l’écoute de sa vie affective de sa difficulté à investir tout type de traitement à un moment où sa vie professionnelle est en train de prendre un essor important. Mme B se dit très émue par l’attention toute particulière de ce médecin. Par sa grande gentillesse, sa grande disponibilité. Elle lui dira qu’aucun homme n’aura été à ce point attentif à elle dans sa vie ; qu’elle prend conscience au travers de cette rencontre de l’ingratitude de son compagnon et de son amant qui, dit-elle, ne s’intéressent qu’à son look. Notre patiente est à ce moment asymptomatique et a du mal à accepter cette récidive ainsi que l’éventualité d’un traitement. Pourtant elle s’accroche nous dit-elle à l’idée que seul cet homme (le médecin) pourra la sortir d’affaire. Elle accepte donc l’idée d’une chimiothérapie. Elle dira après avoir accepté : « Je crois que cet homme j’aurai pu le suivre partout. »
15 jours après cet entretien, Mme B doit rencontrer un autre médecin responsable du protocole qu’elle doit signer. Elle découvre à cette occasion qu’il y a de sérieux effets secondaires liés à ce traitement, et en particulier une probable chute des cheveux. Cette découverte dans l’après coup avec un autre médecin plus expéditif cette fois est vécu comme une trahison. Notre patiente développe une haine farouche à l’égard du premier médecin tant investi précédemment au point de partir dans un autre hôpital pour demander un autre avis, étant persuadée à ce stade qu’elle avait été trompée sur toute la ligne, et que peut-être elle ne développait pas de métastases au foie. Elle est revenue dans le service après avoir été conseillée et réorientée par d’autres professionnels.
Elle a pu s’expliquer avec le médecin et a compris qu’elle avait tellement mis en avant l’importance de son image corporelle, son refus d’accepter toute mutilation visible comme l’opération de l’année précédente que le médecin n’avait pas réussi ou pas osé aborder la problématique de la perte possible des cheveux.
Au final, après une négociation la chimiothérapie est abandonnée au profit d’une chimioembolisation.
Ce témoignage me paraît très intéressant car il montre ici aussi un lien d’attachement très puissant mais également très complexe entre la malade et son médecin.
Le lien qui s’établit ici avec le médecin interroge ou réinterroge cette femme sur ses modalités relationnelles antérieures, sur l’aménagement oedipien qu’elle avait trouvé.
La qualité relationnelle proposée par le médecin réintroduit une dimension maternelle/maternante c’est-à-dire du côté de la tendresse, de la sollicitude pour l’autre qui vient compléter, s’intégrer à la modalité relationnelle sur le versant de la séduction avec laquelle elle fonctionne habituellement dans son lien aux autres.
On comprend que l’écoute très empathique du médecin s’est transformée pour la patiente en relation d’emprise dans laquelle elle pouvait réparer en tout cas provisoirement une blessure narcissique fondamentale celle de son lien aux hommes de sa vie.
Cette relation médecin/malade où la pulsion d’attachement, d’agrippement s’est exprimée avec une telle force a empêché le médecin d’aller au bout de son travail habituel d’information médicale. Que s’est il passé du côté du médecin ? Je ne le sais pas exactement. Je crois comprendre pour avoir fait un bout de chemin avec la patiente qu’il a eu bien du mal à contenir, circonscrire cette réaction d’agrippement. L’alliance thérapeutique qu’il semble avoir obtenue est passée par la reconnaissance implicite ou explicite en tant qu’homme de la défaillance des hommes de cette femme. La question de la perte des cheveux lui a du coup paru un sujet beaucoup trop sensible. Il a probablement pressenti le danger de raviver la blessure narcissique et de compromettre cette alliance qu’il avait si difficilement obtenue.
Comment trouver le bon ajustement le bon accordage, cette « juste présence » nous dirait peut-être E. Hirsch pour à la fois être dans une écoute vraie et donner ainsi la possibilité au patient de s’accrocher dans le naufrage annoncé, tout en évitant les pièges du glissement de position qui empêche le médecin de garder à l’esprit le fils conducteur dans sa démarche habituelle d’annonce ?
Alliance thérapeutique
Je me suis donc attachée à tenter d’illustrer la relation médecin/malade sous le prisme de la ou les toutes premières rencontres. Celles de l’annonce d’un diagnostic à pronostic létal. Cette rencontre qui a la particularité sur fond de détresse de lier un malade à son médecin et vice- versa, est me semble t-il inaugurale de toute la prise en charge future.
La lecture que j’en ai faite aujourd’hui sous l’angle de la théorie de l’attachement, me donne envie de dire que cette première rencontre ressemble fortement à un équivalent de situation d’ « empreinte » au sens « Lorenzien » du terme si je peux me permettre, au sens de l’éthologie animale. Lorsque le médecin accepte de se constituer objet d’attachement pour l’autre, alors il déclenche des conduites d’agrippement psychique mais aussi des conduites de poursuites psychiques : Mr R ne veut plus « lâcher » son médecin, Mme B le suivrai n’importe où…
Mise à part que nous fonctionnons ici au niveau symbolique, ce qui nous distinguerait du monde animal, en tout cas nous sommes très proches des bébés canards qui a un moment T juste après la naissance poursuivent leur mère et exclusivement leur mère jusqu’à leur prise d’autonomie.
C’est sur le « pour suivre » que je voudrais insister.
J’observe tous les jours que l’alliance thérapeutique parfois si chèrement acquise pour les deux partenaires de cette première rencontre reste quelque chose de fragile si elle n’est pas entretenue.
Or, le fonctionnement de nos hôpitaux offre de plus en plus aujourd’hui des prises en charge éclatées au patient. Nos malades sont devenus des nomades du soin et doivent assumer des changements de référents médicaux très fréquemment. Changement de services, de spécialités médicales, changement de structures hospitalières, avec retour à la case départ et à nouveau un autre circuit…
Arrêtons-nous de ce point de vue à ce qui se passe ne serait ce qu’à l’intérieur d’un même service. Ici aussi les changements de référents peuvent être parfois tels que certains de nos malades perdent de vue sur de longs mois leur médecin initial. Les parcours thérapeutiques sont tellement difficiles, le doute est tellement souvent au rendez-vous que les patients ont besoin, même s’ils sont très bien soignés par d’autres, de revenir à la relation inaugurale. C’est en tout cas un besoin qui s’exprime de façon récurrente.
Alors certains diront que le discours est bien trop idéal au regard de la conjoncture. Je ne le crois pas du tout. Ce n’est pas uniquement de temps de présence dont le patient a besoin. S’il l’obtient tant mieux.
Non, nos malades ont pour la plupart bien intégré les difficultés liées justement à cette conjoncture. Ils ont besoin des signes qui tracent le lien même symboliquement. Beaucoup s’en contenteraient. La poignée de main dans le couloir et le sourire suffit souvent au patient à réactiver le lien d’attachement. Je crois que l’on peut faire mieux. Il nous faut travailler par exemple sur les relais de cette relation. On peut imaginer des systèmes de communication très simples qui permettraient au médecin de repérer en temps réel la présence de ses patients dans les salles. Ce qui lui permet de leur rendre de temps en temps visite.
J’ai pu constater également que lors de la première rencontre plus les médecins ont réussi à expliquer le cadre institutionnel de leur prise en charge, en insistant sur les relais médicaux et les limites de leur propre présence dans le futur, alors plus les malades acceptent naturellement d’être confiés à d’autres.
Voilà, je terminerai sur ces constats en disant que les médecins ont des initiatives personnelles qui montrent leur souci d’assurer de la continuité dans la relation mais souvent pour quelques patients. Il manque à mon sens un vrai travail de réflexion en groupe sur ce sujet pour permettre de mettre en place des conduites plus systématiques.
.
 CHRIGU : chronique d’une vie éclairée
CHRIGU : chronique d’une vie éclairée
Un film de Jan Gassmann
et Christian Ziörjen
Synopsis
Christian Ziörjen est un jeune homme de 20 ans comme les autres. Bien entouré par ses amis et ses parents, il étudie, il sort, il voyage et a plein de projets pour son avenir.
Son insouciance prend fin, du jour au lendemain, lorsqu'il apprend à l'aube de ses 24 ans qu'il est atteint d'un cancer.
Condamné, Christian mûrit prématurément. Il ne s'apitoiera jamais sur son sort, trouvera son énergie dans sa réflexion et découvrira une vie qu'il ne soupçonnait pas jusqu'alors.
Propos croisés
ll est difficile d‘écrire pour deux quand il y en a un qui n‘est plus là. CHRIGU : chronique d’une vie éclairée est le dernier film que j‘ai pu tourner avec mon meilleur ami Christian. Chrigu est mort.
Il y a deux ans, il m‘a parlé de son idée de tourner un film sur sa chimiothérapie. J’avais soutenu le projet, et j‘ai adoré le résultat. Son court-métrage A boulets contre le cancer est sale, brut et fait avec beaucoup d‘amour. Après sa rechute, un matin d‘automne, nous étions assis sur un banc en regardant le paysage. Christian m’a dit: « C‘est quand même étonnant : on se connaît depuis des années, et on a toujours eu envie de trouver un moment pour ne rien faire. Ne pas monter d’images, ne rien filmer, ne rien prévoir; juste rien faire – et c‘est seulement maintenant qu‘on y arrive ». Deux semaines plus tard, nous avons installé une caméra qui devait nous filmer en train de ne rien faire.
Jan : « Si tu veux que j‘arrête de te filmer, dis-le moi. Je ne veux pas t‘énerver avec ma caméra ! »
Chrigu : « Je préfère que tout ce qu‘il me reste à dire soit dit. Quand il sera temps pour moi de partir et que j‘aurai le sentiment que la mort peut me soulager, je veux que le film soit avancé à un point qui ne puisse pas m’empêcher de tout lâcher. »
Jan : « Je pense que le film va t’aider dans tout ça. »
Chrigu: « Allons-y ! On a encore plein de trucs à dire. (...)
.
 Lien au site de présentation du film documentaire
Lien au site de présentation du film documentaire
 Le souci d’autrui : une responsabilité éthique
Le souci d’autrui : une responsabilité éthique
Marie-Thérèse Graveleau
Professionnelle intervenant dans le champ du polyhandicap, étudiante en master Éthique, science, santé et société, Espace éthique/AP-HP, université Paris-Sud 11
Du rapport de soi à l’autre
Le souci d'autrui est il à entendre comme la préoccupation, l'intérêt que j'ai pour l'autre, le prochain, ou est-ce la préoccupation, le souci que je suscite chez l'autre en étant ce que je suis ? L'expression « le « souci d'autrui » intègre dans son énoncé un mouvement d'aller-retour qui interroge sans relâche ce lien essentiel, dynamique et continu du rapport de soi à l'autre, sans pouvoir définir ce qui est premier de soi ou de l'autre.
Évoquer autrui c'est présupposer un soi qui s'engage dans un travail continu d'élaboration personnelle et de rencontre d'autrui, rencontre à laquelle on ne peut se dérober sans courir le risque de mettre en péril sa propre humanité.
Le souci d'autrui peut être entendu comme le questionnement de cet autre qui me sollicite en tant que professionnel sur ma capacité à être dans l'engagement de soi, engagement qui me fait être auprès de lui. Le souci d'autrui peut être entendu aussi comme une dimension fondamentale de l'exercice professionnel au regard de la situation des personnes dites polyhandicapées en particulier et de leurs familles, exercice qui n'est pas premier dans la société mais qui est secondaire à l'existence des personnes concernées.
Mon propos est construit en lien avec mon expérience de direction de deux structures : la direction pendant cinq ans d'un établissement accueillant des enfants et des adolescents polyhandicapés et la direction du Centre de ressources multihandicap pendant douze ans.
Il m'a semblé à plusieurs moments de ma vie professionnelle que les personnes initiatrices du service où j'exerçais me guidaient dans la découverte de l'étendue de ce que j'ignorais et m'invitaient, dans cette fraction de chemin parcouru ensemble, à me mettre au travail sur un plan théorique toujours nourri d'abord de cette rencontre riche de la complexité du souci d'autrui.
Être en fonction de direction d'une structure créé dans un projet associatif à partir des besoins des personnes identifiées comme vulnérables et dépendantes et de ceux de leurs familles, structure inscrite dans un cadre législatif et financée par un budget contrôlé par l'État, c'est être dans la responsabilité d'un cadre qui doit assurer sa mission de « prise en charge et de prise en compte de ces personnes dans le respect de la dignité de chacun ».
Cependant penser les besoins et les désirs de l'autre, avoir pour mission l'élaboration d'un projet pour lui et avec lui d'une vie bonne et heureuse, et en garantir avec sa famille, avec une équipe de professionnels et différents partenaires la réalisation la plus favorable, c'est être dans une posture dont le coté vertigineux et illusoire est immense.
C'est prendre conscience que cette place occupée au nom du souci d'autrui n'a de sens que si elle s'enracine dans un non savoir de l'autre a priori et dans une écoute de l'invitation qu'il nous fait d'être à ses côtés pour lui permettre de vivre pleinement sa place de citoyen, place dont la société doit se porter garante.
C'est être vigilant au consentement qui vient valider nos propositions, consentement donné par une personne, enfant, adolescent ou adulte dont les moyens d'expression sont certes peu habituels, mais qui n'ont pas la fausse clarté de l'évidence, du même, ce qui nous ferait courir le risque d'anticipations faciles, hâtives et inexactes.
C'est faire l'expérience de la singularité et de l'étrangeté d'autrui qui nous demande de prendre la mesure du temps nécessaire à une réelle rencontre exigeant une mise au travail sans relâche dans un mouvement continuel de recherche où théorie et pratique s'interpellent et s'enrichissent. Ainsi le souci d'autrui est plus qu'un engagement une convocation qui est formulée par la personne directement concernée - initiatrice du service par sa vulnérabilité et par sa dépendance - à sa famille et aux différents acteurs qu'elle mobilise et plus particulièrement à ceux dont la responsabilité est l'encadrement d'équipe et le lien avec les différents interlocuteurs décideurs.
Ce souci d'autrui s'inscrit dans une relation où chacun de nous est interrogé dans nos fonctions, que ce soit celles de membres de la famille dont les places, à l'intérieur même de la famille, sont différentes et dont les liens ont une force et un attachement souvent inconnus, que ce soit celles de professionnels qui doivent trouver leur juste place à partir de leur capacité à construire une présence attentive, compétente. Ce souci d'autrui n'est pas la construction et le déroulement d'une suite de relations entre deux individus, c'est une appétence continue à vivre le risque de la relation à l'autre multiple et diversifiée, à l'image de la pluralité des relations sociales dont chacun est construit.
S'inscrire dans le souci d'autrui c'est « faire l'expérience de l'altérité comme constitutive de l'ipséité elle-même non pas soi même semblable à un autre mais soi même en tant qu'autre » (Paul Ricœur, Soi-même comme un autre). Ceci demande à chacun de se questionner sur sa capacité personnelle à être dans le souci de soi. Comment pouvoir penser le souci d'autrui dans notre relation à l'autre sans s'arrêter sur ce que l'on est, en tant qu'être en devenir, c'est à dire sur ce que sont nos désirs, nos aspirations, nos valeurs, nos difficultés ? Comment prendre la mesure de notre attachement à l'autre dont notre projet et d'en prendre soin, sans entrer dans un questionnement et une réflexion auxquels notre responsabilité de professionnel nous convoque sans relâche individuellement et collectivement ?
Reconnaître l’autre au cœur des pratiques professionnelles
Être professionnel, c'est être soi même dans une fonction, c'est aussi s'être construit dans une histoire familiale, dans une histoire personnelle faite de rencontres, dans une histoire professionnelle où théorie, pratique et questionnement ont toujours été étroitement liés.
C'est témoigner de la tension continue qui sous-tend le rapport à soi même ; le rapport de soi même à l'autre dans une relation individuelle avec l'enfant, l'adolescent, l'adulte initiateur du service, avec les membres de sa famille, avec le professionnel directement concerné ; le rapport de soi même aux autres groupes constitués, que ce soit l'équipe de professionnels de la structure, les partenaires hospitaliers, sociaux, les organismes de contrôles et les pouvoirs politiques.
Si le souci d'autrui est une convocation, un élan qui fait suite à l'appel de l'autre du fait de sa fragilité, de sa vulnérabilité pour imaginer et garantir la prise en compte de ses besoins, de ses désirs au nom de son bien, comment y répondre ? Comment lui assurer que je serai en mesure d'être à l'écoute de ce qu'il s'exprime, avec les moyens dont il dispose pour formuler sa demande ? Comment serai je en capacité de mesurer l'écart entre ce qui m'est demandé par la personne elle-même et sa famille, et ce que je lui propose ? Comment alors, à partir de cet écart, pourrai-je identifier ce qui est de mon impossibilité à répondre du fait de l'organisation, de l'ignorance ou de la frilosité des partenaires ? Ceci ne peut en aucun cas alors être résolu ou balayé par une non reconnaissance de la légitimité de la demande.
Ainsi, la temporalité des activités, l'organisation des différents temps rythmant la vie en collectivité, les demandes des familles quant au moments de rencontre avec leurs enfants dans les établissements ou de venues à domicile constituent des événements parmi d'autres qui viennent perturber le bon fonctionnement de l'établissement décrit dans le projet et rappelé dans le règlement intérieur. Cependant que de telles demandes puissent être exprimées témoigne de leur importance et de la nécessité de les accueillir comme premier élément d'une mise au travail pour construire un échange.
Pouvoir y répondre immédiatement ou en différer la satisfaction, ou encore ne pouvoir acquiescer à la demande ne peut contester en rien la réalité de cette demande et son bien fondé pour celui qui l'exprime. La nature de la réponse illustre la limite de l'organisation quant à la prise en compte de la spécificité individuelle et de l'expression du désir dans un fonctionnement collectif qui par ailleurs proclame la nécessité du projet individualisé au plus près des besoins de la personne concernée. Et si les raisons économiques ou organisationnelles évoquées étaient des leurres qui dispensent les acteurs décideurs d'une réelle mise au travail dans une responsabilité partagée ?
Se risquer à l’écoute de l’autre
Ce paradoxe convoque l'organisation sous la responsabilité de la direction à une mise au travail continue avec les personnes accueillies, avec leur familles, les associations gestionnaires, les pouvoirs administratifs et politiques pour accueillir ce qui met à mal, ce qui déroute, ce qui bouscule comme des invitations à créer des lieux d'échange, d'élaboration du quotidien. Ce travail permet alors la construction de propositions qui seront guidées par le respect et la reconnaissance du caractère inaliénable de cet autre au nom duquel le service est déployé.
Cette capacité d'écoute des personnes les plus vulnérables et les plus dépendantes ne peut exister que si chacun des professionnels s'inscrit dans le projet collectif en tant qu'acteur légitime, c'est à dire qu'il puisse mobiliser ses compétences et s'engager dans l'exigence du risque de l'écoute d'autrui. Cette écoute de l'autre demande une présence réelle entière dans un temps précis et avec une distance suffisamment bonne pour reconnaître la singularité de la demande et avancer une proposition qui permette à l'autre de l'accepter ou non en le signifiant par ses réactions plus ou moins élaborées.
Il s’agit d’un travail exigeant qui ne peut être mené par les professionnels que s'ils ne se malmènent pas les uns les autres et s'ils ont l'assurance d'une reconnaissance de la complexité de leur pratique. Ceci suppose que leur responsabilité soit sollicitée non pas tant sur le registre du permis ou de l'interdit mais dans un engagement éclairé vis à vis de l'autre, ce qui leur permet d'être dans une vrai disponibilité pour une rencontre toujours nouvelle au nom du souci d'autrui.
Cette dimension de travail continu d'élaboration de la pratique et d'apport de références théoriques n'est possible au quotidien que si l'ensemble de l'équipe de direction en est le moteur et le garant.
Comment alors s'inscrire dans ce quotidien complexe et difficile à une place de direction ? La mise en jeu de cette fonction, de cette responsabilité s'inscrit dans un rôle d'interface entre les différents partenaires, rôle dans lequel il est nécessaire de veiller à la lisibilité du cadre construit validé et dans lequel il convient de s'appuyer sur la dynamique du quotidien qui permet de reconnaître la personne accueillie dans son rôle d'initiateur de la dimension créatrice de la pratique des professionnels.
L'évolution des associations qui pour beaucoup sont à un tournant de leur histoire avec la préoccupation de la continuité de leur mission et éventuellement la relève dans leur présidence contribue à rendre parfois moins identifiables la dimension d'aventure et leur rôle fédérateur en interne. Ceci peut contribuer à rendre difficile pour certaines directions l'inscription de la pratique quotidienne dans un projet dynamique. Ces difficultés conjoncturelles si elles sont peu ou pas travaillées privent alors les acteurs de la co-construction d'un avenir de veille et de réflexion.
Enfin les instances politiques décisionnelles ont du mal à se saisir des propositions de recherches appliquées concernant en particulier l'éducation et le développement des capacités des personnes concernées par ces services, comme la nécessité de prendre en compte l'importance cette dimension de responsabilité qui traverse toute la pratique des différents acteurs. Or ceci n'est rien d'autre que le respect de la dignité de la personne, et cela correspond à sa responsabilité envers tout citoyen au regard de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Le souci d'autrui est une exigence, un fondement de cette humanité qui nous constitue, il n'est pas d'emblée inscrit dans le respect d'autrui et le souci de soi, il est une des composantes de notre lien à l'autre qui doit nous maintenir en vigilance continue.
Le souci d'autrui, dimension fondamentale dans l'exercice professionnel est avant tout un questionnement personnel sur notre propre capacité à être dans le souci de soi. Ainsi on peut considérer que la personne en grande vulnérabilité et dépendance par son existence mobilise un réseau relationnel qui peut s'étendre de la famille, aux amis et aux professionnels mais cela ne dit rien de la qualité de la mobilisation ni de la qualité de la place où elle est attendue. Cependant la place qui lui est assignée questionne assurément le souci de soi de celui qui l'a définie.
Le souci d'autrui est lié au « souci de soi qui ne s'inscrit pas dans un exercice de la solitude mais dans une véritable pratique sociale » (Michel Foucault, La culture de soi. Histoire de la sexualité III). Cette pratique sociale est l'affaire de chacun mais aussi de l'organisation en tant que collectif. L'engagement et la responsabilité de ses membres contribuent à garantir à chacun l'exercice du souci d'autrui au risque du souci de soi ou peut être l'inverse.
 Le souci d’autrui : témoigner notre sollicitude à l’enfant atteint de polyhandicap
Le souci d’autrui : témoigner notre sollicitude à l’enfant atteint de polyhandicap
Anne Dupuy-Vantroys
Chef de service auprès d'enfants polyhandicapés, doctorant, Département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11
Revenir à l’essentiel
Ce qui marque nécessairement notre relation avec la personne polyhandicapée est le souci d’autrui, c’est à dire cette préoccupation permanente à l’égard de cet autre, à la fois tellement autre, différent de nous-mêmes, mais qui aussi, si étrangement, est un autre nous-même, s’inscrivant dans la même humanité, et est un autre que nous-mêmes, dans son identité propre, sa singularité, qui en fait un être irremplacable. Et ce souci d’autrui nous oblige à rompre avec l’égoïsme naturel de tout homme, à accueillir cet autre, à le prendre en considération, à s’en préoccuper, à prendre soin de lui, c’est à dire à lui porter une attention particulière, à se mettre à sa disposition, à se dépasser pour lui. Ce souci de l’autre mène à la sollicitude, La sollicitude est empathie, inquiétude pour l’autre, patience, écoute et disponibilité, sans attente de retour. S’inquiéter de l’autre et pour l’autre, c’est ne pas se satisfaire de l’existant ou du moindre mal, mais rechercher toujours un mieux-être pour lui, la meilleure existence possible, être attentif et à l’écoute de ce qu’il souhaite, et à l’affût de tous les signes qu’il donne qui permettent de le comprendre et d’améliorer son sort. Cette inquiétude oblige à être en éveil, à être actif, dans une recherche de l’essentiel, et amène à donner à l’autre, et au souci de l’autre, toute la place et l’attention qui lui sont dûes.
Avoir le souci de l’autre, c’est le respecter dans ses désirs, dans ses choix, dans ses volontés ; c’est donc entendre et prendre en compte, ses besoins et ses désirs, ses aspirations, ses attentes et ses questions, ses joies et ses peines, ses plaintes et ses souffrances, ses sentiments, quelque difficile ou douloureuse que puisse être leur expression, et y compris l’inexprimable, l’indicible, ou ce qui ne se dit pas ; c’est saisir toute la portée de ses silences. C’est respecter, au delà de ce qu’il exprime, le secret de son intimité. C’est le laisser déterminer lui-même, autant que faire se peut, ce qu’est le bien pour lui, et rechercher avec lui les moyens d’y accéder et d’accéder à la meilleure existence possible. C’est le reconnaître et le respecter dans son altérité, à la fois semblable et différent, avec une personnalité, une façon d’être qui lui sont propres. C’est aussi le respecter en tant que personne, dans son identité, et dans son histoire, donc dans son passé comme dans son présent, et son avenir. C’est respecter sa dignité, respecter son autonomie, et sa capacité à décider, si ténue soit-elle, ses amitiés et ses inimitiés ; c’est respecter son individualité, ses droits et ses libertés individuelles. C’est l’accompagner chaque jour et prendre soin de lui.
Avoir le souci de l’autre, c’est aussi faire preuve de patience à l’égard de l’autre, de sa faiblesse et de ses difficultés. Faire preuve de patience, c’est sortir du temps, de la précipitation, de l’urgence ; c’est ne jamais se lasser de l’autre, le reconnaître et l’accepter tel qu’il est, sans irritation et sans impatience - car l’impatience naît souvent de l’incapacité à supporter le décalage, la différence, la distance, entre ce qu’est l’autre et ce que l’on souhaiterait qu’il soit, l’image que l’on s’en fait, ou que l’on s’en était fait – faire preuve de patience, c’est retourner à l’essentiel. Le temps de la patience est un temps suspendu, « de quantité quelconque, mais de qualité illimitée. La patience est le temps qui laisse advenir le temps de l’autre (...), et qui réalise une rencontre entre le temps et l’éternité » (Michel Geofroy). Avoir le souci d’autrui, c’est aussi s’engager, pour aujourd’hui mais aussi pour demain, car quel sens aurait un engagement pris, s’il ne l’était au-delà de l’ici et maintenant, au-delà du temps ?
Le moment éthique par excellence
Et ce souci de tous les instants vient prendre racine, s’élaborer, se construire, autour de la rencontre avec cet autrui, qui est découverte et prise en compte de sa vulnérabilité spécifique, qui appelle à la compassion, et nous rend responsable de lui.
Comme le rappelle Emmanuel Levinsa, la vulnérabilité est le propre de tout être humain. Elle en est une de ses caractéristiques et le définit. En ceci, elle appartient à la fois à la personne handicapée et à nous-mêmes, et si la vulnérabilité de celle-ci nous est perceptible, si nous la ressentons et nous sentons dans l’obligation d’y répondre, c’est qu’elle interpelle notre propre vulnérabilité, y trouve une résonance, qui nous permet d’entendre et d’accueillir cette fragilité. La vulnérabilité d’autrui se découvre, pour levinas, dans la rencontre avec son visage, non pas en tant que réalité corporelle, mais dans ce qu’il est une fenêtre ouverte sur l’infini de l’être ; ce que le visage me révèle ainsi, c’est la pure contingence d’autrui, dans sa faiblesse et dans sa mortalité, et donc dans sa pure humanité. Éthique et infini : « Il y a dans le visage une pauvreté essentielle (…). Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. » Difficile liberté. Essais sur le judaïsme : « Autrui est le seul être que l’on peut être tenté de tuer. Cette tentation du meurtre et cette impossibilité du meurtre constituent la vision même du visage. » Cette double approche de la rencontre avec le visage de l’autre, qui est à la fois tentation et interdit du meurtre, me semble apporter un autre éclairage et faire particulièrement résonance avec notre rencontre avec les personnes polyhandicapées : en effet, leur vulnérabilité, leur perte massive d’autonomie ou plutôt de capacité à faire seules et donc leur dépendance à l‘autre, la lourdeur de leur prise en charge, leurs malformations physiques, si ingrates parfois dans ce qu’elles donnent à voir, les difficultés d’échange et de partage, leur souffrance et celle qu’elle engendre chez leurs proches, peuvent être à la fois source de désir de meurtre (tuer celui ou celle par qui la souffrance arrive ne pourrait-il réussir à faire taire la souffrance née avec lui ou avec elle ?) ou, de façon moins radicale, de désir de rejet, de violence (à l’origine de nombre de maltraitances) ; mais cette vulnérabilité peut aussi et heureusement, à l’inverse, engendrer une profonde compassion et un désir de protection, le souci d’autrui, que viennent renforcer un regard, un sourire, un lien qui se tisse, si tênu soit-il, un échange autre que verbal, mais qui peut atteindre parfois la perfection de l’infini d’une rencontre (« lorsque les âmes se parlent »), un moment de bonheur partagé, si fragile ou fugitif soit-il, une force de vie que rien parfois ne semble pouvoir atteindre, malgré tous les aléas de leur pathologie. Ainsi la vulnérabilité de la personne polyhandicapée peut-elle susciter chez l’autre à la fois violence et compassion, haine et rejet et aussi souci de l’autre, ces deux approches pouvant être totalement contradictoires et perçues comme absolument incompatibles, ou, au contraire, intimement liées et traduire la difficulté et l’ambivalence de la rencontre avec cet autrui, dans son identité si particulière, dans son étrangeté mais aussi dans son humanité si semblable à la nôtre, et qui nous renvoie à notre propre humanité et à notre propre vulnérabilité.
Pour levinas, c’est de cette rencontre avec la vulnérabilité de l’autre qui nous affecte, avec son altérité et son humanité, qui nous sollicitent et nous interpellent, qui s’imposent à nous, que naît ce souci de l’autre, cette responsabilté pour l’autre, responsabilité incontournable, qui s’impose d’elle-même, à laquelle il ne pourrait être dérogé sans culpabilité, et qui n’attend pas de réciproque. « La responsabilité naît dans l’instant où l’autre m’affecte, et cette affectation me rend responsable malgré moi (…). La responsabilité pour autrui ne peut avoir commencé dans mon engagement, dans ma décision. La responsabilité où je me trouve vient d’en-deçà de ma liberté (…). Nul n’est bon volontairement (…). J’en suis responsable sans même avoir à prendre de responsabilité à son égard ; sa responsabilité m’incombe (…). Je suis responsable de lui sans en attendre la réciproque. » (Autrement qu’être ou au delà de l’essence) Cette responsabilité pour autrui est démesurée, infinie, et ne relève pas du domaine du choix ; elle comprend une forme de passivité : elle ne repose sur aucun engagement libre, mais s’impose au sujet auquel elle incombe comme une obsession, et à laquelle il ne peut se dérober. Cette responsabilité est une forme de vocation au sens fort : elle répond à un appel (vocare : appeler, en latin). Et « plus je réponds, plus je suis responsable ». Cette responsabilité, infinie, n’atteint donc jamais son terme. Catherine Chalier dans La souffrance d’autrui décrit ainsi le moment où naît ce souci d’autrui : « Ce moment de bouleversement, de saisissement, qui ne laisse même pas le temps d’en examiner les raisons, se donne précisément, et sans esquive possible, dans le face-à-face avec le visage d’autrui, visage qui par sa nudité et son essentielle indigence, par sa détresse toujours plus grande que la mienne et tout l’aléa de sa mortalité, en appelle à moi en tourmentant à jamais ma quiétude. En cet instant se lève et s’éveille en moi un autre souci que celui de la pulsation sereine de moi-même dans mon être, une autre crainte que celle qui borne mon horizon à moi-même, je me sais responsable du sort de l’autre, responsable au point de perdre devant lui toute innocence d’être. » Levinas associe cette notion de responsabilité à celle de « substitution » qui consiste, non à se mettre à la place de l’autre, mais « à s’associer à la faiblesse (la vulnérabilité) et à la finitude essentielle d’autrui ». La substitution, c’est sortir de l’égoïsme, être pour l’autre, tout mettre en oeuvre pour rendre sa vie meilleure, et aller jusqu’à se sacrifier pour autrui ; c’est le souci de l’autre pour l’autre, sans lequel le sujet perd son humanité. Pour Levinas, cette « responsabilité-pour-autrui » représente le moment éthique par excellence, le noyau éthique de la relation d’aide, qui se met en oeuvre au moment de la rencontre avec l’autre différent, au moment où l’autre est accueilli « en son étrangeté la plus extrême, où l’autre n’est véritablement rencontré qu’à partir d’un fonds d’humanité – un fonds qui n’est jamais normé une fois pour toutes et dont il faut explorer les possibilités à l’infini ». (Raphaël Célis : Le schème de la disponibilité chez Paul Ricoeur).
Devoir de non abandon
Pour d’autres auteurs, le souci d’autrui vient se fonder sur le sens du devoir, qui peut être instinctif et spontané et s’imposer à nous de façon naturelle, ou être le fruit de préceptes moraux déterminés culturellement et socialement. La notion de devoir fait référence à la notion d’obligation que chacun s’impose à lui-même, obligation qui est donc une autodétermination de la volonté ; ce sont la conscience et la raison qui définissent alors le sens du devoir et enjoignent de le respecter. Être obligé, c’est être lié à soi-même, à ses propres engagements, fruit de notre volonté raisonnable. Mais la notion de devoir fait aussi référence à la notion de contrainte, qui s’impose à la personne et s’exerce sur elle indépendamment de sa volonté. La contrainte fait notamment référence à la norme sociale, issue de l’opinion, des habitudes ou des moeurs, de la culture ou du contexte socio-culturel, le plus souvent acceptée et intériorisée car elle fait partie intégrante du lien social et de l’intégration dans la communauté. Ainsi le devoir d’aide et d’assistance, le « devoir de non-abandon » s’impose, à la plupart d’entre nous, socialement et moralement depuis l’enfance, et y déroger serait risquer d’être montré du doigt, critiqué et mis à l’écart, voire rejeté par tout ou partie de la société. Cette notion du devoir d’assistance renvoie notamment à la pensée et à la morale chrétiennes, fondement de notre morale sociétale, et à l’origine d’un certain nombre de préceptes directifs et prescriptifs ou, à l’inverse, restrictifs. Le devoir d’amour à l’égard du prochain, et donc de souci de l’autre et de solidarité à son égard, est un des devoirs les plus importants de la religion chrétienne, puisqu’il est le deuxième commandement du décalogue, juste après le devoir d’amour de Dieu. Cet « amour du prochain » que le christianisme exalte est un amour consacré à autrui, mais autrui considéré dans sa qualité fondamentale d’homme et de prochain ; c’est un sentiment sans attente de réciprocité et, d’une certaine façon, indépendant de ce qu’est l’aimé, de ses actes et de ses attitudes ou de sa valeur morale ; c’est le désir de faire le bien de l’autre, ou de celui qui est dans le besoin, et la bienveillance à son égard ; c’est le don et l’oubli de soi, pour l’autre. Ce commandement est à l’origine du “devoir de compassion”, de “charité chrétienne”, à l’égard du plus faible et du plus vulnérable. L’homme ne peut déroger à son devoir, ni en pensées, ni en parole, ni par action, ni par omission, et la transgression est un facteur important de culpabilité, puisqu’il n’existe qu’une alternative : le bien ou le mal, et donc ce qui n’est pas bien est mal. A l’inverse, l’exécution de son devoir apporte à l’homme grâce et mérite ; le devoir de chacun est d’accepter les épreuves, chacun ayant à « porter sa croix », mais disposant pour ce faire des grâces nécessaires pour le secourir sur ce difficile chemin. Le souci de l’autre est donc un devoir auquel nul ne saurait déroger, mais aussi auquel nul ne saurait vouloir déroger, face à l’indigence et au dénuement d’autrui, et à fortiori de la personne polyhandicapée, face à sa vulnérabilité.
Cette vulnérabilité qui nous interpelle et nous affecte, jusqu’à ne plus vous laisser aucun répit à vous parents dans ce souci constant de l‘autre, est en même temps appel à l’aide, appel à la bienfaisance et à l’assistance, appel à la sollicitude et à la compassion. La compassion prend en compte cette situation de détresse et/ou de dépendance de l’autre, sa souffrance, son innocence et l’injustice de son sort. Pour Jean-Jacques Rousseau, la compassion est « un sentiment naturel (…) qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir : c’est elle qui dans l’état de nature, tient lieu de lois, de moeurs et de vertus, avec cet avantage que nul n’est tenté de désobéir à sa douce voix » ; c’est une émotion altruiste qui porte vers autrui, et amène ceux qui l’éprouvent à tenter de soulager cette peine, de la rendre moins lourde pour celui qui en est victime ; c’est cette émotion qui nous pousse les uns et les autres vers le souci d’autrui, vers une empathie, une écoute, une compréhension, un regard particuliers à l’égard des personnes polyhandicapées, qu’elles soient vos enfants ou les personnes que nous accompagnons, professionnellement ou bénévolement.
Mais comment imaginer que cette souffrance des personnes polyhandicapées ne soit pas aussi la nôtre, et a fortiori celle des parents si souvent submergés par un océan de douleur, face à la différence de leur enfant, à leur impuissance devant celle-ci, devant leur désir fou et inextingible de réparer l’irréparable, et de le réparer, si grand soit leur respect de ce qu’il est, de son humanité et de sa dignité, et quelle que soit leur acceptation de ce handicap ; eux qui sont parfois submergés par le découragement, par cet envahissement de leur vie par le polyhandicap de leur enfant, qui les empêche de mener une vie qui leur soit propre et ne soit pas réduite à l’accompagnement de cet enfant dépendant, dont le handicap les a rendu dépendant de lui et de son besoin d’aide permanent, les privant de leur autonomie, voire de leur liberté ? Comment imaginer que cette compassion qui est la leur et qui les amène à un souci d’autrui, permanent, obsédant, sans limites ni dans le temps, ni dans les actes, allant jusqu’au don de soi, voire jusqu’au sacrifice, subi, consenti ou choisi, puisse se mettre en oeuvre et durer, sans aide et sans compassion, sans solidarité et sans partage de leur souci à l’égard de l‘enfant handicapé, mais aussi sans souci d’autrui à leur égard ?
Être soucieux de l’enfant polyhandicapé
Car, au quotidien, avoir le souci d’autrui, de l‘enfant polyhandicapé, petit ou grand mais toujours dépendant de des parents, s’il n’est pas accueilli en internat, oblige à une disponibilité de chaque instant, de jour comme de nuit, à la fois pour l’aider et pour le protéger contre ce qui pourrait le mettre en danger, et y compris contre lui-même. C’est ne plus pouvoir s’endormir sans souci, paisiblement, sereinement, s’il y a le moindre risque sur le plan médical et/ou comportemental, en raison de l’angoisse de ce que sera la nuit, et rester sans cesse vigilant ; c’est être réveillé parfois plusieurs fois par nuit et perdre tout rythme biologique cohérent. C’est l’aider à la toilette, au lever, au coucher, et, par là même, le porter ou le soutenir bien souvent, ce qui représente une lourde charge, physique et psychique, sans l’aide, le plus souvent, ou de façon parcimonieuse ou incomplète, de matériel ou d’une installation appropriés. C’est passer parfois beaucoup de temps à l’accompagnement des repas, qui demandent d’autant plus de temps, de disponibilité, d’énergie, qu’inversement ils font l’objet d’un désintérêt et deviennent alors une nécessité vitale, pour la personne handicapée. C’est aussi accomplir un certain nombre de tâches jusqu’aux plus ingrates tels que les changes et les toilettes, changes qui s’accompagnent aussi, bien souvent, du nettoyage des vêtements et/ou de la literie souillée. C’est aussi devoir concilier l’ensemble de ces tâches et de cet accompagnement avec d’autres contraintes à la fois personnelles (famille, enfants, état de santé, horaires de travail - quand vous avez pu continuer à travailler - et difficultés d’aménager ceux-ci afin de faire face aux responsabilités familiales, risque d’absentéisme souvent toléré dans un premier temps, puis difficilement accepté lorsqu’il se répète, voire s’accentue). C’est se battre en permanence pour son enfant, quel que soit son âge, pour qu’il ait une place au sein de la société, une place en établissement, pour le respect de ses droits ; c’est lutter pied à pied pour qu’il ne soit pas sacrifié sur l’autel de l’indifférence ou de la finance (du coût de sa prise en charge), et le souci d’autrui s’accompagne alors de révolte et de colère, puisqu’il ne peut s’abandonner à la résignation.
Avoir le souci d’autrui, c’est aussi faire passer l’intérêt de l’autre avant le sien, et se trouver ainsi souvent dans l’impossibilité de pouvoir à la fois s’occuper de l’autre et de soi-même, de pouvoir disposer de soi-même et de son temps librement, “ne plus avoir une minute à soi” ; c’est souvent avoir l’impression d’être dévoré, phagocyté par l’autre qui prend toute la place, c’est s’oublier jusqu’à avoir le sentiment de ne plus exister, de ne plus exister que par l’autre, pour l’autre, à travers l’autre ; c’est appartenir à l’autre, et donc ne plus s’appartenir à soi-même ; avoir le souci de l’autre, ce peut être mourir à soi-même et perdre jusqu’à son âme. C’est être mis en dépendance par la dépendance de l’autre, de la personne handicapée ; ce peut être être confronté à la violence de l’autre, se faire taper, mais aussi griffer ou mordre, lorsqu’il s’agit d’un enfant polyhandicapé qui souffre et n’a pas d’autre moyen pour s’exprimer et/ou exprimer sa souffrance et son désarroi ; c’est aussi, avec un tel enfant, l’entendre pleurer, crier, voire hurler, parfois des heures durant, et culpabiliser de ne pouvoir apaiser sa douleur, tout en s’efforçant de ne pas perdre patience. Avoir le souci d’autrui, c’est donc parfois aller jusqu’au bout du bout, et même au delà, de ce qu’une personne peut supporter ou endurer, jusqu’à l’abnégation, survivre sans être sûr de savoir pourquoi, et à défaut de savoir comment, c’est aller jusqu’à dépasser ses propres limites jusqu’aux tréfonds de l’insoupçonnable. C’est alors être dans la nécessité permanente de se faire violence pour ne pas répondre par la violence à la violence de l’autre, à une situation qui fait constamment violence. Avoir le souci d’une personne polyhandicapée, c’est aussi, quelquefois, vivre avec la mort qui rode, qui parfois même vient s’asseoir à votre table ou au chevet de celui qui souffre, jusqu’à devenir étrangement familière, et ne plus savoir si on la redoute et voudrait l’éloigner, ou si l’on attend sa venue avec impatience jusqu’à la souhaiter, à la solliciter, même si c’est avec douleur et culpabilité. (C’est aussi parfois aller au delà du seuil de la douleur, être dépassé par l’intolérable, être envahi par des envies de meurtre, ou d’euthanasie, de suicide aussi, pour soulager et mettre fin à la souffrance de l’autre, à la sienne, mais surtout pour mettre fin à une situation sans issue où chacun se perd à soi-même).
Si le souci d’autrui, de la personne polyhandicapée, s’inscrit « naturellement » dans le cadre de la solidarité familiale qui remonte à la nuit des temps, où les rôles de chacun sont clairement définis et où les parents s’occupent et prennent en charge leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci prennent leur indépendance, lorsque ces enfants ne deviendront jamais indépendants et capables de se prendre en charge dans la vie quotidienne, puis de se suffire à eux-mêmes, ce souci d’autrui peut-il continuer à être leur apanage ? Certes de nombreux professionnels, dans le cadre de l’accueil en établissement notamment, en externat ou en internat, en « ambulatoire » ou à domicile, des bénévoles également, partagent ce souci d’autrui , comme le font aussi souvent les autres membres de la famille, et viennent accompagner les parents, voire se suppléer à eux dans la prise en charge du quotidien et des tâches matérielles, leur permettant ainsi de redevenir les parents de leur enfant, d’être davantage dans le « prendre soin » et l’accompagnement, plutôt que dans le soin et la prise en charge. La difficulté d’être parent d’une personne polyhandicapée, outre les contraintes matérielles, temporelles, la mise en dépendance par la dépendance de l’autre, et la violation bien souvent de sa liberté de choix, ne vient-elle pas, au moins en partie, de cette confusion des rôles ? Comment être à la fois dans le soin et dans le prendre soin, dans une relation de dépendance réciproque et dans un corps à corps incongru, voire obscène, d’une part, et en même temps dans une relation affective d’échange et de partage ?
Le souci d’autrui ne peut relever de la seule solidarité familiale, qui ne peut tout assumer, et ne devrait être que complémentaire de la solidarité publique et collective : en effet, si la science et la médecine ont tant progressé, prolongeant ou sauvegardant la vie, ce ne sont pas les familles qui ont fait ce choix, mais bien la société ; n’est-ce donc pas aussi à la société d’assumer les choix, dont elle est responsable, dans la totalité de leurs conséquences ? Comme me l’écrivait Martine Laurent parlant des parents de personnes polyhandicapées (voir dans la rubrique Témoignages : « Le polyhandicap nous oblige, nous parents, à devenir des conquérants », « rien ne justifie que nous portions le poids de cette incohérence qui consiste à sauvegarder la vie de nos enfants, puis à les abandonner sur le bord de la route », rien ne justifie ce « dévouement infini et sans bornes » qui confine au « sacrifice ». Le souci d’autrui ne peut être l’apanage de certains, « désignés » par le sort, et à qui il s’est imposé comme une nécessité, que celle-ci ait été subie ou choisie, mais appartient à tous. N’avons-nous pas à votre égard une responsabilité, un devoir de solidarité compassionnelle ? Qu’en est-il du droit des proches (des parents, des frères et sœurs, des familles) à disposer d’eux-mêmes, à exister aussi pour eux-mêmes sans culpabilité, sans peur du regard de la société et du jugement d’autrui. Les parents, les familles ont besoin de pouvoir passer le relais, ou simplement de partager ce souci, mais aussi que ce souci d’autrui se manifeste également à leur égard, car comme le dit Jacqueline Lagrée, « la position du proche (…) dans une relation au jour le jour (…) est une position éthique … et difficile à tenir ».
Certes, la société se mobilise peu à peu autour de la « cause » de la personne handicapée ; encore faut-il que cet intérêt nouveau ne s’exprime pas en termes de coût de prise en charge, de « financement du risque » ou de « compensation », mais permette que la personne handicapée soit prise en compte pour elle-même, dans une relation éthique et un authentique souci d’autrui. Car le souci d’autrui, c’est d’abord et avant tout, sortir de l’indifférence et de la quiétude et se mobiliser, se battre contre cette indifférence et contre l’ignorance.
Références
• Michel GEOFFROY, « Prendre soin », article issu de La patience et l’inquiétude, Pour fonder une éthique du soin, Paris, Romillat, coll. Espace éthique & politique. Institut Hannah Arendt, 2004.
• Jacqueline LAGRÉE, « Le proche ou le tiers médiateur », article du 3/09/2004, sur Internet, d’après Le médecin, le malade et le philosophe, Bayard, Paris, 2002.
• Auprès de la personne handicapée, Elisabeth Zucman, Paris, Vuibert, 2007.
 haut de page
haut de page