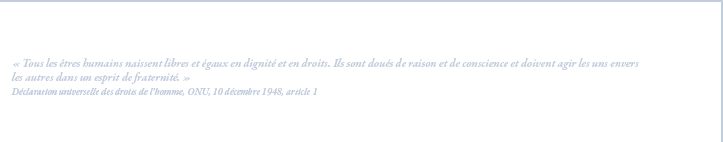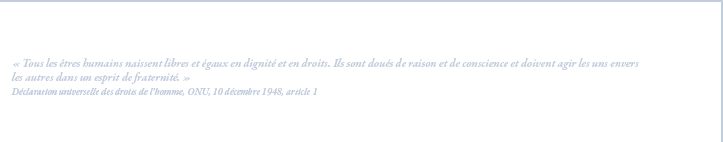Pourquoi « plus digne la vie » ?
Pourquoi « plus digne la vie » ?
Damien Le Guay
Philosophe, critique littéraire, auteur (entre autre) de Qu’avons-nous perdus en perdant la mort ? (Cerf, 2003), membre du Conseil exécutif de Plus digne la vie
Personne n’a le monopole de la dignité. Certaines personnes, sans vergogne, s’en emparent pour en faire une arme de combat. Toutes les occasions sont alors bonnes pour faire avancer « La » Cause, la leur, meilleure que toutes les autres. C’est ainsi que, portés par des médias complaisants, des « affaires », comme celle de Vincent Humbert ou de Chantal Sébire, sortent régulièrement. Elles mettent en avant des situations, toujours dramatiques et toujours tronquées, qui laissent à penser que « donner la mort » serait la seule solution, « l’ultime liberté », le dernier progrès. Il y aurait, comme ne cesse de le dire François de Closets, un complot « des mandarins et des cardinaux contre le peuple ». Cette élite, gangrenée de corporatisme et infusée de certitudes religieuses, laisserait souffrir les personnes en fin de vie et refuserait les « progrès » qui s’imposent un peu partout en Europe.
Cette vison des choses est solidement ancrée dans l’air du temps médiatique. Rien, d’une certaine façon ne semble pouvoir la changer. Alors, quand des commissions parlementaires se mettent en place pour écouter les uns et les autres, pour aller examiner à l’étranger la portée réelle des « progrès » en question, pour prendre du recul et faire la part des choses, quand les députés, après un énorme travail, se mettent d’accord à l’unanimité sur une loi, dite « loi Leonetti », qu’ils examinent à nouveau, le débat médiatique, pour autant, ne semble pas avoir évolué d’un iota. Dans une sorte de surdité, il revient toujours le même « conforté » par des vagues répétées et bien orchestrées d’affaires dramatiques montées en épingle et gorgée d’émotions comminatoires.
Allons-nous enfin prendre en considération les situations réelles, les acteurs réels, les cas réels pour mieux sortir des faux débats et de quelques situations trop simples pour être vraies ? Telle est la question. Question de démocratie et donc de modestie aurait dit Albert Camus.
Et si la dignité était partagée ? Partagée, nombreuse et plurielle. Et si la dignité était surtout pratiquée, de mille et une manière, par des milliers de soignants, d’aides, d’accompagnants, de médecins, de bénévoles et d’infirmières qui, jour après jour, loin de la certitude de certains ou de la paresse des médias, travaillent à soulager la douleur, à apaiser les souffrances, à prendre en charge les petites et grandes misères humaines ? De quelles misères parlons-nous ? Celles du handicap, de la mort prochaine, des maladies lourdes, des gens abandonnés au point de n’intéresser plus grand monde, des exclus, des sans-issues et des sans-voix. Ce travail là, ces gens là, ces pratiques là sont invisibles pour le reste de la société. Ces milliers de gens « du terrain » n’ont pas voie au chapitre des médias, restent ignorés du plus grand nombre. Sur les tréteaux cathodiques, les autoproclamés détenteurs de « La » dignité lancent des anathèmes contre les uns, morigènent les autres, tandis que dans les coulisses de la société, des milliers de personnes agissent, avec leurs moyens pour redonner confiance et dignité, vie et assurance à ceux qui se sentent exclu de la vie sans pour autant se résoudre à se croire en trop. Tout est là : ont-ils tort de se croire encore dignes de vivre ? Devraient-ils se résigner, d’eux-mêmes, à disparaître corps et biens ?
Cette immense et invisible société civile de la dignité, une dignité a reconquérir et à promouvoir, doit être entendue, vue, reconnue. Il le faut. Non pour relancer de furieux débats, mais pour prendre en considération la complexité sans fin des situations, pour profiter des moultitudes d’expériences accumulées, pour quitter le noir et le blanc des certitudes, mais surtout pour entendre avant tout les courageux acteurs de la dignité et d’une vie toujours à reconquérir. La vie est toujours « plus » qu’elle-même. La dignité est toujours « plus » qu’elle-même.
Nombreux sont ceux qui partagent cette lutte au jour le jour pour redonner vie à un regard, espoir à une parole, confiance à un geste. Là demeurent des gisements infinis de dignité qu’il faut avoir l’humilité de regarder, d’écouter, de prendre en considération. Individuellement ou collectivement, aurons-nous, nous tous, ce courage et cette lucidité ? Tel est le pari qu’il nous faut faire.
 haut de page
haut de page
 Fin de vie : mobiliser l’éthique
Fin de vie : mobiliser l’éthique
Emmanuel Hirsch
Professeur des universités, Directeur de l'Espace éthique Assistance publique-Hôpitaux de Paris
En quelques semaines deux propositions de loi se proposent de revoir les principes édictés dans la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité (enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009), la proposition de loi visant à mieux prendre en compte les demandes des malades en fin de vie exprimant une volonté de mourir (enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009). Une discussion de ces textes est prévue le 19 novembre.
Il y a un an, le 4 décembre 2008 était rendu public le rapport d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Le temps des vaines controverses pouvait, semble-t-il, prendre fin. La consultation menée dans la plus grande transparence et avec le souci de permettre à chacun d’exprimer ses positions, nous engageait désormais à mettre en œuvre la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, à en transposer les principes dans les pratiques du soin et à dégager les moyens indispensables à une approche enfin digne des réalités humaines et sociales de la fin de vie. Faute de quoi, d‘autres modèles seraient promus comme celui de la Belgique qui en quelques années a banalisé les pratiques de l’euthanasie jusqu’à les appliquer à des personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies psychiatriques, voire en salle d’opération afin de prélever les organes à des fins médicales ou scientifiques… Et voilà que nous reviennent les appels (pour certains même les injonctions) à aller plus loin dans la législation, à céder d’avantage, à s’inspirer du modèle en vigueur notamment aux Pays-Bas.
Au cours de sa session à Genève (13-31 juillet 2009) le Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) a procédé à l’examen des rapports soumis par les États parties. Dans le Projet d’observations finales du Comité des droits de l’homme des Pays-Bas, les pratiques de l’euthanasie dans ce pays sont stigmatisées :
« 7. Le Comité reste préoccupé par l’étendue de l’euthanasie et de l’aide au suicide dans l’État partie. En application de la loi relative à l’interruption de la vie sur demande et à l’aide au suicide, même s’il faut l’avis d’un second médecin, un médecin peut mettre fin à la vie d’un patient sans que la décision ne fasse l’objet d’un examen indépendant conduit par un juge ou un magistrat pour s’assurer qu’elle n’est pas le résultat de pressions morales ou d’une mauvaise appréciation (art. 6). »
A quelques jours de la célébration du soixante-et-unième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la revendication, par certains, de l’euthanasie pour mettre fin aux « vies indignes d’être vécues », a de quoi provoquer nos valeurs et surprendre nos mentalités.
Au mépris des leçons de l’histoire et des combats menés par les personnes malades et leurs proches afin d’être reconnus dans leur aspiration à pouvoir enfin vivre leur vie en société sans discriminations, l’idéologisation d’une liberté ultime, affirmée dans le recours à la mort médicalement administrée, bafoue les fondements mêmes de la démocratie. Elle nous livre en toute innocence aux dérives d’une évidente barbarie.
Dans la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité (enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009) qui doit être évoquée en session le 17 novembre, au-delà de propos convenus évoqués depuis 1978 l’article 8 est de nature à bouleverser les principes et les repères professionnels dès lors qu’est préconisée « dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. » C’est ainsi que l’on vise à banaliser la portée d’une mutation déterminante qui, ainsi, devrait devenir routinière, relever, comme dans les pays qui ont légiféré, constituer en quelque sorte de « bonnes pratiques professionnelles ».
On ne saurait tolérer davantage le discours des quelques beaux esprits qui proclament comme une conquête morale, l’urgence de dépénaliser l’euthanasie, sans consacrer la moindre attention à ceux, plus vulnérables que d’autres, qui éprouvent de tels arguments comme une injure, une imposture, l’insupportable manifestation d’un rejet qui révoque leur humanité même. Les propagandistes actuels du suicide médicalement assisté dévoient un engagement très exceptionnel qui a permis au cours des dernières années de mieux reconnaître le droit des personnes malades ou atteintes de handicaps, leurs aspirations à une qualité d’existence, à une position en société et à des soins respectueux, adaptés, attentifs à leurs choix profonds, à leurs véritables besoins. Ils confortent les logiques de l’indifférence, du renoncement ou de l’abandon et justifient ainsi les relégations de nos malades aux marges de la cité, dans un état de précarité et d’errance chroniques, au domicile ou dans des institutions vécues comme des lieux de ségrégation. La délivrance anticipée d’une vie à ce point indigne de la vie, leur semble alors préférable à l’expérience quotidienne d’une forme subreptice, anonyme, indifférenciée d’euthanasie sociale.
Il nous faut résister aux figures imposées d’une culture de la mort digne, repenser et refonder les solidarités indispensables à une vie en société digne d’être vécue jusqu’à son terme. C’est affirmer que l’existence, la dignité et les droits des personnes malades ou handicapées valent mieux que les débats indécents qui tentent d’organiser les conditions de gestion de la mort des plus vulnérables parmi nous : ceux à l’égard desquels nos obligations s’avèrent au contraire les plus fortes. Il nous faut conférer un espace d’expression publique à la réflexion consacrée au sens de la vie, à la valeur des combats de vie menés par les personnes malades et leurs proches pour préserver une existence humaine, la signification d’une histoire d’homme, en dépit de ce qui les menace.
J’en appelle à une mobilisation éthique : elle concerne les fondements de la vie démocratique et sollicite une dynamique de la responsabilité partagée, un engagement auprès de celles et de ceux qui attendent de notre société d’autres réponses que la solution finale d’une mort assistée.
 haut de page
haut de page
 Mise à mort dans les formes
Mise à mort dans les formes
Sylvie Froucht- Hirsch
Médecin anesthésiste réanimateur, Fondation Adolphe de Rothschild, diplômée en éthique médicale, université Paris-Sud XI
Bientôt sera discutée une proposition de modification du code de santé publique relative au droit de finir sa vie dans la dignité.
Le patient en perte d’autonomie dans sa fin de vie, devient dépendant d’une nouvelle logique médicale accompagnée de procédures que le législateur souhaite implanter dans la culture du soin. Le médecin se doit d’acquérir une nouvelle compétence, celle du soulageur, intervenant habilité à achever au fil de l’épée la vie des grands blessés sur les champs de bataille de Napoléon.
On réfléchit aujourd’hui davantage aux modalités d’interruption des soins, du faire mourir, qu’aux nouvelles obligations du soin dans un contexte de haute technicité et de sensibilité portée à l’autonomie de la personne malade. De quelle manière assumer socialement la réalité du handicap, celle de la personne malade ou handicapée ?
Il est si difficile de faire mourir… affirment certains réanimateurs qui, piégés, se prennent pour des héros modernes affrontant ainsi les difficultés de vivre, de survivre et d’arrêter la vie après en avoir limité le cours.
Dans une proposition de loi actuelle, il est prévu que le médecin devra se doter et enrichir ses savoirs d’une formation relative aux conditions de réalisation, selon les règles, d’une euthanasie.
Deux catégories de médecin cohabiteront de la sorte : les diplômés de la mort et les autres.
Se rend on compte de l’absurdité et de la violence générées par une telle idée de formation ? L’anesthésiste réanimateur que je suis sait parfaitement endormir… il connaît ses limites et s’efforce en toute circonstance de chercher comme hiérarchiser ses décisions en concertation avec les personnes impliquées dans les choix ;
Quelle signification vont prendre demain les échanges auxquels nous habituent désormais les évolutions dont nous sommes témoins ? :
« S’il se passe quelque chose docteur, ne me réveillez pas…
- Madame, même sans moi vous allez vous réveiller…
- Alors, docteur, faites ce qu’il faut pour que je ne me réveille pas ! Si j’ai le moindre handicap que je ne veux pas assumer…
- Vous voulez que je vous tue ? »
Prétextant l’alibi de la maladie, certains souhaitent la mort provoquée par le médecin. Cela relèverait ailleurs de la notion d’homicide.
Pourquoi ne pas former une cohorte, créer un nouveau métier (à l’heure du chômage, des licenciements et de la gestion utilitariste de la santé publique), constitués de ces nouveaux professionnels compétents dans la pratique de l’euthanasie sur simple demande ?
Ne devrait-on pas comprendre la signification d’un autre appel citoyen, profondément différent, opposé aux compassion fallacieuses, attentif aux vulnérabilités de la vie jusqu’à son terme, soucieux d’une conception intègre et courageuse de la vie dans la dignité ?
La peur d’une judiciarisation excessive des pratiques, le sentiment du jugement rapide et intrusif des proches, sont de nature à entraver la réflexion médicale argumentée et à nuire ainsi à la réputation d’une profession. Telle trachéotomie permettant un sevrage ventilatoire plus progressif et temporaire peut être vécue par certains comme un acte futile du point de vue de la préservation d’un handicap, et n’est plus assumée aujourd’hui par le médecin, ce qui génère de toute évidence des mentalités discutables et de mauvaises pratiques.
En quoi la dignité est-elle honorée lorsqu’il ne s’agit plus que de tuer autrui en respectant la méthodologie prescrite ?
De quelle conception de la dignité est-il en fait question ?
La fin de vie est digne en elle-même comme l’est une existence respectée et que l’on ne méprise pas au point de considérer justifié et acceptable de l’anéantir.
En quoi la dignité est-elle assurée dans le protocole de la mort provoquée ?
Cette formation universitaire à l’euthanasie proposée comme l’acquisition indifférenciée de compétences nécessaires, représente une injure faite au médecin et aux traditions dont il est porteur.
Je propose alors d’aller plus loin et d’éditer le petit manuel du parfait tueur.
Dans chaque service sera bientôt installée la chambre de l’ultime soin (instituée par le législateur), celle ou l’on meurt dignement, mis à mort avec les formes, selon la loi… Les réservations pourront se faire sur Internet, lorsque l’envie d’en finir dominera la volonté de persister dans l’effort de vivre. Une nouvelle fonction est offerte aux institutions en quête d’activité et de légitimité. Je ne me reconnais pas dans cette conception du soin, et comprends ce que devra signifier un devoir de dissidence dans un contexte où le mépris est poussé jusque dans ses derniers retranchements.
 haut de page
haut de page
 Faire mourir dans des délais réglementaires ?
Faire mourir dans des délais réglementaires ?
Bernard Devalois*, Louis Puybasset**, Emmanuel Hirsch***
*Médecin, Unité de Soins Palliatifs, Centre hospitalier de Puteaux
**Professeur d’Anesthésie-Réanimation, Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, AP-HP
***Professeur des universités, Directeur de l'Espace éthique Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Dans son édition datée du 14 mars 2009, Le Monde revient sur la fin de vie d’un patient cérébro-lésé, pour qui, en application de la loi d’avril 2005, un arrêt des traitements de maintien artificiel en vie a été mis en œuvre. Cette situation est tout à fait similaire à celle d’Eluana E qui a secoué l’Italie en février. Contrairement à ce qu’affirme l’article, nous pensons que la fin de vie de Mr K ne repose pas la question des limites de la loi d’Avril 2005, mais pointe une nouvelle fois combien sa connaissance, son application et son appropriation par les professionnels de santé restent insatisfaisantes presque quatre ans après sa promulgation. Ces difficultés ne sont sans doute pas sans relation avec la complexité du sujet abordé : celui de la fin de vie, tant pour les malades et leurs proches que pour les soignants.
Les obstacles opposés à la demande de mise en œuvre des dispositifs légaux, tels que rapportés par l’épouse du patient, apparaissent anormaux. Cela montre bien la justesse de la préconisation du rapport de la commission parlementaire d’évaluation de la loi de 2005, consistant à faciliter l’organisation de la procédure collégiale et à exiger une motivation des décisions prises (proposition 6 et 7 du rapport). Il s’agit de ne pas laisser les convictions personnelles d’un professionnel de santé l’emporter sur l’application de la loi. Avec la modification en cours de la rédaction de l’article 37 du code de déontologie médicale, la personne de confiance ou les directives anticipées du patient pourront désormais permettre de lancer la procédure. De même, pour éviter que ne soit opposé à l’entourage un refus de traitement à visée sédative le rapport préconise (proposition 12) une modification du même article 37 du code de déontologie, recommandant dans ce type de situation (arrêt d’un traitement de maintien artificiel en vie, alors que l’évaluation de la douleur physique et de la souffrance psychique est rendue impossible par les lésions cérébrales) l’administration de traitements à visée sédative et antalgique, aux doses nécessaires et suffisantes pour garantir le confort du patient. En aucun cas ces traitements n’interviennent dans le but d’accélérer le délai de survenue du décès après l’arrêt des traitements de maintien artificiel en vie. En aucun cas ces traitements ne peuvent se substituer ni aux soins dus au patient lui-même, ni à l’accompagnement, complexe et nécessitant une grande expertise de son entourage conformément aux préconisations de la loi d’avril 2005.
En ce sens, le cas de Mr K ne fait que renforcer l’urgence de l’application de plusieurs propositions déterminantes du rapport parlementaire de décembre 2008 (outre celles déjà citées plus haut). La création annoncée d’un Observatoire des pratiques médicales en fin de vie (propositions 1 à 3 du rapport) permettra de répertorier afin de les analyser les difficultés rencontrées dans l’application de la loi afin d’en tirer des préconisations pratiques et un rapport annuel significatif. La désignation de correspondants régionaux (proposition 8) en lien avec l’Observatoire permettra si nécessaire de solliciter leur intervention en cas d’obstacles constatés dans la mise en œuvre des procédures conformes à la loi. Structures spécialisées, les Unités de Soins Palliatifs plus nombreuses et dotées de davantage de places (proposition 13), disposeront des compétences indispensables afin d’accompagner au mieux les situations complexes de fin de vie. Le transfert de Mr K dans une telle structure, qui avait été proposé mais refusé en raison de l’éloignement familial qu’il aurait imposé, aurait sans doute permis d’atténuer la souffrance de sa femme et de ses enfants, en permettant un suivi adapté au tragique d’une telle situation.
Il apparaît discutable que soit entretenue volontairement une confusion entre d’une part la pratique médicale de traitements à visée sédative ou antalgiques pour répondre aux besoins de confort du patient et d’autre part l’ouverture d’un droit à la mort, opposable à notre société qui serait alors tenue « de faire mourir dans des délais réglementaires ».
 haut de page
haut de page
 Les vraies questions posées par la mort d’Eluana en Italie
Les vraies questions posées par la mort d’Eluana en Italie
Bernard Devalois*, Anne Marie Dickelé**, Michèle Salamagne*
* Médecins de soins palliatifs, ancien/ne Président/e de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs)
**Psychologue travaillant en soins palliatifs, membre du CCNE (Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé)
La mort d’Eluana Englaro après dix-sept ans de maintien artificiel en vie, a déclenché une tempête médiatique et politique. Les autorités vaticanes ont pesé de tout leur poids dans cette affaire, cherchant à imposer à l’État et à la justice italienne leur point de vue. Silvio Berlusconi a décidé de faire de cette affaire un casus belli avec son opposition. De nombreux observateurs ont conclu hâtivement que « le débat sur l’euthanasie est relancé en Italie ». Ce raccourci ne fait qu’entretenir la confusion sur les sujets complexes de la fin de vie. La mort de cette jeune femme ne pose pas la question de l’euthanasie mais celle de l’obstination déraisonnable. Elle ne concerne ni le droit au suicide légalement assisté, ni celui d’une éventuelle autorisation accordée aux médecins de raccourcir la durée d’une agonie.
Le terme d’euthanasie désigne l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort. Il est intéressant de noter que les partisans d’une légalisation (inspirée des Pays-Bas ou de la Belgique) et les tenants des théories « pro-vie» (s’appuyant sur le caractère sacré de la vie pour s’y opposer) ne s’entendent que sur un seul point : brandir l’étendard du mot « euthanasie » pour apporter une réponse, plus dogmatique que rationnelle aux situations complexes du type de celle d’Eluana.
Les uns veulent nous faire croire que l’euthanasie (l’injection létale) serait la solution à l’acharnement thérapeutique. C’est évidemment faux. Être opposé au maintien artificiel en vie, ce n’est pas nécessairement être favorable à l’injection létale. Les autres veulent imposer leurs croyances (respectables mais relevant de la sphère intime) à une société sécularisée rassemblant des citoyens ayant sur ces questions des positions différentes. Être opposé aux injections létales, ce n’est pas nécessairement être favorable au maintien en vie « à tout prix ». Quant à nous, comme une grande majorité de professionnels de santé et de la société en général, nous ne nous reconnaissons dans aucun de ces deux camps. Opposés à une légalisation des injections létales, nous sommes favorables à ce que dans des situations comme celle d’Eluana, il soit possible d’envisager, pour laisser mourir, la limitation ou l’arrêt de traitements comme la nutrition médicalement assistée.
Face à ces situations, des questions essentielles doivent être posées. Quand est-il possible de considérer que le maintien dans un état végétatif chronique n’a pas d’autre objet que le maintien artificiel en vie ? Le maintien artificiel en vie est-il l’équivalent du maintien en vie artificielle ? Comment intégrer la volonté (et les valeurs) de la personne concernée quand elle ne peut plus l’exprimer directement ? Comment faire en sorte que le médecin puisse respecter la volonté d’un catholique désirant se conformer aux positions de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en recevant une nutrition médicalement assistée pour le maintenir en vie s’il est en coma végétatif ? Et comment pourra-t-il pour un autre, placé dans la même situation mais porteur d’autres valeurs morales, suspendre cette même nutrition médicalement assistée si elle n’a d’autre objet que le maintien artificiel de sa vie ? Comment garantir, dans les deux situations, l’accompagnement du patient et de son entourage ?
En France, la loi d’avril 2005 permet un abord plus dépassionné de ces questions. Elle ne cherche pas à répondre à chaque cas particulier mais à encadrer la procédure de décision. Elle a été votée dans un véritable consensus politique. Ce point n’est pas le moindre quand on constate la fragilité engendrée par les tentatives de passage en force politique sur ces questions (en Italie, comme au Luxembourg par exemple).Mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de la fin de vie dans notre pays. Deux propositions du rapport de la commission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 vont être mis en œuvre dans les jours qui viennent :
la rémunération du congé d’accompagnement (prévu par la loi de 1999 !) est un progrès indéniable, même s’il ne concerne que l’entourage d’un patient à domicile (et pas pour un patient hospitalisé) ;
la parution de décrets modifiant le code de déontologie devrait inciter à une meilleure pratique de l’utilisation de traitements à visée sédative (notamment lors des limitations et arrêt de traitements de maintien artificiel en vie). De prochaines recommandations de la SFAP, validées par la HAS viendront préciser les recommandations de bonnes pratiques sur ce sujet difficile.
D’autres propositions de ce rapport mériteraient également d’être rapidement mises en chantier : observatoire des pratiques médicales en fin de vie, correspondants départementaux, réflexion sur l’incidence de la tarification à l’activité (T2A) sur l’obstination déraisonnable, etc.
La véritable leçon à tirer de l’affaire d’Eluana est que le cadre législatif doit permettre que de telles situations trouvent des solutions humainement acceptables et respectueuses des valeurs de tous et de chacun sans donner lieu à des affrontements politiques et idéologiques. C’est la voie qu’a choisit la France. Espérons qu’elle saura faire école en Europe, et dans le monde.
 haut de page
haut de page
 Revendiquer le droit à disparaître avant celui d’être
Revendiquer le droit à disparaître avant celui d’être
Anne Festa
Directrice du réseau de santé en cancérologie Oncologie 93
Non soignante, au sein d’un hôpital, j’étais quotidiennement au contact des malades et de leurs proches. J’ai tenu, pendant plusieurs années, un journal de bord de ces rencontres.
Ces notes de terrain, prises souvent peu de temps après la rencontre, ou au contraire écrites plus tard, me permettent aujourd’hui d’illustrer combien il est difficile d’être dans la certitude du « bien faire », du « bon soin », du « bon choix ».
J’ai souvent été le témoin de ce que j’appellerai de la bienveillance mal à propos : des soignants, des proches, la société qui, dans la certitude de savoir ce qui est bon pour le malade, se sentent parfois dans l’urgence de faire taire des souffrances, de les faire disparaître dans un temps qui n’est pas celui souhaité par la personne concernée.
Souvent, et fort heureusement, ces deux notions du temps se rencontrent quand le dialogue est établi, quand ce qui prévaut est l’attention portée aux volontés, au confort, à la dignité de la personne en souffrance.
Néanmoins, comme l’illustrent les notes qui suivent, l’impossibilité de s’exprimer ou la crainte de ne pas être entendu(e) créent des situations qui laissent à l’entourage, aux témoins, des questionnements profonds sur comment accompagner dignement, comment changer nos regards, comment rester dans le respect de la vie, aussi fragile et fracassée soit-elle.
Un jour de l’année 2005…
Elle est là, toute pâle, les traits tirés mais l’air heureux néanmoins.
Elle me parle. Souriante elle m’explique le temps qu’il lui reste à vivre. Son médecin lui a dit. « Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle » dit-elle !
Elle s’exprime clairement sur ses envies et se projette dans les jours à venir. Elle le veut ce temps et elle le veut le mieux possible, le plus beau possible.
J’ai un nœud à l’estomac.
Ses trois petits entre 3 et 9 ans …
Son homme …
Ses objectifs, sa rage de vaincre…
« Il ne faut pas que ça bouge cette merde, il faut que je parte en vacances. »
Puis elle rit aux éclats en me racontant qu’elle a jeté une lettre de l’hôpital la convoquant pour un autre traitement le jour même où on lui annonçait l’échec des précédents…
« J’ai cru que c’était une facture de téléphone déjà payée et dont on me rappelle l’échéance depuis un an maintenant ; tu vois un peu l’acte manqué, mettre à la poubelle un courrier m’annonçant un essai thérapeutique possible ! »
On a ri toutes les deux, très fort, très longtemps.
Elle ne voulait pas mourir mais savait bien que le « vaccin » contre la mort n’existe pas.
Elle voulait vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, tout près de ceux qu’elle aimait. Plus déchirée à l’idée de la séparation d’avec ses êtres chers qu’à la perspective de sa propre mort.
Au fil de ses visites de plus en plus rapprochées, sa mine était parfois grave. Elle avait peur, se demandait si les médecins ne baisseraient pas trop vite les bras parce que « ça coûte cher des essais », « parce que ça fait cinq ans que ça traîne », « parce que c’est dur pour eux et qu’ils pensent que c’est peut être mieux de ne pas continuer », « parce que mon mec, il craque ».
Elle n’allait jamais plus loin dans ses propos. Elle ne me rapportait que des bribes de conversations après les consultations où « plus rien » n’était proposé.
Moi, j’entendais autre chose. La peur que des complications, que sa souffrance et que celles de ses proches et de ses soignants fassent naître en eux l’idée « d’en finir vite ». Interprétation ?
Elle est partie.
Elle n’a pu rester chez elle comme elle le souhaitait.
Elle n’a pas eu le temps de dire au revoir pour toujours à ses enfants.
Mais elle a tenu le plus longtemps possible sans antalgique, « pour garder conscience » disait-elle.
Je me demande si cette inquiétude, cette peur, palpables à travers ses propos ne l’ont pas d’une certaine façon obligée à une certaine discrétion concernant sa douleur et son confort de vie pendant les derniers moments. Je me demande si un accompagnement médicamenteux adapté ne lui aurait pas laissé le « plus » de temps qu’elle souhaitait ? La peur de se voir enlever son temps à coups de médicaments trop « dosés », administrés trop hâtivement l’en a peut être empêchée. Ainsi, s’est elle, peut être, dans ce mutisme douloureux, privée d’un accompagnement qui aurait pu la soulager tout en respectant au mieux ses désirs.
Cinq ans plus tard, je persiste à penser que nous devons rester en alerte.
La précipitation d’effacer les différences, les souffrances qui nous gênent, qui peuvent nous faire mal, ne doit pas prendre le pas sur l’attention et l’accompagnement que nous devons à ceux qui demandent à être avec nous avec leurs différences, avec leurs souffrances. Le respect de leurs choix, le soulagement de leurs douleurs doivent être pris en compte afin que notre société et parfois eux-mêmes n’en arrivent plus à demander d’abord le droit à disparaître avant celui d’être.
 haut de page
haut de page
 Alzheimer : le cumul des vulnérabilités
Alzheimer : le cumul des vulnérabilités
Catherine Ollivet
Présidente de l’association France Alzheimer 93, membre du Conseil exécutif du Collectif Plus digne la vie
Depuis quelques années, parler de la maladie d’Alzheimer participe d’un phénomène de mode. En parler ne veut pas dire qu’on en connaît vraiment les conséquences. Parmi celles-ci, et comme bon nombre de pathologies mentales dont il vient d’être question, elle a la particularité de se manifester par l’étrangeté : peu à peu, une personne devient étrangère à son environnement, à son entourage et ce dernier peut être tenté de ne plus reconnaître ce malade comme son semblable. En réalité, « ce semblable là » fait peur. Dans le sillage de l’étrangeté, on retrouve le cumul de vulnérabilités associé au handicap sévère, car le handicap, surtout lorsqu’il est psychique, rend intrinsèquement vulnérable. Notre société individualiste n’est guère encline à accepter l’autre s’il est trop radicalement différent. Sans doute, dans les media, la maladie d’Alzheimer est-elle devenue d’une certaine manière « une figure emblématique » des enjeux du handicap dans notre XXIe siècle, par le nombre des personnes touchées. La collectivité s’y intéresse et cette pathologie particulière pourrait ainsi servir d’aiguillon, dans le déclenchement d’évolutions que l’on ne peut qu’appeler de nos vœux.
L’étrangeté de la maladie d’Alzheimer, ses modes d’expression diverses, variables d’une personne malade à l’autre et variables dans le temps, ses définitions et approches scientifiques changeantes selon la spécialité médicale ou soignante qui s’en préoccupe, nous met tous en bien grande difficulté pour la définir.
Le professeur Joël Ménard en a souligné cette particularité dans son rapport. Elle n’est pas qu’une affaire de statistiques ni de chiffres : « Le nombre de malades ne suffit pas à définir les enjeux Alzheimer ». Plus fondamentalement, il convient d’évoquer des enjeux éthiques, des choix de société cruciaux. Quel engagement est requis de la part de la collectivité pour prendre en charge ces malades ? Quels moyens doivent être effectivement débloqués pour faire face à leurs besoins de vie et de soins ainsi qu’à ceux de leurs proches aidants ?
Observons qu’il n’est pas possible de définir la maladie par l’âge auquel elle se déclenche. Comme l’a dit le professeur Ménard, « l’âge de survenance ne constitue pas un critère permettant de définir une entité nosologique spécifique ». Dans notre pays, des pratiques sont pour le moins étranges : selon qu’un malade est âgé de moins ou de plus de 60 ans, il ne bénéficiera pas des mêmes droits d’accès aux soins et aux aides, il n’aura pas, à handicap égal, les mêmes soutiens financiers. Pourtant, la maladie est exactement la même, qu’elle apparaisse à 30 ans ou à 90 ans. En revanche, l’âge de la personne détermine à l’évidence les réponses sociales adaptées à ses besoins spécifiques.
Une fragilisation en chaîne des malades, de leurs entourages et des professionnels du soin
La maladie d’Alzheimer affecte dramatiquement les facultés de communication d’une personne. Maladie de l’isolement, on constate qu’elle « contamine » les familles, les professionnels et, d’une manière générale, toutes les personnes qui y sont confrontées, les entraînant dans un même isolement. Le cumul des vulnérabilités affectant le malade cause de multiples dommages collatéraux tout autour de ce dernier. Ce n’est pas seulement une personne qui est frappée, mais l’ensemble de son entourage. Les professionnels de l’aide et du soin, devant prendre en charge au quotidien des personnes frappées par la maladie d’Alzheimer, ne sont pas épargnés - bien au contraire.
Les vulnérabilités psychiques, physiques et sociales s’additionnent pour attaquer en tout premier la validité de la parole du malade. Le diagnostic de « maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée » dévalue ipso facto la parole de la personne qui en est atteinte. Fabrice Gzil, au cours du dernier colloque organisé par l’Espace Ethique par son Initiative « Alzheimer 2007 », a souligné à juste titre, qu’au contraire, c’était une présomption de validité qui devrait toujours prévaloir et non un soupçon immédiat. La présomption de compétence est un impératif éthique dans un premier temps. C’est seulement ensuite, en fonction de l’évolution inexorable de la maladie et des possibilités offertes par l’environnement matériel et humain du malade, que le champ de compétence de ce dernier sera évalué et réévalué régulièrement. Ne perdons pas de vue que tout diagnostic de nature à remettre en cause la parole d’une personne est très lourd d’enjeux. La fragilisation en chaîne qui s’ensuit constitue l’un des défis majeurs posé par la maladie d’Alzheimer. Ne nous rassurons pas en faisant semblant de croire que la personne ne souffre pas. Sous prétexte de sa maladie, elle ne peut accepter d’être désignée comme totalement déficitaire, du jour au lendemain, au point même de lui dénier la capacité à exprimer des préférences. On peut aussi s’interroger sur la validité de notre jugement sur cette compétence reconnue à la personne malade : la tentation est grande de la considérer « lucide » lorsque sa réponse va dans le sens que nous souhaitons… et de l’invalider lorsqu’elle s’oppose à ce que nous considérons comme nécessaire.
Le thème de la vulnérabilité de la famille est majeur s’agissant de la pathologie d’Alzheimer comme de la schizophrénie. Contrairement aux professionnels de santé, les membres de l’entourage savent comment était la personne avant que d’être diminuée par la maladie, et en ont le souvenir chevillé au cœur et à la mémoire. Qu’elle soit autant devenue « autre » est inacceptable. De ce fait, il n’est pas souhaitable que des professionnels du soin, intervenant subitement de l’extérieur, s’estiment investis d’un pouvoir de décision sans limite. Autour d’un malade d’Alzheimer, on assiste trop souvent à une invalidation de la parole de l’autre par cet effet de « contamination » déjà évoqué. Les membres de la famille exposent leur point de vue, de même que le médecin, l’infirmière, l’assistante sociale, l’auxiliaire de vie, etc. Chacun parle de son malade ou de son patient, personne n’écoute ni ne voit la personne malade. Trop souvent, certains acteurs, notamment lorsqu’ils sont perturbés par leur souffrance ou leurs difficultés professionnelles, n’acceptent pas d’accueillir d’autres points de vue que le leur.
Une maladie qui pose de multiples questions à notre société
De plus en plus, des choix dramatiques deviennent inévitables. Il n’est plus exceptionnel de trouver des couples où l’un des conjoints est atteint de la maladie d’Alzheimer et l’autre d’un cancer. Dans de tels contextes, les arbitrages à opérer sont extrêmement douloureux. D’un côté, l’évolution de la maladie d’Alzheimer est présentée comme inéluctable. De l’autre, en cancérologie, on a recours à des métaphores de combat. « On va se battre » disent les cancérologues, nous allons opérer, faire une chimiothérapie, une radiothérapie… Les enfants doivent, en tous cas, faire face à l’impossible question : « Qui préfères-tu ? Ton père atteint d’un cancer qui peut être sauvé ? Pour cela, tu dois sacrifier ta mère Alzheimer en la plaçant dans un établissement alors que tu lui avais juré que jamais tu ne l’abandonnerais… ». Qui privilégier humainement, affectivement ? Comment répondre à cette double exigence de sollicitude lorsque tu sais que tu ne pourras pas gagner les deux combats ?
L’allongement de l’espérance de vie des femmes mais plus encore des hommes ces toutes dernières années, est à l’origine de l’apparition de situations jusqu’ici inédites. Désormais, il n’est plus rare de voir un couple atteint par la maladie d’Alzheimer. La vulnérabilité des personnes affectées directement et indirectement atteint alors une intensité considérable. Que faire humainement, et avec quels moyens financiers, lorsqu’on a ses deux parents malades ? La famille est-elle encore capable, dans cette situation, de prendre des décisions dans le seul intérêt de la personne malade ?
Dans la maladie d’Alzheimer, les médecins et les infirmières voient leur responsabilité professionnelle fortement sollicitée et fortement altérée. En dernière instance, ce n’est plus le professionnel qui se trouve en première ligne, mais simplement l’Homme. Entre acharnement thérapeutique et refus de soigner, comment trouver sa juste place face à une personne qui n’est plus capable de dire explicitement ses choix ?
Face à l’évolution de la maladie, l’épreuve du choix est presque quotidienne. Elle aboutit un jour ou l’autre devant l’alternative : domicile ou institution ? Quelles sont les limites des équipes de prise en charge des malades d’Alzheimer à leur domicile ? Les arbitrages seront-ils rendus en prenant en compte le seul intérêt du malade ou plutôt en fonction des capacités de ces équipes, ou encore en fonction des limites de l’aidant familial ?
Plus fondamentalement, qui sera investi de la mission de protection des malades ? Le juge ? La tutelle ? À l’évidence, la modification à venir de la loi relative à l’exercice des tutelles sera déterminante. Elle devra répondre à bien des questions soulevées par la maladie d’Alzheimer. Mais cela suffira-t-il ?
À l’avenir, appartiendra-t-il à la communauté des soignants de protéger la personne devenue vulnérable par sa maladie ? Nul ne mérite qu’une confiance aveugle lui soit accordée. La communauté des soignants n’est pas exempte de dérives. Souvenons-nous, tout de même, que des médecins exerçaient au camp d’Auschwitz !
À l’évidence, aucune autorité, aucune instance, aucun regroupement de professionnels du soin ne peut relever à lui seul les défis multiples, pour que des êtres en grande vulnérabilité soient, malgré tout, non seulement protégés du pire, mais bien plus encore soignés et accompagnés jusqu’à leur ultime souffle de vie. Chacun d’entre nous devra être mis à contribution pour que la lutte contre la maladie d’Alzheimer ne soit pas condamnée à l’échec. Il n’y aura de solution que collective.
Le titre de l’ouvrage Repenser ensemble la maladie d'Alzheimer (1) semble de ce point de vue judicieux. En pareille matière, nul ne peut s’arroger de compétence entière. Le phénomène dont il est question est totalement déstructurant, tant sur un plan rationnel que sur un plan affectif. Nul ne peut prétendre y faire face au moyen de recettes simples.
Le professeur Ménard a formulé une recommandation qui me semble essentielle : « …Développer des lieux où conduire une réflexion en vue d’une meilleure articulation entre la réflexion éthique et la pratique de terrain ». Dans l’immédiat, il n’y a pas de progrès spectaculaires à espérer. Nous pouvons au moins conduire un effort collectif de questionnements sur la maladie et ses conséquences. Il appartient à l’éthique, précisément, de poser les bonnes questions.
La maladie d’Alzheimer, demeure encore aujourd’hui énigmatique. Elle nous interpelle dans la mesure où elle nous fait peur à tous.
(1) Repenser ensemble la maladie d'Alzheimer, E. Hirsch, C. Ollivet (SD), Paris, Vuibert, 2007.
 L’indignité comme protection de la dignité ?
L’indignité comme protection de la dignité ?
Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit privé,
avocat à la Cour, Paris
«Sky Real Lives » consacrait, cette semaine, un de ses numéros à une personne malade ayant décidé, en Suisse, de réaliser devant les caméras un acte d’euthanasie. Par delà les visées commerciales évidentes du réseau de télévision, la diffusion du documentaire semblerait relancer le débat sur une dépénalisation de l’euthanasie.
L’antienne bien connue du respect de la dignité de la personne ne manquera pas d’être rappelée au secours des demandes formulées par diverses associations réclamant l’exercice d’une telle liberté.
Un tel argument demeure pourtant inopérant tant il relève d’une appréciation défectueuse de ce principe juridique. Celui-ci représente en effet un principe d’ordre public, hors de la disposition des individus, qui ne peuvent en aucun cas imposer l’exercice d’une liberté sur ce fondement. Il n’existe donc aucun droit individuel à déterminer le seuil personnel de dignité qui imposerait ainsi de recourir à la mort mais, au contraire, une obligation de protéger l’humanité dans le malade.
La légitimité du procédé consistant à filmer puis montrer au public une personne en grande détresse doit pourtant être discutée dans le champ politique, bien que le voyeurisme veule lui-même ne mérite en l’espèce aucun commentaire. Est-ce utile à « sensibiliser » les spectateurs ?
La réponse doit demeurer négative : souhaitant la défense de la liberté à mourir dans la dignité, c’est bien la dignité d’une personne et de son être qui a été piétinée. La diffusion d’images bouleversantes d’une personne éprouvée, ainsi stigmatisée puis enfermée dans son seul statut de souffrance, viole ses droits les plus fondamentaux.
Dans une affaire comparable, le juge français n’omet pas de rappeler que la photographie d’un haut fonctionnaire assassiné, malgré le caractère d’actualité du cliché, portait atteinte à la dignité de sa famille.
Ces images relèvent donc d’un procédé injustifié, consistant à mépriser la dignité du malade afin de permettre le respect de celle des autres patients. La fin justifie-t-elle tous les moyens ? Et convient-il de sacrifier aux intérêts discutables du groupe le respect dû à cet individu ?
Ceux qui acceptent ainsi les images télévisées s’enferment alors immédiatement dans le procédé qu’elles dénoncent elles-mêmes dans le but de pouvoir exercer une éventuelle liberté de mourir dignement. Leurs voix sont donc privées de légitimité à tenir en accusation ce qu’elles pratiquent.
Le recours à une cette obscénité permet surtout de confortablement masquer le réel problème consistant à offrir au malade une place adéquate dans la société. Nous demeurons par nature tous « sensibles » à notre propre souffrance, et il n’est nul besoin de scénariser puis présenter ces tragédies. La révolte provoquée ne doit pas tant provenir des images montrées que de la réalité d’un individu abandonné seul dans sa douleur.
Tâchons plutôt de résoudre ces drames en permettant une prise en charge sociale, psychologique mais aussi financière de telles situations. Il nous faut prendre conscience de l’insuffisance de l’accompagnement de la fin de vie au travers du manque de soins palliatifs et d’un défaut de soutien des personnes en phase terminale.
C’est la définition d’une place adéquate pour le malade dans la société qui nécessite tous nos efforts plutôt que la reconnaissance de droits hypothétiques, uniquement provoqués par l’abandon de tous.
Alors, finalement – et telle est l’ironie de ce documentaire consacré à la mort d’un individu au sein d’une série nommé « Real lives » – la vie peut être promue, dans le respect de l’individu au sein de la cité.
 Dépénaliser l’euthanasie : une mauvaise réponse à de bonnes questions
Dépénaliser l’euthanasie : une mauvaise réponse à de bonnes questions
Xavier Dijon
Professeur à la Faculté de droit de Namur, Belgique
En permettant à un médecin d’injecter une substance létale dans les veines d’un malade, la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie a introduit également un redoutable poison dans les veines du corps social. Certes, les problèmes sont réels : comment garder une mesure humainement et financièrement raisonnable dans les soins à prodiguer aux grands malades ? Comment travailler à rendre leurs souffrances plus supportables ? Comment aider les membres de l’entourage à vivre les pertes du proche qu’ils voient mourir ? Mais la légalisation de l’euthanasie ne rencontre pas bien ces vraies questions ; au contraire. Elle ne corrige pas l’excès de pouvoir médical déjà à l’œuvre dans l’acharnement thérapeutique puisqu’elle accorde en outre au médecin le pouvoir suprême de donner la mort. L’euthanasie n’encourage pas non plus le médecin à prendre le temps d’écouter son patient pour chercher à soulager ses souffrances physiques et morales puisqu’elle lui offre la solution plus radicale d’un silence définitif du malade. Enfin, elle abaisse le niveau de délicatesse morale de l’entourage et diminue ses réserves de patience à l’égard du proche qui connaît sa dernière épreuve. A cause de la loi, le malade sait désormais qu’il appartient à lui seul de se retirer de sa propre vie : bonjour l’angoisse !
Mais le malade l’a demandé, dit-on. D’abord l’affirmation serait à vérifier. Certes, la loi a prévu des formalités écrites pour s’assurer du respect des procédures, en particulier du recueil du consentement du patient, mais quand on s’aperçoit que, sur l’ensemble du Royaume, les déclarations d’euthanasie envoyées à la Commission d’évaluation se répartissent en 84 % du côté flamand et 16 % du côté francophone, on est en droit de se demander si, en Wallonie du moins, les euthanasies se pratiquent toujours avec le consentement du patient. Quoi qu’il en soit de cette question de forme, il reste à s’interroger sur le lien entre la demande (supposons la réelle) du malade et la réponse que lui donne la société. Prenons pour point de comparaison un tout autre domaine : une famille qui habite un logement insalubre réclame depuis des mois un logement social. Pourquoi la société est-elle si lente à le lui fournir ? Une société est suspecte lorsqu’elle accède à la demande de mort qui lui épargne la vue d’un malade qui n’en finit pas de mourir et qu’elle traîne tant à répondre à la demande d’une famille pauvre qui remet en cause son régime de propriété immobilière.
Apparemment, une loi de dépénalisation contente tout le monde puisqu’elle consacre, dit-on, le libre choix : de souffrir si le malade préfère aller jusqu’au bout de son existence, de mourir s’il préfère s’en retirer. Mais sous des dehors de bienveillance universelle, une telle loi conforte en réalité une idéologie bien connue, celle de l’individualisme qui enferme chaque sujet en son propre sort : chacun pour soi ! On connaît les ravages opérés par cette position libérale dans les rangs des travailleurs ; ne peut-on les redouter aussi au chevet des malades ? La loi pénale comptait au moins l’avantage de fermer la porte de sortie : ni vous ni moi n’avons de prise sur votre vie (nous n’avons d’ailleurs ni l’un ni l’autre demandé à naître), mais puisque la vie est là, même souffrante, nous n’y toucherons pas, de telle sorte que nous pourrons la porter ensemble jusqu’au bout.
La loi pénale aidait le praticien à garder sa limite, le protégeant de la tentation de toute-puissance qui lui survient quelquefois ; elle l’invitait à déployer sa patience et son intelligence pour permettre à son patient, corps et âme, d’aller aussi paisiblement que possible jusqu’au bout de ses jours. Elle aidait aussi le malade à ne pas confondre les pertes physiques ou psychiques de son état avec une quelconque diminution de sa dignité, d’essence inaliénable. La loi pénale maintenait entre le malade et ses proches l’espace ouvert d’un dialogue où tout reste possible : parler et écouter, donner et recevoir, patienter, avouer l’impuissance, faire le deuil, espérer, pleurer, aimer. Mais la loi dépénalisant l’euthanasie a ouvert devant le soignant, le patient et ses proches la porte tentante de la redoutable impatience.
P.S. Pour un argumentaire un peu plus élaboré, cf. X. Dijon, La réconciliation corporelle, une éthique du droit médical, Namur,Presses universitaires de Namur, Bruxelles, Lessius, 1998.
 Des valeurs d’éthique et de solidarité
Des valeurs d’éthique et de solidarité
Louis Puybasset
Médecin, responsable de l’unité de neuro-réanimation,
département d’anesthésie-réanimation,
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP
La loi du 22 avril 2005 a vidé de sa substance la revendication du traitement de la souffrance en fin de vie comme argument princeps pour une légalisation de l’euthanasie. Aujourd’hui, légaliser l’euthanasie ne serait rien d’autre qu’ouvrir un droit à la mort, une assistance au suicide. Aucune législation, aucun contrôle bureaucratique n’empêchera cela. Le retour d’expérience sur ce qui se passe en Belgique et en Suisse le démontre. L’euthanasie d’Hugo Claus à la phase débutante d’une maladie d’Alzheimer par les médecins Anversois en est une première démonstration. Le fait qu’un tiers des 147 patients Suisses euthanasiés entre 2001 et 2004 par Exit n’avaient pas de maladies incurables mais souffraient de pathologies rhumatismales ou de douleurs chroniques en est une seconde.
Prétendre encadrer le recours à ce droit en en faisant une exception ne tient pas et cela pour trois raisons : l’exception est impossible à définir ; la loi n’a pas vocation à traiter d’exceptions mais à poser des principes généraux et enfin dans son application l’exception deviendra, immanquablement, principe. Qui seraient d’ailleurs les membres d’une telle commission « d’exception » ? Quels seraient les recours juridiques contre cette même commission ? Si elle est une déviance de la loi, l’exception est également une déviance de la médecine, pour laquelle, par définition, tout patient est unique donc exceptionnel.
Au-delà de la question médicale, l’ouverture d’un tel droit à la mort un problème sociétal : je pense profondément que se joue là « l’essentiel » quant au sens du soin et quant à la qualité du lien social que nous laisserons à nos enfants.
Répondre à la demande de mort d’une personne (malade ou non) ne fait pas et devra jamais faire partie du rôle social assigné au corps médical. Ce n’est pas parce que certains médecins hollandais et belges sont tombés dans cette déviance, non sans une grande souffrance dissimulée d’ailleurs à l’opinion, que les médecins français doivent les suivre sur cette voie. Ce n’est pas parce que les médecins belges s’orientent maintenant vers une séquence euthanasie-prélèvements d’organes que nous devons perdre notre libre arbitre et copier aveuglément cette procédure dont ils portent la responsabilité.
Pour la médecine, participer activement à l’ouverture de ce droit à la mort serait l’équivalent de la tache indélébile que porte la médecine allemande dans sa participation à la stérilisation forcée de 300 000 malades mentaux à la fin des années trente puis à la sélection et l'euthanasie de 100 000 handicapés allemands de 1939 à 1941. Faut-il rappeler que le concept de vie qui ne mérite pas d’être vécue a été introduit à cette époque (« Lebensunwertes Leben »). Faut-il rappeler que ce sont les médecins de l’opération T4 qui ont ensuite dirigé l’opération Reinhard ? Pour la médecine, ce serait l’équivalent de la tache indélébile que porte la police française dans l’organisation de la rafle du Vel d’Hiv puis dans la décision, prise sans l’injonction des autorités d’occupation, de séparer les 4115 enfants juifs de leur mère avant leur départ vers les chambres à gaz d’Auschwitz où tous sans exception périrent. Accéder à cette demande, si tant est qu’elle existe réellement dans notre société, serait pour la médecine du même ordre, celui d’une déviance irréparable du rôle social d’une profession qui touche à l’intime et qui côtoie souvent l’ultime, une profession qui loin de donner du pouvoir ne devrait donner à celui qui l’exerce que des devoirs.
Ce sont des leçons que nous n’avons pas le droit d’oublier. Il y a des moments de l'histoire où on juge un corps social, où on juge ses dirigeants, où on juge tout simplement un homme sur sa capacité à dire NON. Contrairement à la banalisation dans laquelle on veut nous faire tomber, nous vivons aujourd'hui un de ces moments.
Si certains hommes politiques pensent qu'il est devenu nécessaire de faciliter la mort consentie, ils n'ont pas besoin pour cela de réquisitionner les médecins. Nul besoin d'être médecin pour effectuer un tel acte. Notre devoir est de soulager les souffrances et de ne pas nous acharner à prolonger des situations insupportables et sans issue. La lutte contre l’acharnement thérapeutique au prix, le cas échéant, du raccourcissement de la vie est un droit reconnu par tous, et un devoir d’humanité pour les médecins, consacré par la loi Leonetti. Mais qu'on ne nous instrumentalise pas au service dont on ne sait quel droit à mourir à la libre disposition de l'individu roi. Qu'on ne prenne pas prétexte et qu’on ne se cache pas derrière la souffrance des malades pour faire des médecins les préposés d'un suicide banalisé. Nous refusons de devenir des exécuteurs commis d'office au profit d'intérêts familiaux, économiques ou sociaux intéressés à la disparition de certaines existences.
Cela dit, ouvrir un tel droit aurait des conséquences très lourdes sur l’histoire trans-générationnelle de chacun. Assumer un suicide dans une famille est déjà très difficile. Assumer un suicide revendiqué et soutenu socialement est impossible. Ce type de drame met les proches qui y survivent dans une demande de réparation qui ne peut trouver de réponse. Pourquoi ? Peut-être parce qu’un tel acte rompt la « promesse » qui lie les hommes entre eux. La promesse faite par tout parent à tout enfant lorsqu’il nait que la vie de chacun est intimement liée à celle de l’autre dans une chaine de solidarité trans-générationnelle. A l’évidence, le suicide est une liberté individuelle qui changerait de nature si la société mettait ses moyens à disposition pour le réaliser. Les conséquences sociales et anthropologiques d’une telle modification du rapport entre l’homme et sa mort seraient probablement beaucoup plus considérables sur le long terme que ce que l’on veut croire, faute de pouvoir l’imaginer.
Ce préambule étant posé, il y a à l’évidence des difficultés d'appropriation de la loi du 22 avril 2005 tant par le corps social que par les médecins que l’on ne peut pas nier.
La loi ne sert pas les intérêts de certains qui font de la souffrance et de l'inaptitude des médecins à gérer correctement la fin de vie leur fond de commerce. Pour ceux là, une loi qui n'ouvrirait pas un droit à la mort ne sera jamais suffisante. La mission Leonetti aurait ainsi accouché d'une « souris avortée » (terrible vocable !), avant même que les auteurs de ce communiqué n’aient même eu le temps matériel de lire le rapport. Incidemment pourquoi « avortée », si ce n’est pour faire un lien subliminal entre euthanasie et avortement ?Il s’agit là d’un nouvel exemple de la manipulation des mots qui n’a pour objet que la manipulation des inconscients. On peut déjà s'attendre à ce que le prochain cas médiatisé sera encore pire que celui de Chantale Sébire. N’assistera-t-on pas, la prochaine fois, à l’instrumentalisation de la détresse d’un enfant ? Et pourquoi pas en direct à la télévision comme cela s’est déjà passé récemment en Angleterre ? A ces militants qui demandent par la loi une réparation aux drames personnels qu'ils ont pu vivre, je leur dis que la loi ne peut pas faire office de thérapie. Je dis et je redis en respectant leur douleur, que quelque soit ce qu'ils ont pu vivre, un décès par euthanasie aurait été pire dans leur construction intime, non pas que la souffrance soit rédemptrice, mais que l’effacement brutal de la vie est un acte contre-nature. C'est d'un profond changement de culture médicale dont nous avons besoin mais pas d’une loi légalisant l’euthanasie.
Pour les médecins, il est dur de sortir de la toute puissance, il est difficile de reconnaître humblement que le curatif a ses limites, parce qu’il est tellement plus simple de toujours faire plus, de toujours en rajouter. Mais en pratiquant de l’obstination déraisonnable, c'est souvent soi même que l'on protège. Il faut admettre qu’en agissant ainsi nous générons parfois nous mêmes des demandes d'euthanasie. Sachons-nous remettre en question.
En appliquant avec intelligence et humanité la loi dite « Leonetti », nous pouvons montrer à l’Europe que le choix fait en 2005 a été le bon pour notre société et proposer que cet exemple soit suivi au nom des valeurs éthiques et de solidarité auxquelles nous sommes fondamentalement attachés.
 haut de page
haut de page
 Service public hospitalier : exigences de solidarité
Service public hospitalier : exigences de solidarité
Pierre Mary
Chirurgien orthopédiste, Hôpital Trousseau, AP-HP
A l’origine, la mission de l’hôpital était d’accueillir les plus démunis. Le formidable développement de la médecine fait que dans l’esprit de chacun, le but essentiel maintenant, est de soigner les patients et tous, sans exclusion.
L’hôpital public coûte cher, et il est légitime de chercher à en diminuer la charge qui pèse sur chacun des contribuables. La tarification à l’acte qui consiste à financer les hôpitaux en fonction des actes réalisés est sûrement un élément qui a permis de modifier les pratiques et de diminuer le coût des soins. Mais ceci est totalement insuffisant pour en évaluer l’efficacité réelle. Il est absolument indispensable de créer des indicateurs de qualité des soins. Ceci nécessite de faire participer l’ensemble de la société civile à ce débat.
Parallèlement et assez récemment le système de santé privé a été repris par des grands groupes financiers qui n’avaient aucun lien avec la santé, mais qui ont compris qu’il y avait une possibilité de gagner de l’argent avec certaines activités. Ces groupes ont alors sélectionnés les actes lucratifs. Dans ces conditions, les patients qui réclament des soins couteux n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers l’hôpital public. Entendre dire maintenant qu’il faut que l’hôpital public s’aligne sur le privé relève soit d’une méconnaissance totale des faits, soit, plus grave d’une grande hypocrisie. L’hôpital public et les cliniques privées ne traitent pas les mêmes patients. Aucune clinique n’est prête à prendre en charge un polyhandicapé, une tumeur osseuse maligne chez un enfant.
Si on demande à l’hôpital public de prendre en charge les pathologies non rentables, d’assurer les urgences 24 heures sur 24, et en même temps de former les futurs acteurs de la santé, il faut accepter qu’il ne soit pas rentable. La mission de service public de l’hôpital et des soignants est de soigner, d’aider les plus lourdement affectés, les démunis. Une société qui ne répond plus à ses exigences de solidarité est une société qui évolue insidieusement vers la barbarie.
 haut de page
haut de page
 Reconnaître l’autre
Reconnaître l’autre
Elisabeth G. Sledziewski
Philosophe, maître de conférences de science politique à l'Université de Strasbourg (Institut d'Études Politiques)
Au cœur de la réflexion éthique sur le polyhandicap, la question de l'autre, de l'identité de l'autre, le mystère de l'altérité. Celui qui est privé des attributs dont je dispose pour penser, bouger, communiquer, m'interpelle à l'endroit de sa différence et de mon impossible indifférence. Comment peut-il être mon semblable, et moi son prochain ? A l'inverse, comment puis-je être loin de lui alors qu'il a besoin de moi, bien plus impérieusement que ceux qui me ressemblent ? Qui est-il, que je suis et que je ne suis pas ? Quel être partageons-nous, quel partage se fait entre nos existences si distinctes ? Toutes interrogations qui nous renvoient à une figure centrale complexe, tout à la fois éthique et cognitive : celle de la reconnaissance de l'autre. Cette reconnaissance synthétise plusieurs opérations, dont moi et l'autre sommes tour à tour sujet et objet, et dont notre commune humanité est l'enjeu.
Reconnaissance
Quelques remarques préliminaires s'imposent sur le mot, pour baliser son champ de signification, y partir donc... en reconnaissance.
Dans son spectre sémantique, la notion de reconnaissance peut dénoter : un but visé (signe de reconnaissance, lutte pour la reconnaissance), des moyens de l'atteindre (envoyer en reconnaissance), une opération mentale et sociale (reconnaissance de théâtre, reconnaissance de dette) et enfin une attitude psycho-morale (être, se montrer, savoir se montrer reconnaissant).
La reconnaissance de l'autre, en somme, c'est compliqué parce que c'est tout cela à la fois : une démarche en plusieurs temps, et aussi une démarche à plusieurs... comme peut l'être une danse, corps-à-corps ou chorégraphie où chacun, quel qu'il soit, a une partie à jouer.
Qu'on reconnaisse ou qu'on soit reconnaissant, cela suppose en effet d'être à plusieurs. Car ce dont on est reconnaissant, c'est non seulement d'un bienfait, mais de ce qui a rendu possible son attribution : on est reconnaissant d'avoir été reconnu. Reconnaître qu'on a été reconnu, c'est même l'essence de la reconnaissance. Elle vaut pour le bénéficiaire comme pour l'auteur du bienfait, et les engage réciproquement en tant que sujets. Reconnaître l'autre et se reconnaître soi-même comme sujet sont une seule et même démarche. La découverte que pour être vraiment sujet, il me faut reconnaître l'autre comme autrui, me faire reconnaître de lui, me reconnaître moi-même comme capable de nouer les fils de cet échange en m'ouvrant, d'un seul geste, à ce qui est moi et à ce qui n'est pas moi.
C'est cette symétrie dynamique de la reconnaissance que formule si bien le poète mexicain Octavio Paz dans ces vers de Piedra de sol, véritable credo d'une métaphysique de l'altérité :
« Para que pueda ser, he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo,
siempre somos nosotros. »
« Pour pouvoir être, je dois être autre,
sortir de moi, me chercher parmi les autres,
les autres qui ne sont pas si moi je n'existe pas,
les autres qui me donnent pleine existence,
je ne suis pas, il n'y a pas de je, nous sommes toujours nous autres. »
La surprise de l’altérité
« Me chercher parmi les autres », dit le poète. Mais chercher l'autre, aussi. Le débusquer, suggère l'espagnol, et donc faire un effort pour le trouver.
Parce que l'autre est caché comme tel : il ne révèle pas d'emblée l'altérité qu'il porte, l'autrui qu'il est vraiment.
C'est le ressort des scènes de reconnaissance au théâtre, ces dénouements un peu faciles que le goût moderne méprise... mais qui procurent tant de joie au spectateur. Pensons par exemple à l'avant-dernière scène de L'Avare de Molière :
« Mariane : tout ce que vous dites me fait connoître clairement que vous êtes mon frère.
Valère : Vous ma sœur ? (...)
Le seigneur Anselme :Oui, ma fille, oui, mon fils, je suis dom Thomas d'Alburcy, que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu' il portait, et qui vous ayant tous crus morts durant plus de seize ans (...) »
Que nous enseigne ce coup de théâtre, sous ses dehors convenus ? D'une part que celui qu'on reconnaît nous permet de nous reconnaître nous-même, nous révèle qui nous sommes en nous révélant qui il est. D'autre part, que celui qu'on reconnaît est forcément riche, dans la comédie parce que c'est bien utile au happy end, mais également dans la vraie vie, au sens où les efforts de chacun pour reconnaître et se faire reconnaître doivent, à un moment ou à un autre, être payés. A l'instar de Mariane et de Valère, nous finissons toujours par découvrir en l'autre un trésor insoupçonné, qui va nous assurer identité, liberté et fortune. La profondeur de cette vérité éthique est sans doute elle-même le trésor insoupçonné du plus éculé des poncifs théâtraux !
L’autre : homme et non loup
Si la reconnaissance de l'autre est une découverte, une surprise tellement bouleversante qu'elle a des airs de deus ex machina, c'est que la vie sociale et psychique multiplie les obstacles qui m'empêchent d'accéder à son altérité, et du même coup, à ma propre identité de sujet, d'être en relation, d'obligé d'autrui. Ces obstacles, ces écrans opaques entre moi et l'autre, nul ne les a mieux mis en relief que le philosophe anglais Hobbes, comme Molière homme d'un XVIIe siècle qui médite sur la nudité de l'individu, et fondateur de la théorie du contrat. Pour l'auteur du Léviathan, l'homme se fait connaître à son semblable sous les traits d'un ennemi, d'un semblable menaçant qui n'est pas son prochain mais son rival. D'où la fameuse formule, « Man to Man is an arrant Wolf », que Hobbes va chercher dans une pièce oubliée du grand auteur comique latin Plaute : « lupus est homo homini », « l'homme est un loup pour l'homme. »
Mais que veut dire au juste cette réplique de l'Asinaria ? Non pas que les hommes sont féroces et condamnés à s'entre-dévorer, ce qui serait du reste totalement injuste à l'égard des loups, animaux à la solidarité exemplaire, mais qu'au premier abord, on ne peut faire confiance à un inconnu, et que tout individu qui en approche un autre peut être présumé hostile par celui-ci. En d'autres termes, il n'y a pas de signal automatique de l'humanité et de l'altérité de l'autre, je ne sais pas a priori si l'individu que j'ai en face de moi est un homme, rien ne me dit que ce n'est pas un loup, un « loup errant » ajoute Hobbes, à savoir un loup affamé.
L'identité de l'autre comme être humain, partageant ma propre identité, est donc à reconnaître sous les traits peu engageants d'un être qui serait le négatif de moi-même. Celui que j'ai d'abord perçu comme un danger pour mon intégrité va au contraire se révéler, si j'en fais l'effort, un élément constitutif de sa mise en place, et donc un moment éthique essentiel de mon identité.
La reconnaissance de l'autre commence par un doute sur son humanité, c'est-à-dire par l'évaluation comparée des avantages de celle-ci et des ravages que causerait son manque. Je découvre l'autre quand je découvre que je ne veux pas de lui comme loup. De la même manière, le christianisme a voulu que, dans le dédoublement spéculaire de l'examen de conscience, le croyant qui se penche sur son propre salut se jauge initialement comme un être indigne et comme une menace pour ce salut. D'où cette injonction préalable à toute eucharistie : avant de célébrer le mystère qui nous unit comme corps du Christ, « reconnaissons que nous sommes pécheurs ».
Reconnaître l’autre comme mon semblable, mon frère
La reconnaissance du mystère de l'altérité est une reconnaissance entre frères. « Vous ma sœur ? » demande Valère. C'est bien toi, dis-je à celui que je découvre comme un autre moi-même, de même ascendance et de même génération. La reconnaissance est rappel à l'ordre de l'origine : l'origine humaine de l'autre, "c'est un homme" et non... un loup, mais également la propre origine du sujet, qui se sent renvoyé par l'autre à une humanité dont il lui faut se montrer digne. On pense à Primo Lévi qui, pour empêcher ses frères de déportation à Auschwitz de succomber au piège de la déshumanisation, cite les paroles d'Ulysse à ses compagnons dans l'Enfer de Dante : « considerate la vostra semenza », « considérez d'où vous êtes issus ».
Reconnaître l'autre n'est donc pas seulement lui faire une place à côté de soi, mais l'inscrire au cœur de son propre patrimoine d'espèce. Comme s'il s'agissait de tisser avec lui un lien d'alliance, pour à la fois réactiver une parenté immémoriale et fonder une nouvelle communauté de sens. Celle-ci concerne au premier chef le rapport d'homme à homme, de personne à personne, mais peut revêtir une extension plus large. Il s'esquisse en effet à ce niveau une dimension politique de la reconnaissance de l'autre, proche de la philia, de ce principe de bienveillance obligée dont Aristote fait une condition de la Cité.
Le philosophe allemand contemporain Axel Honneth, théoricien d'une « éthique de la reconnaissance » conçue pour résister à "la société du mépris", souligne l'importance de l'institution d'une "sphère de l'amour et de l'amitié", préalable à toute construction normative. Dans une approche qu'il veut post-métaphysique, mais non moins pénétrée des grands postulats de la philosophie humaniste du sujet, il place la découverte de l'altérité fondatrice à la clef de toute forme de confiance, en soi ou en la possibilité du vivre ensemble. Il donne ce faisant une postérité politique à l'équation posée il y a deux siècles par Hegel : « La conscience générale de soi est l’affirmative connaissance de soi-même dans l’autre moi. »
Dans une société soumise aux vertiges de l'hyperindividualisme et désormais tenue à mener une véritable lutte pour la confiance, la reconnaissance de l'autre peut être vue comme principe d'espérance généralisé.
 haut de page
haut de page
 Pour une défense des personnes porteuses de trisomie
Pour une défense des personnes porteuses de trisomie
Pierre Bétrémieux
Membre du conseil de vigilance de la Fédération des associations pour
adultes et jeunes handicapés
Les personnes en situation de handicap et leurs familles, manifesteront toujours une sensibilité très aiguë face à toute attitude de la société, facilitée par une pratique médicale – publique ou privée - qui tendrait à sélectionner, pour les éliminer, des personnes au prétexte qu’elles seront dotées d’une « vie qui ne mériterait pas d’être vécue ». Les membres d’une société ne devraient-ils pas s’inquiéter quand celle-ci finit par « acclimater » (1) la notion de sélection (et l’élimination ultérieure) des personnes – en devenir ou non – sur la base de l’utilité de la personne (2), et de son droit à vivre ?
Les états généraux de la bioéthique fournissent l’occasion de revisiter le débat lancé début 2007 par Didier Sicard, alors Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), face au constat de la généralisation du dépistage prénatal (3). D. Sicard suggérait en effet, que la mise à disposition systématique d’une information sur l’état d’anormalité de l’embryon de l’enfant à naître, soumettait les parents à une pression telle qu’on assistait à une quasi-éradication de la trisomie 21.
La récente étude du Conseil d’État (4) consacrée à la révision de la loi de bioéthique a effectivement examiné cette problématique posée par la généralisation du dépistage prénatal. En notant que le nombre d’interruptions médicales de grossesse reste relativement faible en France (environ 6000 en 2004), et stable au cours du temps, le Conseil d’État considère qu’actuellement le risque d’une dérive eugénique n’apparaît pas. Le Conseil d’État souligne néanmoins que le cas de la trisomie 21 « appelle à la vigilance » (5): on observe en France « une pratique individuelle d’élimination systématique des fœtus porteurs de trisomie 21 » (6).
De quoi parle-t-on ?
Le Diagnostic Prénatal permet de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection grave. Ce sont, par exemple l’échographie ou l’amniocentèse. Le diagnostic est issu du « colloque singulier entre un médecin et un couple » (7). En revanche le dépistage relève d’un approche collective correspondant à une « problématique de santé publique », Israël Nisand prend pour exemple les « programmes nationaux de détection de la trisomie 21 » (8).
Nous interroger sur ce phénomène de quasi-éradication de la trisomie 21 ne consiste pas à mettre en accusation les bénéfices des avancées de la biomédecine pour les femmes enceintes. Le but de cet essai est encore moins de stigmatiser les parents qui, détenteurs de l’information la plus pertinente et la plus objective, auront fait le choix, en toute liberté, de recourir à l’IMG.
Il s’agit plutôt, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, de poser à nouveaux frais cette question que l’histoire nous a appris à redouter :
Comment une société en arrive-t-elle à s’accoutumer à la sélection, puis à l’élimination d’une partie désignée de cette humanité qui la constitue ?
Car affirmons-le avec force, les personnes porteuses de trisomie 21 font partie de notre humanité : elles mènent une vie au travers de laquelle elles trouvent leur épanouissement grâce à leur gentillesse, leur gaîté et leur sociabilité au sein d’une société qui a fini par leur faire une place, même si des progrès restent à accomplir (9).
Pourquoi ne pourrait-on pas alors s’inquiéter, en tant que membres d’associations qui défendent le droit à la citoyenneté et à l’égalité des personnes en situation de handicap, du sort fatal réservé pratiquement à tous ces futurs hommes et femmes, porteurs de trisomie 21, au prétexte que leur qualité de vie serait peut-être insatisfaisante ou qu’ils seront une charge pour la société ? L’histoire nous a appris à craindre cette banalisation de la mise à l’écart de catégories d’individus suivie de leur élimination en leur accordant une « mort miséricordieuse » (10). En évitant tout amalgame qui serait contreproductif dans ce débat, veillons à ce que notre société ne perde pas le sens de la solidarité et ne soit pas amenée à remettre en question le droit à exister, en son sein, pour des individus déficients, vulnérables ou désignés comme représentant une charge pour la société (11).
Par la mise en place des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et par la définition d’un cadre législatif en accord avec les avis du CCNE, on peut rendre justice à la puissance publique d’avoir formalisé l’encadrement du dépistage prénatal.
Interpellés pour justifier ce dépistage systématique conduisant à une quasi-éradication de la trisomie 21, certains représentants de la biomédecine avancent cependant les arguments suivants :
- réduction voire suppression de la souffrance ;
- gain économique dont bénéficierait la société ;
- accueil très insuffisant des personnes en situation de handicap dans notre société ;
- respect de la liberté des individus (cadre légaliste de l’information de la femme enceinte qui la conduirait à prendre une décision en toute liberté).
Cette argumentation est illustrée par les réponses suscitées par l’intervention de Didier Sicard qui laissait à penser que par la minoration volontaire du nombre des individus porteurs de déficience génétique, le problème de l’accueil des personnes en situation de handicap, déjà soulevé par le CCNE lors de l’affaire Perruche (12) en 2001, trouverait une solution potentielle :
« [….] dans la très grande majorité des cas, le dépistage prénatal n’est pas destiné à traiter mais bien à supprimer [….] dans le cas des trisomies 21 et 18, tout s’est passé comme si à un moment donné la science avait cédé à la société le droit d’établir que la venue au monde de certains enfants était devenue collectivement non souhaitée, non souhaitable. Et les parents qui désireraient la naissance de ces enfants doivent, outre la souffrance associée à ce handicap, s’exposer au regard de la communauté et à une forme de cruauté sociale née du fait qu’ils n’ont pas accepté la proposition faite par la science et entérinée par la loi […] il n’y a pas de vraie pensée mais la recherche constante d’une optimisation. (13)»
De quelle souffrance parle-t-on ?
Dans leur quotidien, les personnes porteuses de trisomie 21 connaissent les maux de toute existence humaine en bénéficiant de soins médicaux adéquats et exprimeront toutes leurs capacités par des sollicitations précoces et adaptées. La souffrance le plus souvent mise en avant est bien celle des parents. Cette souffrance est celle de membres d’une société qui leur impose des normes de perfection et auxquels on présente le scénario le plus pessimiste. C’est ce que confirment les témoignages de professionnels de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, cités en réponse (14) à l’article de D. Sicard :
« En cas de trisomie 21, la majorité des couples demandent une IMG […] je ne me vois imposer aux autres ce que la société a du mal à accepter… avant de parler de dérive, il faut déjà balayer devant sa porte et s’occuper correctement des personnes handicapées. L’éthique, l’éthique… il faut avoir les couples en face de soi, pour comprendre. Ma manière à moi de faire de l’éthique, c’est de soutenir les couples au quotidien. »
Jacques Milliez soulignait déjà, que pour l’enfant à naître, c’est lui éviter des souffrances inacceptables, incurables, et pour les parents, c’est leur épargner « le calvaire, le fardeau insupportable, la blessure irréversible de leur enfant » (15). Mais dans le cas de la trisomie 21, peut-on suivre J. Milliez quand il soutient que ce processus de dépistage prénatal - systématisé - correspond à une « attitude compassionnelle, individuelle et consentie » et n’est en rien soumis aux directives d’une entreprise de santé publique, d’un programme économique ou politique meurtrier ?
La prévalence de la logique économique ?
Si Didier Sicard parle d’optimisation, Israël Nisand de son côté considère que la logique médicale de dépistage prénatal (de la trisomie 21 pour exemple) « rejoint la logique économique qui consiste à éviter les naissances d’enfants atteints d’un handicap » (16). Dans une tribune du Monde de mars 2007, en réponse à D. Sicard deux généticiens ayant une « longue pratique du dépistage et du diagnostic prénatal » accordent certes un satisfecit aux efforts faits pour accueillir les sujets porteurs de handicap (loi du 11 février 2005) mais ensuite font valoir un principe de réalité : « S’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, il est clair que la diminution du nombre des sujets atteints ne peut nuire à leur prise en charge par la collectivité » (17). Récemment l’argument économique a été à nouveau mentionné dans le cadre des états généraux de la bioéthique, au cours d’une présentation le 29 avril dernier à l’Académie Nationale de Médecine - « le dépistage des maladies génétiques en population » (18) - qui plaçait la société au nombre des bénéficiaires du dépistage grâce à « l’évitement des cas, la diminution des coûts de santé et la rentabilité du dépistage de la trisomie 21 » (19).
Un déficit dans l’accueil des personnes en situation de handicap ?
Si la perfection n’est pas atteinte en ce domaine, d’énormes progrès ont été accomplis au travers de la solidarité nationale pour intégrer, accompagner, apporter les compensations nécessaires aux personnes en situation de handicap ; à commencer par le dispositif de scolarisation dont elles bénéficient de plein droit depuis la loi du 11 février 2005. En présentant la seule vision pessimiste de l’inclusion des personnes handicapées dans notre société lors de l’annonce faite aux parents d’une malformation du fœtus, la médecine n’induit-elle pas leur choix dit « libre et éclairé » consistant à éviter la naissance d’un enfant dont « la vie ne méritera pas d’être vécue » ? À partir de quelles données objectives de telles opinions peuvent-elles être maintenues ? Même si une réalité sociétale ne se traduit pas uniquement par des chiffres, ce serait faire injure à l’expression de la solidarité nationale et à l’engagement de tous ceux qui l’accompagnent, pouvoirs publics, associations et professionnels du secteur médico-social, que de ne pas rappeler l’effort considérable accompli en ce domaine. Qu’il reste beaucoup à faire en ce domaine, les associations de défense des personnes handicapées (20) ne manquent jamais de le rappeler et n’ont pas apporté leur totale adhésion au récent bilan chiffré de l’application de la Loi du 11 février 2005 quatre ans après sa promulgation (21).
Un consentement libre et éclairé des parents ?
Les représentants de la biomédecine ne sous-estiment pas les tensions éthiques créées par les progrès accomplis dans le dépistage des maladies génétiques (22) et nous affirment agir conformément aux principes de l’éthique procédurale de la médecine (23) (principes d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice). Est-ce pour autant que les parents, dans ce moment de sidération qu’ils vivent à l’annonce du handicap du bébé à naître, seront conscients d’être conduits à prendre une décision libre et éclairée dans le cadre légal de la procédure d’information (art. R. 2131-2 du Code de la santé publique de décembre 2006).
Certes le principe de décision éclairée est affirmé par le dispositif réglementaire qui encadre le dépistage de la trisomie 21, mais une étude récente de deux chercheurs français (24) communiquée par l’INSERM (25) émet des réserves sur la pleine conscience qu’auraient les femmes enceintes sur le processus de dépistage dans lequel elles s’engagent. Ces chercheurs recommandent que les phases successives du dépistage de la trisomie 21 (échographie, tests par marqueurs sériques, amniocentèse) soient accompagnées par une information adaptée. Celle-ci devrait aider les parents à mieux prendre conscience de la décision qu’implique le dépistage, à savoir la poursuite ou l'arrêt de la grossesse. Cette étude souligne que les femmes enceintes comprennent que les prises de décision relatives à leur suivi de grossesse sont du ressort du médecin, mais s’interroge en revanche sur la conscience qu'elles peuvent avoir des implications potentielles de la succession des tests de diagnostic anténatal : on ne saurait donc condamner leur attitude, mais faire en sorte d'accompagner le dépistage par une information adaptée leur permettant des prises de décision en accord avec leurs valeurs.
Un questionnement qui reste ouvert
On peut en effet s’interroger sur la validité d’un consentement (26) éclairé débouchant sur une prise de décision autonome quand des professionnels de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal signifient aux parents que la prise en charge du handicap sera problématique d’une part et quand d’autre part les experts de la biomédecine ne semblent opposer aucune option thérapeutique (27) au diagnostic prénatal de trisomie 21.
Ne faut-il pas accorder une place plus grande à des représentants de familles d’enfants trisomiques lors de cette phase si capitale d’information des parents confrontés à une prise de décision si douloureuse ? En effet ces familles, au sein d’associations très actives, initiatrices de programmes de recherche visant à améliorer la qualité de vie quotidienne et à compenser les déficits cognitifs des personnes porteuses de trisomie 21, sont à même d’apporter informations et conseils pour l’éventuel accueil de cet enfant porteur de trisomie : ils pourront ainsi témoigner, sans minimiser la forte implication personnelle des parents et les difficultés qu’ils auront à affronter, qu’une place peut être offerte à cet enfant au sein de sa famille et de la société.
Dans cette perspective, on ne peut qu’espérer que la recommandation du Conseil d’État (28) soit prise en compte dans les décrets de révision de la Loi de bioéthique (à savoir que l’article R. 2131-2, évoqué ci-dessus prenne mieux en compte ce déficit d’information et d’accompagnement des femmes enceintes et mette davantage en valeur les actions de conseil lors de l’annonce d’une anomalie).
Au terme d’un parcours qui visait à approfondir la problématique de la question initiale – à savoir « Comment une société en arrive-t-elle à s’accoutumer à la sélection, puis à l’élimination d’une partie désignée de cette humanité qui la constitue ? », les enjeux rencontrés ont été à la fois de nature sociétale et biomédicale, rejoignant ainsi la remarque de Claude Levi-Strauss (29) qui soulignait que nos sociétés tentent de surmonter, parfois dans la confusion, la frontière qu’elles ont marquée entre le biologique et le social au milieu du XXe siècle.
Pour la biomédecine, au regard de la proposition de sélection que peut impliquer un diagnostic prénatal létal, les propos de Thomas Huxley, promoteur de la théorie de Darwin, restent d’actualité : « Le progrès éthique de la société ne consiste pas à imiter les lois de la nature, encore moins à leur échapper, mais à les combattre (30).
Pour les membres de la société, l’attitude face à l’annonce du handicap d’un enfant à naître reste un choix éthique personnel qu’aucune législation ne viendra contribuer à résoudre ; l’acceptation de prendre en compte la vulnérabilité d’un autre être humain, à venir ou déjà présent, se situe au premier chef au sein de la cellule familiale comme le rappelle Kenzaburô Ôé, prix Nobel de littérature : « c’est seulement parce que nous avons inclus Hikari (le fils handicapé de l’auteur) dans la famille que nous avons réussi à surmonter nos diverses crises, comme le déclin mental progressif de ma belle-mère….je me suis aperçu à quel point étaient mêlés les problèmes de l’acceptation privée et de l’acceptation publique des handicapés …une société qui exclut une partie d’elle-même peut être considérée comme faible et fragile. » (31)
Référénces :
(1) Henri Atlan, Marc Auge, Mireille. Delmas-Marty, Roger-Pol Droit et Nadine Fresco, Le clonage humain, Paris, Le Seuil, Paris, 1999, p. 191. La bioéthique joue, selon la formule de Nadine Fresco, le rôle d’un « jardin d’acclimatation » : elle permet, au nom de l’éthique et des promesses de la science, et sous couvert de garanties purement procédurales, de rendre acceptable ce qui hier encore était jugé moralement inacceptable.
(2) Elie Wiesel, La nuit, Paris, Les Editions de Minuit, 1958 p. 118.
(3) Didier Sicard, « La France au risque de l’eugénisme », Le Monde, 5 février 2007, p. 14.
(4) Étude du Conseil d’État de la révision des lois de bioéthique, mai 2009, (http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/rapport2009/Etude-bioéthique.pdf)
(5) Étude du Conseil d’État de la révision des lois de bioéthique, p. 30.
(6) Ibid. : « en France, 92 % des cas de trisomie sont détectés contre 70 % en moyenne européenne, et 96 % des cas ainsi détectés donnent lieu à une interruption de grossesse ».
(7)Israël Nisand, Sophie Marinopoulos, 9 MOIS et caetera, Paris, Fayard, 2007, p. 173.
(8) Israël Nisand, Sophie Marinopoulos, op. cit., p. 174.
(9) Jason Kingsley & Mitchell Levitz , Count Us In - Growing Up With Down Syndrome, New-York, Harcourt, 2007, 198 pages.
(10) Alice Ricciardi Von Platen, L’extermination des malades mentaux dans l’Allemagne nazie, Editions Érès, 1948, 2001.
(11) Lors des grandes vagues d’immigration aux Etats-Unis, à la fin du XIX° et au début du XXe siècle, les candidats à l’immigration sélectionnés comme « LPC » - à savoir Liable to become a Public Charge i.e. susceptibles de devenir une charge à la société - étaient refoulés vers leur pays d’origine. Ces personnes étaient en effet considérées comme « incapables de travailler ou de subvenir à leurs besoins par elles-mêmes » (musée de Ellis Island).
(12) Avis n° 68, CCNE, 29 mai 2001.
(13) Didier Sicard, « La France au risque de l’eugénisme », Le Monde, 5 février 2007, p. 14.
(14) Sandrine Blanchard , « Naître ou ne pas naître », Le Monde, 1ier avril 2007.
(15) Jacques Milliez, L’euthanasie du fœtus, Médecine ou eugénisme ?, Paris, Odile Jacob, p. 151.
(16) Israël Nisand & Sophie Marinopoulos, 9 MOIS et caetera, Paris, Fayard, 2007, p.175.
(17) Pierre Leymarie et Nathalie Leporrier, « L’eugénisme en France, un mythe sans fondement », Le Monde , 3 mars 2007.
(18) http://www.espace-ethique.org/doc2009/Ayme_academie_medecine_290409.pdf
(19) http://www.espace-ethique.org/doc2009/Ayme_academie_medecine_290409.pdf - diapositive n°24.
(20) Sans vouloir exhaustif, rappelons que l’accompagnement des personnes trisomiques fait partie des objectifs de prise en charge des personnes en situation de handicap des grandes associations comme l’APAJH ou l’UNAPEI, et plus spécifiquement les associations Trisomie 21 France (ex-Fait 21) ou l’AFRT (Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21) portent leur effort pour conseiller et aider les personnes trisomiques et leurs familles.
(21) http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DP_loi_handicap_4_ans_apres.pdf
(22) http://www.espace-ethique.org/doc2009/Ayme_academie_medecine_290409.pdf - diapositives n° 30 à 36.
(23) Pierre Leymarie et Nathalie Leporrier, « L’eugénisme en France, un mythe sans fondement », Le Monde, 3 mars 2007.
(24) Valérie Seror, chargée de recherche dans l'Unité Inserm 912 et Yves Ville, chef du service de gynécologie-obstétrique du CHE Necker-Enfants Malades.
(25) http://www.inserm.fr/fr/presse/communiques/att00008943/seror_70109.pdf
(26) Michela Marzano, Je consens donc je suis, Paris, PUF, 2006, p. 75.
(27) Jean Gayon, Daniel Jacobi, L’éternel retour de l’eugénisme, Paris, PUF, 2006, p. 89.
(28) http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/rapport2009/Etude-bioéthique.pdf (p. 30 & 31).
(29) Cf. revue « L’Homme », Paris, Editions EHESS, 2006.
(30) Thomas Huxley (1893), Evolution and Ethics, The Romane Lecture.
(31) Kenzaburo Ôé, Une famille en voie de guérison, Paris, Gallimard, 1998, p. 111 sq.
 haut de page
haut de page