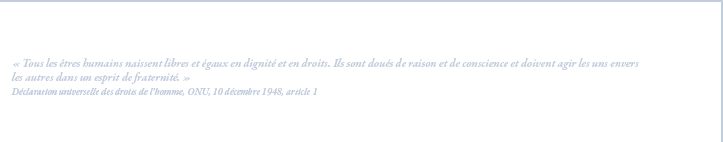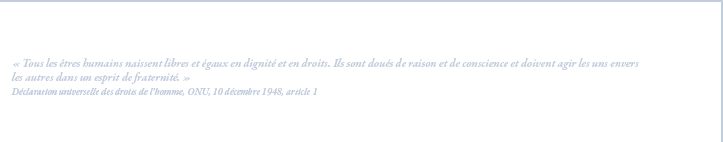|
 Témoignages Témoignages
|
Sommaire
Michel Belot
Corinne Devos
Valérie Chmielewski
Gabriel Gomis
Véronique Vasseur
Simone Bevan
Agnès Contat
Yvon Sinou
Martine Laurent
Philippe Être
Laurence Deseigne
 Notes sur le souci d’autrui. Limites de l’engagement : empathie, attachement Notes sur le souci d’autrui. Limites de l’engagement : empathie, attachement
Michel Belot
Psychologue, MAS, Lannemezan
A la suite du séminaire organisé par l’Espace éthique/AP-HP avec le Groupe polyhandicap France (GPE), Michel Belot nous a présenté cette réflexion d’une haute valeur éthique.
Souci d’autrui, souci de l’autre : Autre, autrui : Quelles distinctions ?
Traditionnellement, la philosophie fait une nette distinction entre autre et autrui.
Reprenons ces définitions pour mieux cerner de qui on parle.
Autre : c’est une personne, comme moi. Autre vient du grec « allasein »: échanger et d’ « Alius », en latin l’autre parmi plusieurs.
L’altérité d’autrui (l’autre ici présent) est un autre soi-même. L’autre est le contraire, l’opposé du même.
Autrui : tout homme qui est à la fois semblable à moi (nous partageons la même condition humaine) et autre que moi. Certains font d’autrui le synonyme d’alter ego. Pour E. Levinas, autrui est tout autre, sacré, qui ne correspond pas à ce que j’attends. Autrui n’est pas seulement l’alter ego. Pour Levinas, autrui est « ce moi que je ne suis pas ». C’est un moi autre. C’est le prochain possible et encore indéterminé : Objet non d’amour (comment aimer n’importe qui?) mais de respect.
Autrui, c’est l’autre « assuré », la rencontre d’un visage qui à la fois se donne et se dérobe ».
Autrui est ce qui est différent de moi, ce que je ne peux pas connaître totalement à cause de ma subjectivité - qui n’est pas celle d’autrui.
La charge du souci
Le souci : une préoccupation, un poids, une charge.
L’autre n’est pas seulement une question extérieure à nous, en terme de distance. C’est aussi une charge, un poids que nous pouvons assumer, dans certaines limites. Lorsque ces limites sont atteintes, c’est une rupture, une cassure, un lâchage. On est loin de la fusion qui est une tentative de soutien, d’étayage pour éviter la chute avec l’autre.
Continuons à distinguer distance et charge. Les unités de mesure ne sont pas les mêmes. La théorie de la proxémie est souvent présentée pour signifier aux professionnels de mettre une distance en eux et l’autre. Eviter la fusion, permettre à l’autre d’exister pour « lui-même » et autres poncifs psychologiques. Cela peut aider mais aussi cristalliser les pratiques professionnelles, limiter leur qualité et leur créativité. La mise à distance conduit à l’exclusion.
Peut-on exclure l’autre par la mise à distance ? On rapporte souvent, et avec raison, les ravages du discours médical des années 1950-1980 tenu aux parents des enfants lourdement handicapés : « Oubliez-le…, placez-le…, coupez avec lui et passez à autre chose… » L’oubli de l’autre au profit du souci de soi. Un épanouissement de soi en voulant occulter l’autre. Bien sûr, cela n’a pas marché comme prévu ainsi. Les parents témoignent, trente ou quarante ans après de l’extrême et insoluble culpabilité engendrée par l’impasse de cette injonction.
Notons que ce conseil était donné pour aider les familles, pour leur bien.
Prendre du recul, de la distance ne permet pas d’évacuer la question de la culpabilité. « Loin des yeux, loin du cœur » est pas si simple à vivre lorsque l’amour s’en mêle. La distance physique n’est pas la « proximité mentale ». Au contraire, la distance augmente l’inquiétude, le sentiment d’impuissance, d’inaction, les scénarii les plus terribles. C’est une véritable machine à fantasme.
Les familles n’ont pas besoin de prendre du recul mais ont besoin de forces pour soutenir la nouvelle charge dont ils se sentent toujours responsables. On peut substituer « être à distance » par « être fort ».
Quelques formes du « « souci d’autrui »
Le souci est une préoccupation, quotidienne, envahissante lorsqu’elle est teintée d’anxiété, d’insécurité ou d’angoisse.
Le souci : il est aussi le nôtre, celui d’exister et d’être plongé dans les difficultés de l’existence (1). Le souci est d’abord notre souci puis le souci de l’autre.
Le souci est compréhension, empathie : Sympathie et compassion on la même racine : souffrir avec, en grec ou en latin. Les distinguer est-il vraiment utile ? Gardons seulement la notion de « souffrir avec » (2).
L’empathie est la sympathie, la résonance affective et émotionnelle que le professionnel va restituer à la personne. Lorsque l’autre devient radicalement autre, l’empathie est impossible. L’identification au trait, à la qualité de l’autre n’opère plus. Nous sommes incapables de nous mettre à leur place.
C’est le souci de « l’expression d’autrui » - en tant qu’autre différent de moi. L’autre différent de moi, c’est peut être une façon de reprendre l’autonomie avec une autre valeur: Si l’autonomie est créer ses propres lois, c’est aussi respecter les lois de l’autre.
Le souci de l’autre se manifeste par « être attentif, attentionné, respectueux » de l’autre. C’est la dimension de sollicitude qui s’exprime par exemple dans le nursing, le soin de base.
C’est faire exister l’autre dans le souci de respecter ses besoins.
Quelles réponses au « souci d’autrui » ?
On peut attendre des professionnels, une ou des réponses à ce « souci d’autrui ».
On examinera trois types de réponses, mais il y en a sûrement beaucoup d’autres :
1. Vivre le présent
2. L’oubli de soi pour mieux prendre en compte le souci d’autrui
3. L’apaisement
1. Vivre le présent
Le souci: ce qui projette la personne dans un monde souvent inconnu et menaçant. Ici, la personne ayant un polyhandicap, la famille et les professionnels peuvent vivre cette anxiété.
Pour les familles; le souci est beaucoup plus présent. C’est un signal d’alerte devant la difficulté d’anticiper l’avenir, le court terme. L’anticipation d’une aggravation, d’une mauvaise nouvelle ? D’une répétition du traumatisme ? Une anticipation qui explique la position de certains parents : être sur le « qui vive », blessure qui n’a pas le temps de cicatriser, peur du lendemain, angoisse de la souffrance et de la mort.
Pour le professionnel, la confrontation au polyhandicap est souvent difficile. Quels sont les besoins de la personne, et parfois comment y répondre? Ces questions ne sont pas simples.
La difficulté d’expression de personnes polyhandicapées nous confronte à une grande difficulté : La communication est limitée (non-verbale). Des moyens existe pour favoriser cette communication (aides techniques, communication basale…). Le plus difficile dans cette communication, ce sont nous questions qui restent sans réponses : As-tu mal, faim, soif ? De quoi as-tu envie ? Qu’est-ce que tu ressens ? Que suis-je pour toi ? Est-ce que tu apprécies ce que je fais pour toi? Est-ce que tu m’aimes ?
Nous devons anticiper les demandes de la personne. Nous nous efforçons dans un premier temps de bien l’observer, de la comprendre sans se précipiter nous-mêmes dans ce que nous croyons qu’elle ressent. Dans le langage familier des professionnels, on appelle cela : « ne pas projeter ». Une observation fine, dans les détails permet de mieux respecter la personne.
Les personnes polyhandicapées ont une capacité d’expression moins riche dans l’expression du détail, dans l’élaboration intellectuelle. C’est un sérieux handicap de ne pas avoir accès par la parole à la demande de l’autre, à l’expression de ses besoins et de ses désirs. C’est pour cela que nous préconisons de développer toute forme de communication : langage infra verbal, corporel, aides à la communication (pictogrammes, téléthèses…). C’est un handicap pour l’utilisation de la communication dans la vie pratique.
Cela explique également les difficultés de relation, de compréhension entre les professionnels : les différences d’interprétation, des lectures différentes de l’observation, la tendance à « trop parler à sa place »…
Nous avons des difficultés pour anticiper le souci de l’autre. Nous devons quand même faire des hypothèses, des suppositions, les mettre en œuvre et voir par les effets obtenus si nous étions dans la préoccupation de la personne.
Ainsi, on se réfère souvent à la classification des besoins selon Virginie Henderson ou similaires, que l’on retrouve dans la construction du projet individuel, pour balayer le champ des besoins de la personne.
Quel est son thème, son souci actuel ?
Préserver sa vie, sa survie, ressentir sa personne, ses limites, son corps, rechercher la sécurité, la confiance, se sentir soutenu, compris, trouver son propre rythme (nuit/ jour, activité /repos…), pouvoir exprimer un désir, pouvoir être en contact avec son environnement, avec les personnes, entrer en relation et y prendre une part active, comprendre le monde environnant (3), vivre l’autonomie et la responsabilisation (4).
Répondre à l’anxiété, à l’incertitude du souci d’autrui par une volonté de bien vivre le temps présent et de bien en profiter n’est pas une réponse facile à mettre en œuvre.
2. L’oubli de soi pour mieux prendre en compte le souci d’autrui
La plus fréquente surtout dans un premier temps est de compenser « le souci de l’autre » par un « oubli de soi ». L’oubli de soi permet de mieux répondre au souci de l’autre.
L’oubli de soi, comme première abnégation. Le monde offre au sujet la participation d’exister sous une forme de jouissance, lui permet par conséquent « d’exister ». ==> C’est oubli de soi est nécessaire, utile. Mais cela ne veut pas dire que le soi est absorbé par l’autre. Ce n’est pas une disparition du moi, mais un retrait, une mise à l’écart.
L’oubli est-il un retrait ? Oui si on se place de son propre point de vue : C’est faire une parenthèse de l’avenir proche, au service de l’autre.
C’est un oubli si on se place du point de vue de l’observateur. Ce qui donne les phrases que l’on entend souvent : quel courage, quel don de soi, vous êtes formidables !
Est-ce une mise entre parenthèse des velléités de notre moi, faire le sacrifice de notre existence ?
Si le mot « sacrifice » est trop fort et inadapté aux professionnels (les parents par contre fréquemment utilisent cette expression). Nous pouvons interpréter l’engagement dans des professions de santé ou d’éducation avec cette appétence à accompagner le souci de l’autre : Réparation, prendre soin, éduquer.
Pour le professionnel, nous pouvons repérer l’oubli de soi par exemple dans la nécessité de travailler en équipe. L’équipe permet de partager le travail, la charge. Mais l’équipe n’est pas propice à une reconnaissance et à un développement «personnel», «individuel». Les phénomènes de groupes, la complexité des organisations (structurées et hiérarchique) ne facilitent pas parfois l’épanouissement du personnel.
Nous pouvons aussi le repérer dans la nécessaire «interdisciplinarité», c’est à dire l’appropriation par chacun du savoir – et du savoir-faire - de tous les membres de l’équipe.
L’interdisciplinarité éloigne le professionnel de sa formation initiale qui n’est souvent pas assez spécialisée dans le polyhandicap. Or, le jeune professionnel est souvent intéressé pour appliquer ce qu’il vient d’apprendre à l’école d’éducateur, de psychomotricité… De même, lorsque la routine commencera à user un professionnel aguerri, il pourra avoir tendance à se cristalliser autour de revendication corporatiste : Pour sortir la tête de l’eau de l’équipe.
La revendication corporatiste naît parfois de ce besoin du professionnel d’être reconnu d’être pris en considération, qu’on se souci de lui.
Etre immergé dans l’équipe entraîne une déperdition de l’image de soi, un oubli de ses revendications du moi.
L’oubli de soi, pour la famille c’est plus évident. Pour tout parent, il y a une perte de soi, une rupture avec sa vie antérieure, une remise en cause de son indépendance lorsqu’on a un enfant.
Lorsque cet enfant a un handicap grave, le poids de la dépendance est sans commune mesure.
3. Souci et apaisement
Pour comprendre l’autre, pour mesurer ce qui nous sépare mais également ce qui nous permet de penser à propos de nous-mêmes, renoncer à soi ne suffit pas. L’oubli de soi ne peut être qu’une phase, un moment. S’il s’installe dans la durée, une grande souffrance va se développer. Nous avons vu que le souci de l’autre est lié au souci de soi. On peut dire qu’il se transmet comme l’anxiété qui passe de l’un à l’autre. L’apaisement passe par un réinvestissement de soi : s’occuper de soi aide à s’occuper de l’autre.
Transformer le souci en apaisement est certainement une de nos tâches de professionnels. Apaiser la personne polyhandicapée; Apaiser sa famille.
Conclusion
Il est difficile de respecter l’autre, notamment dans sa dimension d’autrui, avec sa part cachée, inaccessible. Nous préconisons de ne pas chercher la révélation qu’autrui pourrait nous faire,
Nous devons admettre qu’il est complètement autre et que notre lien n’est pas un lien de connaissance. Qu’est-ce que connaître quelqu’un ? Ce n’est pas une vérité, un savoir qui peut se révéler.
Bien sûr nous avons peu d’accès à l’expression la vie intérieure de la personne. Nous pouvons observer des changements d’humeur, des manifestations que nous rattachons aux émotions…
L’essentiel de la personne le plus souvent nous échappe. Cela n’est pas particulier aux personnes ayant un handicap profond, notamment de communication. On aurait tord d’en faire une particularité de la personne polyhandicapée. Dans toute histoire d’amour, d’amitié entre être humains, tout ne peut pas se dire ou être compris (5).
Le souci d’autrui demande toujours une perte de soi, un éloignement de nous-mêmes pour justement accueillir la présence de l’autre, présence insistante, envahissante dans les moments graves, dans les crises.
Références
(1) D’ou l’expression d’une culpabilité. La culpabilité n’est pas seulement « je me sens coupable de… » ou avoir le regret : « j’aurai du… ». Il y a une grande culpabilité derrière le discours sur la responsabilité. Mais la responsabilité n’est pas le versant positif de la culpabilité. On ne passe de l’un à l’autre. Comment dépasser la culpabilité ? Celle–ci est initiale, inhérente à notre civilisation et apparaît dans les situations traumatisantes et douloureuses.
(2) La sympathie est une contagion affective, la transmission d’une émotion d’un individu à un autre individu (Hume). Adams Smith considèrera la sympathie comme une substitution imaginaire à l’autre. Carl Rogers proposera aux professionnels qui utilisent les entretiens (non-directifs) le terme d’empathie.
(3) Avant d’être un système d’outil, le monde est un ensemble de nourriture. La vie d’un homme dans le monde ne va pas au-delà des objets qui le remplisse.
(4) Ces points sont particulièrement développés par Andreas Fröhlich et l’approche de la stimulation basale.
(5) Philia : « se réjouir de l’existence d’autrui ». Philia est traduit par « amitié », avec un sens précis. C’est une forme du lien social analysé par Aristote. Philia est l’amour absolu, fraternel, qui fait que nous aimons un être pour ce qu’il est et non pour ce qu’il peut nous apporter.
 Attentes de la personne expert et acteur de sa maladie Attentes de la personne expert et acteur de sa maladie
Corinne Devos
Bénévole représentant la région Ile-de-France, Association François Aupetit
www.afa.asso.fr
J’apporte mon témoignage, en tant que malade, s’agissant de mes attentes dans ma relation avec mon médecin et aux réponses que celui-ci a su ou non m’apporter.
Je peux dire aujourd’hui qu’il y a globalement adéquation entre ce que j’attends et la réponse qui m’est donnée mais c’est le mot « globalement » qui donne tout le sens au propos.
Ainsi, si le médecin répond le plus souvent à mes attentes sur un plan médical et technique, le bilan est plus mitigé dès que l’entretien sort du contexte strictement organique et en l’espèce, intestinal, ma pathologie étant une maladie de Crohn diagnostiquée il y a 8 ans alors que j’avais 36 ans.
Alors qu’est ce que j’attends de mon médecin en tant que malade ?
Un vrai partenariat qui fonctionne pour moi autour de quelques mots-clés
• Une information juste
• Une disponibilité réelle
• Une prise en charge humaine et personnalisée
• L’assurance que le gastroentérologue saura quand il ne sait pas ou plus
Et un partenariat de confiance car s’agissant d’une maladie chronique, la route va être longue entre mon gastroentérologue et moi.
• J’attends une information juste, c'est-à-dire adaptée, utile et accessible pour moi et délivrée au bon moment.
Une information adaptée et utile, c’est essentiel, car si l’absence d’information est terriblement anxiogène, un trop plein d’information peut l’être tout autant.
J’attends de mon médecin une information sur la maladie elle-même et son évolution possible, sur les traitements, leurs délais d’action, leurs effets secondaires, sur le suivi et les examens qui vont être pratiqués.
Une information accessible, c'est-à-dire exprimée avec des termes qui me « parlent ».
Je n’attends pas une information nécessairement exhaustive, mais une information qui m’éclaire et m’aide. Pour illustrer, si je prends l’information sur un traitement, je n’attends pas que me soient listés tous les effets secondaires possibles, d’abord parce qu’ils figurent sur la notice et ensuite, parce que je ne voudrais pas me les « créer ». En revanche, j’attends que mon attention soit alertée sur l’effet secondaire qui doit me faire revenir vers mon gastroentérologue d’urgence.
J’ai souvent été frustrée car je n’ai de réponses qu’aux questions que je pose et je regrette l’absence d’anticipation de la part du médecin.
Et c’est pour cela que je suis allée chercher des réponses d’abord auprès de l’AFA, association de malades, puis sur internet sur des sites sélectionnés.
Et une information délivrée au bon moment ; sinon, elle ne sert à rien.
Par exemple, au moment du diagnostic, j’étais tellement terrorisée à l’idée que le médecin m’annonce que j’avais un cancer colo rectal que lorsqu’il m’a dit que j’avais une MICI (maladie inflammatoire chronique de l’intestin), j’étais soulagées et ai zappé toute la suite de l’entretien. Et j’imagine que les informations que mon médecin m’a délivrées à ce moment précis de l’entretien étaient importantes mais elles sont toutes passées à la trappe.
De la même manière lorsqu’il m’a annoncé la rechute, j’étais en état de sidération et n’ai rien entendu la suite de l’entretien.
L’exercice est difficile pour le médecin comme pour le patient. Pour une meilleure efficacité de notre relation, j’ai appris à formuler mes attentes et à dire quand je ne suis pas disponible pour entendre. Et lui a appris à me demander si l’information correspondait à mes attentes et si le moment était le plus adapté pour me la délivrer.
• J’attends également une disponibilité réelle du médecin qui s’apprécie en termes de délais de consultation et de temps consacré lors de la consultation.
Parce que les MICI évoluent par poussées et que je ne les prévois pas, j’ai besoin que mon gastroentérologue s’adapte à ma pathologie et accepte de me recevoir dans un délai raisonnable et le cas échéant en urgence.
Pour ma part, je suis suivie en milieu hospitalier et cela m’est arrivé plusieurs fois d’appeler pour prendre un rendez-vous assez urgent. Le plus souvent une solution a été trouvée.
Pour les rares fois où cela n’a pas été possible, j’ai appris que le plus simple est d’aller engorger le service des urgences qui réorientera vers le service de gastroentérologue demandé au départ…
Et ces déambulations inutiles ont généré un stress considérable, une perte de temps et d’énergie considérables et une colère profonde. Sans parler du coût.
Mais la disponibilité s’analyse aussi en termes de temps consacré dans un timing choisi.
L’argument « manque de temps » n’est pas recevable pour un malade. Un entretien écourté laisse le malade frustré, déçu et encore plus angoissé. Le malade est prêt à entendre et même à comprendre les contraintes du médecin, comme celles du lieu d’exercice, notamment l’hôpital. Mais il ne peut pas accepter que les contraintes se cumulent à son au détriment et que la consultation se transforme en « service minimum ».
Soyons réalistes, en dessous d’un certain temps, la consultation ne peut pas être correctement menée et le temps de la consultation ne peut pas être figé mais doit être adapté à l’objet de la consultation.
Alors oui, il y a des consultations qui peuvent ne durer qu’un quart d’heure et qui seront pleinement satisfaisantes pour le patient, mais il y en a d’autres sur lesquelles il n’est pas possible d’économiser.
J’attends et là est sûrement le point le plus sensible, d’avoir une prise en charge humaine et personnalisée.
C’est vrai que ce que le patient attend en premier de son médecin, c’est une compétence médicale et technique irréprochable dans la pathologie qui le concerne. Mais ce qui fait toute la différence, c’est d’avoir dans la relation avec le médecin un espace d’écoute ouvert et sans tabou et de savoir que derrière l’organe malade, le médecin voit la personne dans sa globalité.
Pour ma part, je suis une personne atteinte d’une MICI mais je ne suis pas une MICI. Je suis une femme, une mère de famille, une personne insérée dans un environnement et un contexte socio-professionnel. Alors mon entretien avec mon gastroentérologue ne peut pas se résumer à mon nombre de selles par jour ou à la consistance de mes selles.
J’ai besoin de parler de ce que je ressens en tant que malade, de ce que la maladie est venue contrer dans mon projet de vie, de ses conséquences sur ma famille et ma carrière, de mes angoisses face à son évolution, de mes envies d’envoyer balader tous les traitements … de tout ce qui est autour de mon intestin et qui est au moins aussi important.
Cela ne prend pas nécessairement beaucoup de temps pour le médecin et n’appelle pas nécessairement de solution de sa part mais j’ai absolument besoin de délivrer mon ressenti pour m’alléger.
Et le médecin se doit d’être présent à ce moment là, à la bonne distance.
Je pense à 2 exemples qui m’ont marquée plus que d’autres.
Quand j’ai été hospitalisée en urgence la première fois (plus d’un mois), je ne pensais que très peu à mon Crohn mais j’étais obsédée par le fait que je laissais chez moi, seuls, 2 enfants mineurs pour un temps indéterminé sans avoir pu mettre en place une organisation qui me rassure. Et du coup, mon état de stress est devenu incompatible avec l’amélioration de mon état de santé. C’est seulement à cette constatation que mon médecin est venu vers moi pour me demander l’origine de cette angoisse. Il avait « mis de côté » le fait que je venais de perdre mon conjoint et père de mes enfants. Mais cela faisait partie de moi tout autant que mon intestin malade.
Le second exemple tient à qu’il arrive que le quotidien soit rendu insupportable par la maladie. Je pense spécifiquement aux selles impérieuses qui rendent la vie sociale terriblement difficile, pour les activités de tous les jours très simples comme les transports, les courses… mais aussi compliquent la vie intime. Sur ce dernier point, j’ai un jour ressenti le besoin de dire que la maladie altérait ma vie sexuelle et la réponse a été « pour en revenir à vos selles, y a-t-il du sang ? ». Ma question avait été balayée du revers de la main et déstabilisée, j’ai laissé tomber.
Il n’est pas admissible qu’il y ait des sujets tabous entre le patient et son médecin et qu’il puisse y avoir des fins de non-recevoir aussi brutales sur une démarche personnelle aussi profonde.
• J’attends aussi que le médecin sache quand il ne sait plus
Le malade est capable d’entendre de son médecin qu’il ne sait pas ou plus et la limite de compétence n’est pas source d’angoisse quand elle est reconnue et avouée. Bien au contraire.
Pour illustrer le point, un exemple récent me vient à l’esprit.
J’ai une spondylarthrite ankylosante associée à la maladie de Crohn. Un classique.
A l’apparition des premiers symptômes articulaires, le réflexe a été de consulter mon gastroentérologue. Il m’a dit qu’il allait traiter la douleur et qu’on verrait si les symptômes persistent.
La situation ne s’est pas améliorée et j’ai insisté pour avoir un bilan radio et IRM. Et là, on a constaté les dégâts.
J’ai demandé un second avis auprès d’un service de rhumatologie, dans un autre hôpital, pour m’assurer que l’avis soit libre - à cela aussi, il faut penser… Les 2 avis sont divergents et c’est à moi de trancher.
Exit l’obligation de conseil du médecin et déplacement de la responsabilité de la décision du médecin vers le patient.
Je ne sais pas si on aurait pu faire quelque chose pour éviter l’évolution de la SPA. Mais le problème n’est pas tant là que dans le doute que j’ai sur la perte de chance que la non-reconnaissance par le médecin d’avoir atteint sa limite de compétence a entraînée.
L’enjeu était pourtant de taille, l’évolution de la SPA n’étant pas réversible.
J’ai livré mon expérience personnelle et bien sûr elle n’engage que moi. Mais j’ai l’occasion, dans mon activité de bénévole écoutant au sein de l’Association François Aupetit, d’écouter chaque semaine d’autres malades. Et à travers mon témoignage, bien des patients pourraient se reconnaître.
Enfin, je voudrais rappeler que le patient est un expert de sa maladie et doit être et rester un acteur de sa maladie.
 Notre vie est un château de cartes : ma personne de confiance Notre vie est un château de cartes : ma personne de confiance
Valérie Chmielewski
Ingénieur de recherche et de formation au CNAM, étudiante, master Éthique, science, santé, et société, Espace éthique/AP-HP, université Paris-Sud 11
A Jérôme
Au départ notre vie est un château de cartes qui semblent indestructibles avec cette solidité d’être un être humain égal en droit et en dignité.
Il n'est pas à la portée de tous les médecins d'annoncer un diagnostic défavorable et en même temps de pouvoir entretenir un lien humain qui vous laisse penser que vous êtes encore en pleine possession de cette dignité.
Même si même si la loi n°2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie porte sur les droits il est évident que la réalité s’en éloigne et pas uniquement à cause des médecins même si certains sont en cause (la connaissant à peine), au même titre que je n'exonère pas la responsabilité des scientifiques dans le choix des projets qu'ils développent plus pour asseoir leur carrière alors que ces projets devraient relever d'une problématique sociétale humaine. S'arroger de tels pouvoirs n'est pas acceptable.
Ainsi nous, scientifiques dans les domaines du vivant avons des obligations envers les sociétés les plus défavorisées et les personnes vulnérabilisées par la maladie ou par d’autres accidents de la vie.
Tombée malade le 17 décembre 2004, j’ai connu le temps où tout s’arrête et où la vie bascule.
Notre vie est un château de cartes que le souffle du vent balaye en un instant faisant s ‘envoler l’armure qui nous protège. La perte de confiance est totale, avec ce sentiment mortifère de n’être plus rien.
Mais quelquefois c’est le malade qui s'arroge un pouvoir d'une façon totalitaire en désignant une personne de confiance sans même prendre le temps de lui demander son accord. C'est dire combien la maladie peut vous décentrer de vous-même même si des circonstances l'expliquent. Lorsque dans un espace de deux mois vous vous relevez d'une intervention chirurgicale en urgence, que vous apprenez que vous êtes atteinte d'une maladie génétique vasculaire rare sans traitement et que vous devez faire des choix décisifs quant à la prochaine intervention chirurgicale avec des risques vasculaires majorées, comment ne pas entrevoir le pire (hémorragie, accident vasculaire cérébrale) lorsque vous venez de faire l'expérience du plus improbable scénario ? Je me suis sentie perdue, fragilisée et ceci malgré les meilleurs soins techniques.
Aussi, je voulais exprimer mon soulagement à rédiger des directives anticipées et à avoir pu libérer toutes mes angoisses dans le secret d’un colloque singulier avec un médecin qui n’a pas hésité à sacrifier plus d’une heure de son temps : nous étions loin de la Tarification à l’acte (T2A)!
Dès lors parce que tout se dit de l’essentiel d'un côté et de l'autre, un lien se tisse indestructible.
Notre vie n'est qu'un château de cartes avec cette indicible et incommensurable fragilité.
Les directives anticipées représentent un testament de l'être (et non de l’avoir) c'est-à-dire de l'essentiel oubliant les futilités. A ne pas confondre avec le testament notarié concernant les avoirs dans une société qui a plus de facilité à gérer ses biens et tant de difficultés à gérer le reste.
Trois ans après, parce que les directives anticipées sont révocables et révisables il est nécessaire de les reconduire ou de les repenser, et c'est au cours de la rédaction d'une copie d'examen que cette fois, dictée par la raison et pas seulement par l'intuition, je pouvais analyser le choix de la personne de confiance.
C'est alors qu’en plein examen concernant la décision médicale, mon esprit se perdit dans le labyrinthe « House of cards », la personne de confiance m'apparaissait à l'évidence, toujours le même.
Mes critères de choix ne sont peut-être pas ceux que d'autres choisiraient : j'avais choisi dans un premier temps d'exclure les aimants familiaux parce que je considérais indispensable de ne pas dissocier la compétence médicale et l'assurance du respect de la volonté de la personne afin que les décisions thérapeutiques et de limitation des soins en fin de vie ne soient pas prises de manière arbitraire. La décision de limitation des soins de laquelle peut dépendre la séparation de l'être aimé se fait dans un contexte si douloureux que certains aimants ne peuvent s’y résoudre qu’au prix d'une culpabilité indélébile que je ne souhaite à personne. Pourquoi décider d'une limitation de soins ? Parce que nous ne sommes que de passage sous les débris de notre château de cartes et que cette place occupée en milieu hospitalier sera plus utile à quelqu'un dont les chances sont meilleures. Aussi, au moment où je rédige mes directives anticipées pour la troisième fois, la personne de confiance dans un accord respectif reste toujours la même, même s'il n'est plus mon médecin attitré, j'ai acquis d'autant plus la certitude de ne pas m'être trompée.
Et soudain, mon château de cartes se consolide un peu face aux tempêtes à venir.
À ceux qui se demanderaient à quoi bon choisir un médecin comme personne de confiance lorsqu'on sait que quel que soit le choix thérapeutique il est sous la responsabilité d'un médecin, voici ma réponse.
En partageant avec lui des valeurs éthiques philosophiques qui sont fortes et se rejoignent au même titre que celles que je partage avec certains, il possède la carte maîtresse de mon château de cartes : le respect de ma dignité et le courage et la compétence de s’opposer s’il le juge nécessaire, et celui de transmettre à ceux qui restent la lumière qui a éclairé mon chemin vers une humanité.
Et ce « prendre soin » n’est pas à la portée de tous les médecins, comme j’ai pu en juger.
Mais aujourd'hui si j'accepte non sans peur, l'idée que de vouloir gommer les affects est une illusion dans la relation de soin en fin de vie, c’est parce que deux humanités qui se sont rencontrées poursuivent le chemin de la vie dans une même direction. Aura t-il eu raison du dernier rempart d'une croyance scientifique qui se voudrait totalement objective ?
Il n'est qu'une seule valeur qui consolide mon château de cartes, la carte maîtresse de la dignité dont il est le garant jusqu'au dernier souffle qui fera s'envoler l'édifice.
 Ne jamais abandonner l’espoir que porte un combat Ne jamais abandonner l’espoir que porte un combat
Gabriel Gomis
Juriste, étudiant en master, Espace éthique/AP-HP
Si je pouvais donner l’espérance aux personnes dormantes, assommées par leur maladie, même résoudre ce qui les a arraché au monde habituel, si les mots devenaient magie je ne me lasserais pas de les exprimer. Si je pouvais en ces dates donner l’espoir d´être pour toujours sauvé aux personnes marginalisées par leur condition, soit par la maladie ou l’exclusion sociale, j’en ferais des couplets sans fin pour finir et lire dans leurs yeux le bonheur.
Si je lutte pour quelque chose depuis plus d’un an maintenant afin de ne pas dépendre de remèdes et d’hôpitaux, je voudrais courir pour les aider et non pas végéter. Ils sont transis de froid, d’obscurité ou de désespoir. Je ne veux que personne ne soit condamné parce que sa nature lui a joué des mauvais coups qui ne sauraient contester l’inestimable condition d’être. Les sages, les magistrats, les médecins pourront les guérir ou les juger, les décrire, les classifier, mais rien ne pourra les réduire à un néant déshumanisant.
Si j’arrache à mon être les mots, les paroles, les gestes qui me permettent avec eux de communiquer, rien ne sera éphémère et passager. Si un jour je pouvais donner à la vie tout ce qu’elle m´a offerte, mon bonheur serait à eux, et dans ce bonheur je pourrais me réjouir. Mais je parle au conditionnel, et la condition humaine demeure ainsi à travers le temps.
Un jour je suis bien, l’autre je me perds aux confins d’un univers que dont je ne veux pas qu’il soit le mien ou le leur. Pourtant les choix qui nous sont proposés sont pauvres, restreints. Je comprends que dès la prime révolte il nous faut constamment batailler. La bataille se perd dans l’obscurité et dans l’inexorable durée de la souffrance. C’est à peine si j’ai parfois le courage et la possibilité de continuer, de maintenir l’engagement. Mais tant que des paroles résonneront comme un clairon, mes actions pour encourager l’autre ne sont que l’expression d’une timide bonté. Il faut toujours recommencer, parce que même si la nuit nous submerge en plein jour par sa torride clarté, je sais combien les souffrances de toute sorte ne nous excluent pas de la vie. Elles nous obligent même à la vivre.
L´horreur d’une perspective de dépendance, de sénilité ou de mort, ces batailles confuses du jugement, tout cela n’est que poussière, résidu. Il suffit d’une particule de bonté pour combattre tous ces malheurs qui arrivent toujours et sans exception à l’heure convenue. Suivre les sentiers de la vie, accepter leur cheminement c´est apprendre toujours à perdre mais peut-être aussi à gagner en amour substantiel. J’aimerais, vie, que tu me dises où voyager pour être prophète d’espoir, mais je butte constamment sur des paroles sans pouvoir réaliser ce à quoi j’ai toujours aspiré.
Je vis dans l´ombre de la lumière, car elle me blesse lorsqu’elle me frappe, cette photophobie que mon corps a pour partenaire. Face à tous les malheurs je trouve toujours le refuge d’un recoin de bonheur, si infime et passager soit-il. Ce que l´on vit a un sens pour autant qu’on puisse l’assumer sans être obligé de le taire, le découvrir sans y renoncer. La vie est toujours un combat. Laissons venir l’avenir mais n’abandonnons jamais l’espoir que porte un combat.
Soutenir une conversation dans la chambre d’un mourant, d’un patient en soins intensifs, ou encore parler même dans le vide en ne sachant pas si cet autre nous entend, l’espoir est toujours tentant. Perdu dans la force des jours, nous devons pourtant à l’amitié ce qu’elle nous offre, une présence et un attachement. Les larmes qui coulent sur ces visages torturés par la maladie, une perte, une souffrance ressemblent au labour d’un terrain labouré avant les plantations. Ainsi se renouvelle l’existence dans le don, l’engagement d’une bataille qui peut être perdue sans pour autant anéantir une existence.
Maintenant que tout sommeille, que l’obscurité enveloppe ma nuit, j’égraine le chapelet de mes prières. Ces neuf ans passés dans la précarité m´ont enseigné à aider, car si l´on donne ne pas de soi-même quelque chose périt dans notre être. Et me voilà confronté moi-même à la maladie, à la chirurgie. Plus que tout je lutterai inlassablement en malade et pour les malades. Ils nous transmettent l´espoir et mobilisent nos ressources dans la volonté de préserver la vie.
Dès que j´engage une conversation je me découvre seul et démuni, parce l’autre, en dépit de son exigence, ne peut comprendre ce qu’est notre souffrance. Le monde bruisse de calamités et me voilà inerte, dans la pénombre, ne sachant plus que faire et demandant, quémandant une aide. L’espoir avant tout. Je suis en phase palliative, sachant que cette circonstance ne peut perdurer moralement et durer physiquement. J’ai subi le parcours des médecins spécialistes et aucun n’ose intervenir sur l’opération réalisée précédemment par un autre neurochirurgien. Je me bats de toutes mes forces pour parvenir malgré tout à une issue qui ne soit pas l’acceptation du renoncement.
Je traverse des moments où les maux de tête, invisibles, m’immobilisent. Je cherche en vain les paroles et parfois l’intensité de leur manque m’accable au point de douter de tout. Prostré, je me réfugie dans cette part intime de moi-même à laquelle je ne peux renoncer. Au fil des jours je perds la force de porter la torche du combattant qui braverait la terreur et les assauts de la maladie. Les mots ne se substituent pas toujours aux maux, et la parole se dissipe dans une fiévreuse lumière. Je me découvre face aux combats menés par d’autres malades, j’entends leurs cris de douleur. Je pense à ces malades ravagés, dévastés par la maladie et à l’héroïque patience des gestes de sollicitude témoignés par leurs soignants. Les cauchemars peuplés de leur espoir et de leur force me rendent si proches d’eux, de cet entremêlement de souffrance et de confiance.
Sur mon bureau s’empilent des livres, des images. Un verre d’eau à côté de toutes ces seringues pour antalgique ou antiémétique, ces traces de ce que les jours éprouvants signifient pour moi. Drogues parfois illégales pour atténuer le carnage que j’éprouve en moi.
La maladie est en même temps faiblesse et forteresse. Comment en abattre les murs ? Ils sont chaque fois plus hauts ou me le semblent. Et les proches qui souffrent comme nous, victimes de ces secrets dangers que dissimule la nature. Et les mots, jamais à niveau de ce que l’on souhaiterait qu’ils disent.
J´ai perdu aujourd´hui une amie dévastée par la maladie, jeune, belle, 35 ans. On s´est soutenus l’un et l’autre pendant tout l’été. Mon cœur désespéré a voulu se dissimuler à ce soleil qu´elle ne verra plus, à ses paroles disparues dans une étoile. Je ne pensais pas que j’allais la perdre, alors que pendant de longues semaines nous discutions comme si de rien n’était, en ignorant l’échéance.
Elle est partie et m’a confié son témoignage, je suis le légataire de ces paroles exprimées dans cette incertitude du vivant. Sa maladie a été foudroyante mais elle a su la vivre avec une ténacité indescriptible. Curieusement, le temps de la maladie semble nous rendre une liberté avant de la confisquer définitivement.
Je me révolte, dans un silence respectueux. Maintenant que j’ai observé cette mort, je me rends compte que chaque mort est semblable et différente. Semblable dans sa réalité physique, différente s’agissant de la personne qui en quelque sorte s´échappe par la porte du jour, portant avec elle son histoire, insolite et mystérieuse.
Les mots me pèsent, apaisant toutefois mon esprit souvent trop confus pour exprimer et restituer ce qu’il éprouve.
 haut de page haut de page
 Reconnaître son impuissance et ses limites pour interpeller les autres Reconnaître son impuissance et ses limites pour interpeller les autres
Véronique Vasseur
Médecin, service de médecine interne, CHU Saint-Antoine, AP-HP, membre du Comité d’honneur du Collectif Plus digne la vie
Il était une fois un demi-dieu, médecin génial du nom d’Esculape qui guérissait tout le monde. Plus personne ne mourait et Ades le dieu des enfers se retrouva au chômage. Furieux, il demanda aide à Zeus. Celui-ci foudroya Esculape et Ades eut de nouveau du travail. Et nous voilà, pauvres médecins, fils déchus d'Esculape confrontés quotidiennement à notre incapacité de soigner, de maintenir en vie.
Pour un médecin, accepter l’échec demande une grande humilité et une résignation devant la fatalité de notre pauvre condition de mortel. Attention par exemple au dérapage de l’acharnement thérapeutique qui peut s’apparenter à une torture légale. Quand prend-on la décision d’arrêter un traitement curatif pour passer au palliatif et aider le patient à passer sur l’autre rive le moins violemment possible ? Que doit-on dire au malade ? Peut-on accepter que quelqu’un souffre ?
J’avais été très choquée, à la fin de l’exposé d’un externe sur la carcinose péritonéale, d’entendre comme conclusion qu’il fallait faire accepter sa souffrance au malade. Il exposait le cas d’une patiente souffrant le martyr qui, à plusieurs reprises, avait demandé à être euthanasiée et était en fin de vie. Pas de réaction dans l’assistance médicale. J’ai posé la question de l’acharnement comme torture physique et morale en disant qu’il était intolérable que quelqu’un souffre, même si la morphine devait abréger son agonie. Notre devoir est de soulager à tout prix, a fortiori si le pronostic est sombre à très court terme. Je me suis dit que cet étudiant, qui connaissait parfaitement son sujet, ne ferait pas un bon médecin si on ne lui inculquait pas d’autres valeurs.
Beaucoup de questions et pas de réponses univoques... Nous avons à notre disposition beaucoup de références et de textes législatifs, mais rien ne remplace une décision juste, prise avec toute l’équipe, confrontant les convictions religieuses ou morales de chacun. Ce n’est pas facile, parfois douloureux, mais indispensable.
Nous sommes tous les jours confrontés à la mort et si le médecin a pour vocation de soigner et d’assurer une vie meilleure, il a aussi pour mission la mort la plus douce possible pour son patient. Il doit réfléchir au respect de l’autre et non a sa seule technicité scientifique qui n’a plus ici aucun intérêt.
À cet égard, l’éthique médicale est parfois l'expression d'un refus ou d'une résistance par rapport à une vision technique et peut s'avérer formatrice pour des étudiants au sein d’un CHU. Décider l'arrêt d'un traitement curatif vain et douloureux peut par exemple témoigner du plus grand respect pour la personne mourante. La question permanente reste toujours celle de l’intérêt pour le malade, pas pour le médecin et la science médicale.
Une réflexion commune et au long cours entre médical et paramédical paraît donc indispensable pour maintenir la dynamique d'un service et se poser les bonnes questions au bon moment. Les infirmières, par exemple, qui ont souvent une attitude plus juste et plus humaine car elles sont davantage au contact des malades et ne s'encombrent pas de considérations pseudo scientifiques, devraient faire l'objet d'une véritable écoute.
Devant la déferlante médiatique face à un cas très particulier, le débat — comme toujours — a été relancé sur un mode passionnel et inadéquat et relayé par les politiques qui veulent légiférer. Non, il ne faut pas de loi. Chaque patient est particulier ; il a son histoire, une famille ou pas, qui l’entoure ou l’abandonne. Tous ces paramètres sont individuels et c’est à l’équipe, au patient s’il est conscient et à la famille de prendre la décision la plus juste et la plus humaine.
Elle ne peut être prise par une personne unique, un médecin qui, seul, risque d'être envahi par ce qu'il a lui-même vécu et de ne pas prendre la bonne décision : laisser souffrir et ne pas administrer d’antalgiques car ils peuvent écourter l’agonie ; s’acharner sur un mourant à coup de ponctions, sondages et autres tortures ; plus banalement, ne prendre aucune décision de crainte d’avoir une plainte... exemples qui témoignent de pratiques fréquentes.
Juste et courageuse, la décision est celle d’une équipe capable de laisser de côté ses a priori. Encore faut-il avoir l’humilité de reconnaître son impuissance et ses limites pour interpeller les autres.
En dernière analyse, un texte peut s'avérer précieux pour guider le soignant : le Serment d’Hippocrate qu’il prête solennellement lorsqu’il devient médecin :
- « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques, mentaux, intellectuels et sociaux. » Ce premier alinéa ne pose pas de problème.
- « J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. » Ce deuxième paragraphe est oublié car il est de notre responsabilité de protéger la dignité, de respecter le patient, surtout s'il est en fin de vie.
C'est à ce stade qu’intervient l'institution : pas assez de médecins, pas assez d’infirmières, très peu de psychologues, peu de temps à consacrer au patient ou à sa famille, pas de locaux pour les recevoir dignement dans leur chagrin. Des procédures figées pour annoncer l’aggravation — même si, parfois, la personne est décédée, ce qui paraît vraiment indécent et irrespectueux. Une institution, enfin, qui veut être rentable et demande une maîtrise comptable sur des critères absurdes et inapplicables : comment, par exemple, améliorer la durée moyenne de séjour sur des patients en fin de vie ?
Certaines demandes de soins palliatifs ne sont jamais honorées, les patients finissant par mourir avant d'avoir obtenu une réponse favorable. Les places, en effet, sont rares, ou très loin de la famille qui ne peut plus se rendre au chevet du mourant. Sans compter que l’envoi dans une structure palliative est souvent considéré comme un abandon de la part de la famille et un déracinement pour le patient pour qui des liens se sont tissés avec l’équipe. Est-ce la bonne solution ?
La violence de l’hôpital — le mélange de patients, qu'ils soient jeunes, vieux, en voie de guérison ou en fin de vie — ne reflète-t-elle pas le quotidien de notre existence ? Ne permet-elle pas à la famille de passer ce cap douloureux ? Vie et mort se côtoyant, même avec une insuffisance criante de moyens, n'est-il pas plus facile d’accepter alors l’inacceptable ? La trop grande sollicitude des soins palliatifs ne rend-elle pas le passage à la mort encore plus douloureux car complètement coupé des réalités ?
Regrouper les mourants et leur famille éplorée dans un même lieu ne me paraît pas la meilleure des démarches : naissance, vie et mort devraient davantage encore se côtoyer à l’hôpital.
La réflexion éthique n’est pas une élucubration philosophique pour quelques médecins friant de palabre, mais un code de bonnes pratiques à destination de nos patients, qu’ils soient en voie de guérison ou en fin de vie. Tous les médecins devraient être formés à cette réflexion et aux techniques de soins palliatifs qui, au lieu d'être une spécialité à part, gagneraient à être intégrées dans le cursus des études médicales.
 haut de page haut de page
 Face à la demande des personnes en fin de vie Face à la demande des personnes en fin de vie
Simone Bevan
Ancien cadre infirmier, Unité mobile d'accompagnement et de Soins Palliatifs, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP
On ne m’a pas dit « tuez-moi » mais « aidez-moi à mourir, c'est trop dur, je n'en peux plus »
Cadre infirmier et infirmière clinicienne dans l'Unité mobile de soins palliatifs du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière depuis sa création en 1993, j'ai eu la possibilité d'accompagner un grand nombre de personnes atteintes de maladies graves en fin de vie.
Mes propos vont refléter ici le fruit de mon expérience personnelle. Ils sont issus de situations qui ont été difficiles et douloureuses, tant pour la personne et ses proches que pour les soignants.
La souffrance liée au développement d'une maladie grave peut être vécue comme insupportable, intolérable et susciter une demande d'aide à mourir, que je m'abstiens de nommer demande d'euthanasie car les personnes ne m'ont pas dit « tuez-moi » mais « aidez-moi à mourir, c'est trop dur, je n'en peux plus ». Plutôt que d'euthanasie, c'est de cette souffrance que j'aimerais parler, car elle est si difficile à entendre que nous avons tendance à la nier, ou à vouloir « la faire taire ».
On observe par ailleurs une « usure » des soignants quand cette souffrance n'est plus que plainte répétée, devenant chronique. Mais de quelle souffrance s'agit-il ?
La maladie grave, la fin de la vie, viennent confronter la personne au sens : le sens de la vie passée, le sens de ce présent si douloureux, le sens du temps qui reste à vivre. Ce sens est percuté, bouleversé.
Bien au-delà de la douleur physique accessible, dans la grande majorité des cas, à un traitement médicamenteux, la personne qui comprend la gravité de sa maladie, et qui sent quelle va mourir, livre un combat intérieur fait de peurs, de révolte face à son sentiment d’impuissance, d’angoisse de mourir. En dépit d'un désir parfois énoncé de mourir, c'est bien souvent une lutte pour survivre qui semble plutôt être en jeu. Sommes-nous suffisamment attentifs à cette expression ambivalente de la personne ?
Nous semblons encore méconnaître ce que l'on nomme cheminement, processus de deuil, c'est-à-dire tout ce que la personne va avoir à vivre comme émotions et sentiments souvent douloureux face à l'inéluctable.
Elle vit une succession de pertes comme, pour n'en citer qu'une (parfois la plus dévastatrice), la perte progressive de son autonomie, que ce soit aux plans physique, intellectuel, relationnel, qui porte atteinte à l'image et à l'estime de soi. « Suis-je encore digne d'être aimé ? » peut-elle alors se demander.
Si nous-mêmes, soignants, ne trouvons pas de sens à ce que vit la personne, ne prenons pas conscience que nous sommes face à un phénomène de projection, nous aurons alors du mal à entendre la véritable souffrance exprimée par le malade.
- Oui, ce qu'il vit est si insupportable qu'il imagine que ce serait mieux d'être mort.
- Oui, vivre cette souffrance n'a pas de sens.
Où trouver encore du sens dans ce temps à vivre qui en semble dépourvu ?
La personne soignée nous demande d'entendre cela, sans jugement ni anticipation d'aucune sorte. Elle a besoin de se sentir reconnue et acceptée dans ce qu'elle vit d'insupportable.
Comment supporter ce qui nous apparaît à nous, soignants, comme insupportable, comme dépourvu de sens ?
J'ai souvent été témoin de ces cheminements difficiles et j'ai compris que nous ne pouvions pas toujours apporter un soulagement satisfaisant. Néanmoins, j'ai compris aussi que notre presence, pleine d'attention et de chaleur humaine, signifiant « je ne vous abandonne pas », est une aide que l'on ne mesure pas et dans laquelle la personne, se sentant moins seule face à la question du mourir, va puiser pour trouver « le courage de vivre ».
Cette relation aidante est porteuse de sens quand elle est faite de respect et de considération tels que la personne puisse se sentir encore importante pour quelqu'un et digne jusqu'au bout. Un patient, les yeux souriants et apaisés après plusieurs semaines traversées de révolte, de haine et de chagrin, dit : « je ne savais pas que je pouvais être aimé ».
Où trouver encore du sens dans ce temps à vivre qui en semble dépourvu ?
Il m'a également été donné de voir le résultat d'une longue élaboration de sentiments négatifs (ressentiment, culpabilité, etc), comme une guérison des souffrances du passé. Un « maman, je t'aime », qu'il fût prononcé dans un semi-délire adressé à une mère décédée depuis longtemps ou dans une relation réelle avec la mère, a précédé de quelques jours ce que nous appelons le « lâcher prise ».
J'encourage chacun à se rappeler que cette souffrance existe, et que tout désir exprimé doit être entendu, sans être nécessairement satisfait. Faisons confiance à la personne sans décider de ce qu'il doit en être de sa vie ou de sa mort.
Nous avons à comprendre et accepter que nous ne maîtrisons pas tout et devons venir à bout de nos fantasmes de toute puissance. Accepter que parfois nous n'avons pas d'autre choix que de consentir au fait que nous sommes impuissants face à cette détresse ! Faire appel à notre humilité est tout un « travail » qui atténue bien des sentiments de culpabilité et d'angoisse, comme nos attitudes de fuite, d'évitement ou de déni.
Nous pouvons accepter ce chemin qui est le leur et qui nous touche, pour offrir, jusqu'au dernier moment, dans tout soin, une qualité de présence telle que la personne se sente aimée. Cet amour est la seule réponse.
Une patiente, effroyablement angoissée à l'idée de mourir, mais aussi à l'idée de vivre ce qu’elle appelle « sa déchéance » me dit : « je n'ai jamais été aussi proche du suicide. »
Entendant de la peur, je lui réponds :
— Voudriez-vous que nous vous en protégions ?
— Oui !
— De quoi auriez-vous besoin ?
— Qu'on m'aime !
Pour conclure, accompagner c'est pouvoir offrir, chacun avec son identité professionnelle, une vraie qualité de présence et d'écoute afin que la personne puisse trouver et mobiliser en elle ses propres ressources et vivre sa réalité à sa manière.
Accompagner peut être fatigant. Pour que l'accompagnement ne mène pas à l'épuisement professionnel, il doit se faire en équipe. Dans le souci de trouver une juste distance, un travail sur soi et la participation à un groupe de paroles sont d'autres ressources qui peuvent s'avérer nécessaires.
Enfin, n'oublions jamais que les personnes soignées sont nos meilleurs enseignants.
 haut de page haut de page
 « Le temps des cerises » : l’accompagnement de celui qui va mourir « Le temps des cerises » : l’accompagnement de celui qui va mourir
Agnès Contat
Psychomotricienne, psychothérapeute, Hôpital européen Georges Pompidou, AP-HP
Au-delà du supportable
Dans le service de pneumologie où je pratique, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales et psychologues ont organisé voici quelque temps une journée de réflexion ouverte à tous ceux qui, chaque jour, se posent des questions vitales au sujet du corps malade. Ainsi, nous avons pu aborder, chacun parlant d'où il est, notre pratique, notre vécu de soignant et le vécu, réel ou supposé, du soigné. Corps transparent, corps dégradé, corps mutilé, corps qui se dérobe, corps-souffrance, corps-angoisse, corps du mourir, corps de soignant, corps de malade. Langage des corps...
C'est de tout cela qu'il semblait urgent de débattre, puisque nous avons été si nombreux à parler, à partir de nos multiples rivages, de nos certitudes, de nos techniques, de nos savoir-faire, certes, mais aussi, et ô combien, de nos doutes, de nos questionnements, de nos limites. Personnellement, j'ai tenu à parler d'un jeune homme qui m'a fait comprendre quelque chose que je vais essayer de transmettre ici tant sa requête de « détente » m'a appris une forme de présence à l'accompagnement de celui qui va mourir.
Quand j'ai fait sa connaissance, Monsieur Z, atteint du sida, avait subi déjà plusieurs hospitalisations. Tout son corps était marqué d'humiliantes, de dégradantes, d'irréversibles atteintes. Souffrance, peur, décharnement, désarticulation, ce corps était rendu méconnaissable pour l'autre, l'ami, l'amant, la famille... Méconnaissable pour l'autre, haïssable pour lui-même, inacceptable.
Monsieur Z était en phase dite terminale, même s'il nourrissait cet espoir fou d'un énième retour chez lui, d'un énième rêve de gagner quelques semaines encore, histoire de faire comme si rien n'était plus de l'hosto, de l'agonie, de la mort, histoire de la faire reculer juste encore un peu. Jusqu'à l'été, « à cause des cerises », disait-il.
Ce patient, je le voyais à son chevet, je m'installais près de lui et je l'ai d'abord écouté, de tout mon corps. Parce que c'est cela qu'il voulait : parler. Parler de lui, de son corps, de l'horreur de sa maladie, de son dégoût d'elle. Dire à quelqu'un que cela n'anéantissait pas, cette dégradation avec la mort au bout. Quelqu'un de non pris dans le cercle des intimes, dans le cercle douloureux de la perte imminente. Monsieur Z donnait pourtant à ma « distance » une particularité, puisqu'il me tenait la main en me parlant, et c'est ainsi que j'écoutais. Il savait que je pouvais le masser, faire de la détente et lui offrir quelque répit au corps. Mais Monsieur Z a tenu à me raconter d'abord des choses de sa vie. Pour lui, la détente c'était ça, reprendre des points de son histoire : ses parents, son pays, ses origines, ce livre qu'il avait entrepris d'écrire. Il devenait calme, il savait que la mort était proche, et je crois qu'il aimait vraiment la vie qu'il avait eue.
Peu à peu, au fil de son ultime hospitalisation, les malaises, la faiblesse, cette impression de corps qui fuit, à peine retenu par les perfusions, une série de flacons, relié à la vie par un enchevêtrement de tubulures. Ce corps, certitude d'existence — « je vis donc je suis » —, ce corps l'entraînait chaque jour au-delà de son propre supportable. « Comme il est affreux d'affronter le dégoût de tout soi-même », me disait-il.
Une réconciliation avec son corps
Un jour que Monsieur Z était particulièrement épuisé, découragé, je lui ai proposé de le masser. Je sentais dans mes mains sa peur, sa peur de mourir, certes, mais surtout celle d'abandonner à leur chagrin les siens. Il me semblait que toute sa terreur résidait dans cet adieu à la vie plutôt que dans l'au-delà de la vie. C'est du moins ce qu'il avait tenté de me dire.
Massages, enveloppements, mes mains passent entre tubulures et perfusions... Reprendre souffle, respirer, imaginer des paysages, les revoir, les raconter. Peu à peu, Monsieur Z s'est mis à exiger ces moments-là, il me faisait appeler par l'équipe quand tout devenait trop dur pour lui. Il choisissait ses moments, j'essayais d'y répondre, la mort est bousculante. Un jour Monsieur Z m'a dit cette chose justement qu'il nous faudrait savoir et ressentir, nous qui nous occupons du corps, Il m'a confié : « Je veux ces moments, je veux ce temps pour moi, parce que même si c'est très furtif, c'est pour moi ici, au point où j'en suis, le seul moyen de me rappeler maintenant que mon corps, ce corps-là, m'a rendu très heureux, que j'ai aimé cette vie comme un fou, et, parce que j'étais bien dans mon corps, j'ai pu savourer toutes choses : le soleil, la mer, le désert, la danse, les amis, le clope, les bistros, l'amour... Lorsque vous me tenez la main, lorsque vous me massez, je peux, dans ma tête, me réconcilier avec ce corps qui chaque jour pourtant se décharne et devient laid et gris et taché et incontinent de partout. Dans ces moments de détente j'ai moins peur de ce que je deviens, je peux me souvenir, je peux même encore rêver. »
Ces propos m'ont émue, et je remercie ici Monsieur Z, du fond de mon souvenir, d'avoir donné raison à tous ceux qui donnent ce temps-là, d'un accompagnement « à bras le corps ». Un temps pour entendre et comprendre, un temps pour contenir, un temps pour soulager, un temps pour rêver.
« Un corps, une vie » c'est une histoire jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la vie, jusqu'au bout du corps, et cela jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au dernier soupir, jusqu'au bout du mourir.
Le temps du dernier instant
Tout cela m’a conduite à proposer aux infirmières de prendre un peu de temps pour nous parler. De nous, d'eux les malades, de ceux qui vont guérir, de ceux qui vont mourir... De leur corps, du nôtre... Ainsi nous parlons nous aussi de nos doutes, de nos découragements. Cette parole partagée est encore hésitante, institutionnellement fragile, mais la pertinence des questions, des thèmes abordés et cette confiance aussi entre nous permettent d'entrevoir un petit autrement dans nos pratiques au jour le jour, un meilleur, un moins difficile. Alors peut resurgir cette notion de malade dans son entier, du malade qui est une personne, avec son corps, avec sa tête, avec son histoire.
Absolument, il faut ce temps du dernier instant. Absolument, il faut que l’équipe puisse parler de ce qu’elle vit, de ce qu’elle ressent lors d’un « accompagnement », parce que c’est moins lourd, moins difficile, et que par nos échanges, le malade, porté par nos soins, notre attention, notre parole, vivra sa vie jusqu’à son dernier soupir : lui, cette personne-là, jusqu’au bout, resté digne à lui-même.
 haut de page haut de page
 Condamné à vivre intensément Condamné à vivre intensément
Yvon Sinou
Vice-président, Association pour la Recherche de la Sclérose amyotrophique (www.ars-asso.com), décédé le 3 février 2009
La maladie de Charcot
Agé de 63 ans, marié, père d’une fille et grand-père d’un petit-fils de quatre ans, je suis atteint de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) diagnostiquée en janvier 2003. Me voilà sans jambes ni bras mais j’ai encore le bonheur de parler et de communiquer. La SLA est aussi appelée en France « maladie de Charcot ». Cette appellation est objet de confusions, Charcot ayant décrit et donné son nom à plusieurs maladies neurologiques. Il vaut donc mieux conserver le sigle : SLA.
• Sclérose : tissu dégénéré, cicatriciel ;
• Latérale : car l’influx, à partir de la commande cérébrale, circule par l’intermédiaire d’un faisceau de fibres dites pyramidales. Ce faisceau chemine dans la partie latérale de la moelle épinière. Il se connectera ensuite à un autre neurone situé dans la corne antérieure de celle-ci, afin de permettre la réalisation du mouvement souhaité par la mise en jeu des muscles concernés ;
• Amyotrophique : cette dégénérescence des motoneurones entraîne une fonte musculaire.
La SLA est une grave affection qui se caractérise par une dégénérescence systématisée des cellules nerveuses qui commandent les muscles volontaires ou motoneurones. Elle est toujours évolutive sans pouvoir prédire les territoires prochainement touchés et la vitesse d’évolution.
Je suis atteint de la forme à début périphérique, encore appelée spinale (2/3 des cas) : dans mon cas, ce sont mes membres inférieurs, puis supérieurs qui ont été touchés. En 1997, ma mère a été atteinte d’une forme à début bulbaire (1/3 des cas) se situant au niveau du bulbe et du tronc cérébral. Ce sont, chez elle, des troubles de la déglutition et de la parole qui sont apparus. Ces 2 formes peuvent se succéder ou se développer simultanément. Ses facultés intellectuelles sont restées intactes jusqu’au bout. Cette affection est mortelle, ma mère est décédée en 2000.
Les causes de la maladie sont inconnues à ce jour. On sait que les grands sportifs et les hyperactifs sont plus volontiers touchés. Maintes causes ont été évoquées. Par rétrospection, pendant des mois et des mois, je me plaignais de crampes fréquentes, de grande fatigue comme si je marchais constamment dans l’eau. Il m’est arrivé souvent de tomber en franchissant un trottoir malgré l’ordre conscient émis par mon cerveau sans réponse de mes jambes. Ma maladie sévissait depuis longtemps. Comment en déterminer la cause ?
Mon généraliste attribuait ces symptômes au fait que mon épouse a contracté un cancer en 2000, heureusement enrayé en 2002. Sous les conseils d’amis, j’ai consulté un neurologue qui, le 3 janvier 2003, m’a confirmé que j’étais atteint de la SLA après un électromyogramme, vérifiant la réponse nerveuse après stimulation, ainsi qu’un IRM, conforté par le caractère évolutif de ma maladie. L’image de ma mère m’est apparue instantanément. Le lendemain, j’ai arrêté toute activité professionnelle pour changer de vie.
Parmi la multiplicité des critères médicaux, psychologiques, sociaux, aucun des patients atteints de la SLA ne peut s’identifier à l’autre. C’est par cet isolement dans mon quotidien que j’ai compris que ma maladie sera, avant tout, une terrible aventure commune avec tous ceux qui me sont chers, ceux qui me soignent et aussi avec tous les sujets de la société.
Vivre intensément dans des limites physiques
Ma grande douleur est mon impuissance de ne pouvoir protéger ceux que j’aime des effets de cette grande injustice. Ma sensibilité, harcelée par le doute de chaque instant, a pris conscience de la modalité finale de ma vie quelle que soit l’évolution de ma maladie. Cette maladie avec ses exigences permanentes m’appartient et j’en suis le contour : « La SLA, maladie rare, orpheline encore incurable est la plus fréquente des maladies neurodégénératives après la maladie d’Alzheimer. Elle touche chaque jour 4 nouvelles personnes, 5 000 malades sont dénombrés en France. » Voilà une définition qui est gravée au fond de moi comme un défi. Nous sommes « en froid », mon corps et moi, avec sa façon d’afficher sa maladie pour attirer la compassion et la pitié. Je ne cesse de lui demander un peu plus de dignité. Avec cette façon de vouloir faire l’important qu’il m’impose, je lui réponds par le mépris en lui envoyant une batterie de gens expérimentés pour s’occuper de lui.
Il me reste qu’une seule certitude : je suis condamné à vivre intensément dans les limites physiques de mon enveloppe avec pour référence ces quelques mots : « En excluant la mort de sa vie, on ne vit pas à plein, et en accueillant la mort au cœur de la vie, on s’élargit, et on enrichit sa vie » (Etty Hillesum).
Il est nécessaire de s’adapter en permanence aux besoins qui évoluent, parfois vite. Ceci est un des aspects extrêmement pénibles de la maladie, qui entraîne pour mon entourage découragement, fatigue, dépression et sentiment d’être submergé par la multitude de problèmes administratifs ou d’aménagement de l’habitat.
L'Association pour la Recherche sur la Sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone (ARS) m’a aidé par son écoute, le prêt de matériel et ses conseils. L’Association, grâce à des réunions, m’a permis d’aller vers l’autre et de participer à la cohésion des adhérents par l’identification et la reconnaissance du malade en tant que citoyen.
Comment ne pas adhérer à un défi tel que garantir un réel accès aux droits fondamentaux à toutes les personnes en situation de handicap ? Et pourtant, combien de frustrations irrespectueuses nous subissons, qu’elles soient exprimées par de la pitié, des regards, des non-dits, ou simplement l’accessibilité d’un lieu… Que d’énergie à développer pour que cette notion de dignité envers tous les citoyens soit acceptée. Au sein de cette association, le sens de ma vie me semble tracé car la vie est, avant tout, concrète par ses actes assumés et partagés qu’ils soient physiques ou verbaux.
L’Association est un élan pour construire un lien fort afin que soit le plus heureux possible le meilleur de l’existence des malades. Elle s’occupe non pas du soin car il y a les spécialistes pour cela, mais du « prendre soin ». Quand on m’offre une rose son parfum m’envahit. Ses formes, sa couleur, sont pour moi des réalités. Il m’est facile d’envisager le soyeux de ses pétales grâce à mon vécu. La main amie qui, comme le prolongement de mes pensées, favorise le toucher de cette fleur et devient l’aboutissement renouvelé de mon corps. Cette main est sympathique car elle modifie son comportement pour le plaisir de l’autre. Elle prolonge ma réalité et nourrit mon vécu dans le respect de chacun. Vivre c’est donner, transmettre et recevoir comme un apprentissage permanent. Vivre, c’est avant tout croire que la mort est mon amie comme un missionnaire d’amour et de dignité pour que ceux qui me sont chers puissent mieux vivre, enfin, sereinement.
Donner un sens à notre nouvelle existence
Ma maladie est un phénomène évolutif, irréversible et dégénératif comme si, dans la vie, à partir d’un certain âge, ce processus n’était pas naturel. Actuellement, 50 % des personnes atteintes vivent moins de trois ans après le diagnostic, environ 20 % vivent cinq ans ou plus et plus de 10 % survivent plus de dix ans. La problématique simple et inexorable qu’il nous faut résoudre ensemble, malades, accompagnants et soignants, est le trop long moment d’identification (pouvant aller jusqu’à des années) de la SLA car les médecins généralistes imparfaitement formés se trouvent souvent démunis et que seuls les neurologues spécialisés sont formés pour la diagnostiquer. De même, le moment toujours de l’acceptation du malade de la pathologie et de sa prise en charge par les institutions telles que les MDPH est trop long lui aussi. Il est temps de retrouver une lueur d’espoir pour donner un sens à notre nouvelle existence.
Les mois perdus ont d’autant plus d’importance qu’ils font partie des meilleures phases de la maladie. Après cette prise en charge - qui doit être la plus courte possible - le moment est venu de partager avec tous les accompagnants (famille et médecins) et avec dignité ma fin de vie d’homme communiquant. Mon existence m’apprend à désapprendre pour évoluer vers cette forme « fœtale » où la communication n’est plus possible. Comment peut-on parler de dignité alors que l’essence même, de l’humain est la communication ? : « La notion de dignité humaine signifie que tout homme mérite un respect inconditionnel, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou l'origine ethnique de l'individu en question » (Paul Ricœur).
Le temps de la communication est pour moi ce rapport enrichissant avec l’autre qui engendre spontanément du respect, de la liberté et une ouverture d'esprit. J’ai encore ces longs moments de bonheur où l’espoir réside car je peux encore partager grâce à tous les moyens d’expression possibles. Puis, sans parole ou moyen d’expression, sans pouvoir d’agir et malgré tout désirer, habité d’un monde de représentations lointaines, pour redevenir soumis à l’immédiateté des fonctions de la survie : boire, manger, dormir en vidant mon monde d’humanité.
Je suis un condamné à vivre intensément avec ma liberté intérieure et aussi l’acharnement des chercheurs qui reste un espoir pour mes enfants. Dans cette enveloppe paralysante, je voudrais pénétrer le sens de la vie afin de le clamer et ne plus se donner de peine pour ce qui ne contribue pas à la vie : « La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. C’est avant tout prendre sa vie en main » (Matthieu Ricard).
L'ARS est porteuse, par son action pour la recherche, d’un espoir afin que mon petit-fils ait le bonheur de pouvoir courir avec son petit-fils ou sa petite-fille. Il y a des jours où je suis comme une chaussette qu’on a retroussée machinalement pour être rangée dans l’armoire. J’ai le cœur dehors et le corps en dedans. Pendant ces jours, le sens de ma vie est régi par des valeurs de cœur, d’humanité. Cet amour vers les autres m’enveloppe et me protège de ce corps miné par la maladie. Malgré cette sensibilité à vif, je me sens plus fort. La sérénité s’installe dans mon esprit. Ces instants sont des pas sur le chemin de ma vie, moi l’Immobile.
 haut de page haut de page
 Le polyhandicap nous oblige, nous parents, à devenir des conquérants Le polyhandicap nous oblige, nous parents, à devenir des conquérants
Martine Laurent
Groupe Polyhandicap France
Marie, ma fille, a 17 ans. Elle est polyhandicapée à la suite d’une encéphalite non étiquetée révélée à 12 jours, puis d’un syndrome de West à six mois.
Notre petite famille à peine constituée a basculé d’un coup et sans filet dans le monde du polyhandicap dont nous ignorions tout, mosaïque de solitudes, d’archaïsmes souvent, mais aussi d’humanisme et, parfois, d’âmes exceptionnelles.
La force qu’ a su nous transmettre, par son humanité, le neurologue de l’hôpital qui a si vite pris Marie en charge, nous a d’emblée projetés dans la bataille.
Pour autant, la réalité vous terrasse lorsque vous rentrez seuls à la maison, déconnectés d’un monde hospitalier difficile mais protecteur, avec dans les bras votre enfant tellement abîmée que vous doutez d’être pourvu de cet instinct maternel que vous imaginiez «inné» et «infaillible» et sur lequel vous aviez pensé pouvoir vous appuyer.
Je me souviens parfaitement de ces questions qui me taraudaient sans répit : qu’allons nous faire ensemble ? comment vais-je pouvoir communiquer avec mon enfant ?
Ma prise de conscience progressive qu’il était nécessaire que Marie puisse s’exprimer et agir a pris ses racines dans cet élan puissant qui me tenaillait, d’établir avec elle un lien dont la qualité me semblait le fondement incontournable d’un avenir que je voulais heureux.
Je crois qu’un enfant ne peut pas se construire si personne n’a pour lui le désir qu’il existe pour lui-même. Et il faut du temps lorsqu’on est parent confronté au polyhandicap pour que ce désir émerge, prenne corps et sens.
Je ne me suis donc pas réveillée un beau matin avec l’objectif défini d’aider Marie à développer son autonomie. Le polyhandicap a tellement bouleversé nos ancrages que, pour accompagner notre enfant, nous n’avons pas pu faire l’économie d’élaborer d’abord tout un travail de reconstruction complexe, long, toujours perfectible.
Marie m’a depuis bien longtemps montré que l’essentiel est au creux de chacun d’entre nous. La richesse de ses perceptions, la finesse de sa sensibilité en sont de magnifiques témoins.
A cette époque pourtant, outre le fait de trouver ma place de mère, il a fallu que j’affronte tout de suite les terribles représentations que j’avais du handicap mental, qui me faisaient confondre «capacité d’abstraction» et «conscience». C’est l’obstacle qui fut le plus insidieux je crois et le plus difficile à franchir.
Quelle pouvait être la vie intérieure d’un être aussi démuni, comment allais-je pouvoir aider ma fille à se sentir exister ? Par quels chemins son cerveau allait-il pouvoir lui permettre d’intégrer son environnement ? On me disait que le lobe frontal était touché et je traduisais : Marie ne pourra pas «penser», si Marie ne peut pas penser quel va donc être le sens de son existence ?
Je ne voulais pas être le maître qui tire les fils de la marionnette pour l’animer.
J’avais imaginé bien autre chose… Je ne voulais pas de marionnette.
Nourrir son appétence pour la vie, assurer à Marie une sécurité intérieure la plus solide possible pour que, malgré ses fragilités de toutes natures, elle ait suffisamment de ressources pour accueillir les sollicitations et relations extérieures, a toujours été une préoccupation essentielle.
Pendant des années, j’ai eu le sentiment de m’employer sans relâche à réchauffer une flamme souvent fragile et parfois vacillante.
Il me semblait vital pour elle, que Marie puisse acquérir son autonomie psychique car autant il me paraissait évident qu’il fallait qu’elle puise dans mon désir de mère et dans notre désir de parents des forces de vie solides, autant j’ai vite été consciente que cette alchimie n’avait de sens que pour lui permettre d’exister aussi en dehors de ce lien, faute de quoi, un jour, notre mort (à nous ses parents) signerait aussi la sienne.
Lorsque j’expliquais à une éducatrice ma crainte que Marie n’y parvienne pas, la gentillesse de son discours ne me rassurait pas : je sais bien qu’il faut trouver en soi le désir de vivre.
C’est toute la problématique de notre vie, réactivée à chaque passage important de la vie de Marie.
Mais finalement tous les parents accompagnent leurs enfants sur le chemin de l’autonomie et ce parcours est souvent source de nombreux questionnements.
A ce détail près cependant, que le polyhandicap, situation extrême, majore considérablement la difficulté, pour deux raisons :
- la première, parce que tout au long de la vie vous êtes en permanence confrontés à un décalage de plus en plus important entre l’âge réel de votre enfant et ses capacités effectives ;
- la seconde, parce que l’extrême dépendance de votre enfant vous engage dans une proximité tellement continue et intense, que votre enfant comprend bien que vous lui êtes indispensable pour vivre, et que vous vous trouvez confronté vous-mêmes au fait très concret que, pour tout ce qui concerne sa vie, votre enfant ne peut pas se «débrouiller» sans vous.
Quoi qu’il arrive vous savez que vous êtes et serez le « Garant » de sa sécurité et d’une grande partie de son bonheur.
Vous êtes et serez toujours le dernier rempart.
La société ne nous permet pas vraiment pour l’instant d’envisager les choses autrement.
Alors, dans ce contexte, comment aider cet enfant si dépendant à développer son autonomie (je dis « enfant » en me référant à notre lien de filiation), quelle autonomie et pourquoi ?
Notre vécu n’est pas une succession d’étapes bien séquencées, que nous aurions élaborées l’une après l’autre. Les années décisives de l’enfance de Marie ont été un bouillonnement de maturations, de deuils, d’élaboration de représentations nouvelles.
Parce que pour envisager d‘aider son enfant polyhandicapé à développer son autonomie, aussi modeste soit-elle, il faut à la fois pouvoir :
- stabiliser le socle du lien ;
- se sentir suffisamment confiant dans ses capacités de parent ;
- avoir suffisamment intégré que son enfant a des capacités et qu’il peut les développer ;
- pouvoir penser l’avenir pour nourrir un projet de vie, que l’on réajustera de toute façon naturellement au fil du temps.
Tout s’articule ensemble, tout est lié, tout se fait en même temps.
Cela suppose des soutiens multiples et forts, celui de mes proches aura été et reste déterminant, celui des professionnels aussi est indispensable.
Cela implique également que, si nous avons absolument besoin d’explications précises (je redoutais plus que tout de fonctionner dans l’illusion), nous avons aussi besoin de perspectives. Et l’angle par lequel nous est délivré le/les diagnostic (s) les oriente considérablement.
Dans notre histoire, nous avons eu très vite à supporter un diagnostic de « Cécité corticale », qui ainsi formulé et sans autres explications a télescopé le travail de « reconnaissance » que nous amorcions.
J’ai retenu « Cécité ». Je pensais « ma fille ne me voit pas » et j’avais l’impression qu’un mur nous séparait. Nous étions coupées l’une de l’autre. C’était comme une main que je tendais dans le vide. Marie ne me voyait pas et c’était moi qui avais alors l’impression de ne pas pouvoir l’atteindre. Blessure extrême : je n’en ai jamais connu de plus douloureuse.
Pour que tout change, il a fallu que nous ayons la chance de rencontrer à Bordeaux une orthoptiste exceptionnelle, qui travaille depuis très longtemps en collaboration avec le Professeur Bullinger.
Je me souviens, lorsque j’ai vu le regard de Marie accrocher sans équivoque les damiers noirs et blancs, stimulation particulière à laquelle elle pouvait dans un contexte bien spécifique répondre, du sentiment de ce possible, débordant, vivant. Impression de renaître, de voir enfin la lumière. C’est la représentation même de mon enfant qui a basculé, la représentation de son avenir et de notre avenir commun qui s’est alors transformée.
Pendant de nombreuses années, avec l’appui des compétences de notre extraordinaire guide nous avons tissé encore et encore, inventé, osé, encouragé Marie, beaucoup, autour du visuel et … bien au-delà du visuel.
Elle était si contente de ses réussites
Nous développions notre parentalité et dans le même temps nous aidions Marie à exister.
Cet espace avait je crois, sous une forme différente pour chacun de nous trois, le goût de la liberté.
On ne peut pas aider son enfant polyhandicapé à développer ses capacités d’action et d’expression sans s’inscrire dans une dynamique d’échanges et d’interactions, parce que c’est à travers la relation qu’émerge la proposition de l’un et la réponse (ou l’ébauche de réponse) de l’autre.
Et je suis inquiète lorsque dans une institution on demande aux professionnels un
« détachement » ambigüe, tel qu’il ne permet plus de développer une relation vraie.
Il est bien sûr indispensable de réfléchir aux pourquoi du comment de cette relation d’aide dans laquelle sont engagés les professionnels, mais à trop vouloir se protéger, à ne pas vouloir finalement se risquer à la relation, on peut tout simplement mettre la personne polyhandicapée en danger en passant à côté de son essentiel.
Ce n’est pas le Lien qu’il faut s’évertuer à dénouer. C’est l’authenticité du lien au contraire qu’il faut développer, pour que chacun justement puisse garder Son autonomie, la personne polyhandicapée comme le professionnel. Ce n’est pas de l’Autre dont il faut se détacher, c’est sur soi-même qu’il faut travailler : il n’y a pas d’autres risques dans une relation que ceux de sa propre fragilité.
C’est parce que cette orthoptiste remarquable met ses connaissances et ses compétences scientifiques très pointues au service de l’être, que la rééducation de son regard a permis à Marie d’accéder au monde.
Se préoccuper de l’autonomie de son enfant, c’est aussi, pour les petites et grandes choses de la vie, l’encourager à exprimer ses désirs et ses émotions, lui permettre autant qu’il est possible d’anticiper et de participer, vouloir chercher son approbation ou son désaccord pour lui permettre d’être au cœur de ce qui le concerne.
Lorsque Marie était petite, je rêvais qu’elle puisse me dire non, en particulier lorsque je lui donnais à manger. Il me paraissait essentiel pour elle, qu’elle puisse me signifier avec un code que je puisse comprendre, si elle voulait poursuivre ou s’arrêter.
Et je pensais que si nous trouvions le moyen d’y arriver, ce serait une clef formidable.
Comme il n’était pas question pour Marie à cette époque d’expression orale bien précise, j’ai eu l’idée d’utiliser ce qu’elle savait faire et, pendant les repas, nous avons petit à petit élaboré un code en lui donnant du sens. Marie a dépassé nos espérances, car même si le code oui / non ne fonctionne pas au Centre comme à la maison, même si bien sûr il est aléatoire dans de nombreux domaines, il est devenu dans certains pertinent. Si Marie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’affirmer, en particulier lorsqu’elle est en groupe, elle sait très souvent signifier parfaitement ce qu’elle veut et nous ne nous privons pas, pour ce qui nous concerne, de développer le sujet avec elle.
Aider Marie à développer son autonomie c’est aussi lui donner des repères : par exemple au quotidien lui expliquer le rythme de sa journée, ce qui va se passer tout à l’heure ou demain. C’est lui parler, beaucoup, des évènements de sa vie (l’arthrodèse vertébrale, les déplacements professionnels de son papa et mille autres choses).
C’est, dans un registre plus direct encore, donner du sens aux manipulations de toutes sortes que son polyhandicap nécessite si souvent. J’explique à Marie mes actes, autant que je le peux. Il ne s’agit pas de me parler à moi-même en décrivant par le menu ce que je fais. Non, il s’agit par ce biais de faire participer Marie, pour qu’il y ait de la distance entre mes actes et ses ressentis, pour qu’elle ne subisse pas ce que je suis obligée de lui imposer malgré toutes mes précautions.
L’impliquer, toujours, et lorsqu’il s’agit de son intégrité physique, c’est capital.
Je redis qu’il faut vouloir guider cette autonomie, parce que c’est sous cet angle que le polyhandicap nous oblige à envisager la question.
Les personnes polyhandicapées sont tellement fragilisées, que c’est à nous de nous mettre en disponibilité pour comprendre ce qu’elles veulent nous dire : tel regard, tel geste, tel changement d’expression, pour ensuite pouvoir rebondir sur ce qu’elles expriment et leur permettre d’aller plus loin dans cette expression.
Cela implique d’être attentif à leurs besoins et d’apprendre à décoder les signes qu’elle nous envoient. Le polyhandicap nous invite à développer beaucoup d’empathie et de vigilance. Pour aller droit au but, il faut aller droit au cœur de cette humanité dépouillée que nous accompagnons. Le superflu nous encombre.
Et quand la personne polyhandicapée est trop affaiblie, c’est dans le regard respectueux qu’on porte sur elle que s’inscrit son autonomie d’être humain, à travers les attentions et les préoccupations que nous lui manifestons de son « bien-être ».
S’interroger sur l’autonomie de la personne polyhandicapée qu’on accompagne, c’est aussi souvent s’interroger sur son propre désir.
J’ai dans mon souvenir un épisode difficile autour d’une proposition de gastrostomie. Cette gastrostomie était pour nous le signe même d’une perte d’autonomie que nous n’arrivions pas à envisager. La décision finale nous revenait : elle était très compliquée à prendre.
S’agissait-il vraiment pour nous de préserver cette partie de l’autonomie de Marie ou s’agissait-il de nos propres blocages que nous n’arrivions pas à assumer ? En refusant la gastrostomie que nous percevions comme une entrave, n’étions nous pas en train tout simplement de jouer avec sa vie ? L’autonomie jusqu’où ?
Se questionner permet de garder la distance mentale nécessaire indispensable qui protège Marie et évite finalement, le plus possible, que par glissement nous confondions nos désirs et ses besoins.
Pour Marie comme pour n’importe quel être en devenir, et nous sommes toute notre vie en devenir, chaque pas en appelle un autre, différent. On n’est jamais sûr de pouvoir faire plus, mais on n’apprend pas à marcher si on n’essaie pas de se mettre debout.
Et si le polyhandicap nous recentre toujours sur des ambitions modestes, ce n’est pas la performance qu’il faut viser comme une fin en soi, bien sûr si elle est atteinte c’est formidable, ce qui compte plus encore : c’est la dynamique.
Et pour cela : il faut oser, plus que pour d’autres. Oser lire à Marie des histoires (j’aurais beaucoup à développer). Oser proposer à Marie toute petite, le plaisir de bouger dans un youpala qui lui a permis d’expérimenter des sensations formidables. Oser proposer à Marie de jouer à la poupée. Oser, pendant deux ans, aller voir régulièrement une orthophoniste expérimentée et enfin réussir à convaincre le médecin de rééducation fonctionnelle du Centre de Marie de la laisser intégrer le petit groupe d’expression que l’orthophoniste de ce Centre avait constitué. Ce petit groupe qui s’appelait « Atelier vocalises » fut pour Marie un tremplin formidable.
Cependant, l’autonomie de Marie ne se décline pas comme une accumulation de compétences allant crescendo. Par la force des choses, elle évolue en fonction de l’évolution de sa pathologie.
Marie par exemple ne peut plus se servir comme lorsqu’elle avait dix ans de ses capacités motrices pour intervenir et agir. Par contre son système de communication orale est plus développé.
L’autonomie s’entretient. Marie devra toujours faire beaucoup d’efforts pour gagner sa liberté et ses aidants devront également développer beaucoup de perspicacité pour l’accompagner sur ce chemin et lui permettre de s’adapter.
C’est fondamental, parce que pour être sujet il faut d’une façon ou d’une autre, pouvoir agir sur ce qui nous concerne, que l’on soit polyhandicapé ou non.
Choisir, agir, c’est donner du sens à sa vie et Marie nous montre très bien combien c’est important pour elle. C’est parce qu’on agit qu’on se sent exister, et c’est parce qu’on existe qu’on a envie d’agir.
Se préoccuper de l’autonomie des personnes polyhandicapées, alors même qu’elles sont extrêmement dépendantes, c’est tout simplement se préoccuper de leur dignité d’être humain.
Et reconnaître la plénitude de leur humanité c’est reconnaître les droits qui sont les leurs.
Parce qu’elles ne peuvent pas facilement s’exprimer pour elles-mêmes, il est de notre responsabilité individuelle et collective de faire en sorte que les personnes polyhandicapées ne deviennent jamais « transparentes ».
Lutter, chaque jour, contre cette transparence, parce que tout ce que Marie peut exprimer d’une manière ou d’une autre la pose en tant qu’Etre, et qu’ Etre particulier, parce que sa capacité à signifier à l’Autre est tout simplement indispensable pour qu’elle soit reconnue.
Je ne peux pas parler de l’autonomie de Marie sans parler aussi de la mienne : l’une et autre sont liées.
Mon autonomie malmenée, bousculée, reste toujours à consolider :
- toute ma vie il faudra que je lutte pour ne pas me laisser happer par une situation humaine qui m’oblige à vivre sur le fil du rasoir.
Et comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi que je lutte sans relâche pour desserrer les mailles du filet dans lequel m’emprisonne souvent un système médicosocial déficient, reflet d’une société à la fois prisonnière des ses tabous et obnubilée par le fonctionnement des systèmes qu’elle génère aux dépens des Etres que ces systèmes concernent.
Mon autonomie s’est trouvée engluée dans un magma complexe de sentiments de souffrance, de culpabilité, de réparation, et de contraintes de tous ordres.
Il m’a donc fallu reconstruire « en plein » tout ce qui s’inscrivait « en creux ».
J’ai compris qu’à chaque fois que j’envisageais ma fille d’abord comme un poids, un obstacle à ma liberté, j’employais toute mon énergie uniquement à lutter contre ce poids et que cette Représentation m’aliénait.
C’est en restructurant ma disponibilité mentale, en me situant dans une dynamique d’échanges, que j’ai pu éviter de me laisser envahir. Cela demande de s’ouvrir totalement et implique aussi une certaine forme de rigueur mentale. C’est une clef essentielle pour moi : donner du sens à cet accompagnement, m’inscrire dans le mouvement : pour et avec, en me recentrant sur les questions fondamentales : Qui suis-je vraiment ? Qu’est-ce qui compte pour moi ? Qu’est-ce que j’accepte que le polyhandicap change dans ma vie et pourquoi ?
Pour reconquérir mon autonomie il m’a aussi fallu apprendre à ne pas me perdre dans la douleur de ma fille lorsqu’elle est en souffrance. Ne pas m’abîmer dans une proximité qui, je le sais, pourrait devenir destructrice pour l’une et l’autre.
Apprendre à recueillir cette souffrance, quelle qu’elle soit, et l’apaiser aussi sereinement que je le peux. Accepter mon impuissance parfois et donner à Marie seulement le meilleur de moi-même, pour qu’elle puisse se battre en utilisant ses propres forces de vie.
Le respect toujours de cet être qui vient de ma chair, mais n’est pas moi.
Notre autonomie nous appartient et si c’est bien à nous de la mettre en œuvre et d’arriver à retrouver le chemin de notre liberté intérieure, je ne crois pas que cela soit possible sans étayage, sans guide, sans soutien.
Etre autonome c’est aussi pouvoir s’ assumer économiquement. C’est également pouvoir s’inscrire dans la vie sociale, sans être acculé, lorsqu’ on est en couple, à devoir empiéter sur l’autonomie de l’autre pour développer la sienne.
L’autonomie c’est un Tout, dont les composantes interagissent les unes avec les autres.
Aujourd’hui, mon autonomie, notre autonomie est malgré tout, limitée.
Notre société a bien du mal à changer de regard et à comprendre que nous ne sommes ni coupables, ni débiteurs d’aucune dette.
Oublier les personnes polyhandicapées du champ de la solidarité, c’est du même coup condamner leurs familles à une inexistence sociale inacceptable.
Construire des établissements adaptés suffisants en nombre, développer des formules d’accueil temporaire souples et des services à la personnes ponctuels de proximité, développer les réseaux, les centres ressources : c’est indispensable, mais pas encore suffisant.
Rien n’est plus dévastateur pour ma propre existence que lorsque je suis confrontée au dilemme terrible de ne pouvoir envisager mon autonomie qu’en sacrifiant la dignité de Marie.
Comment puis-je devenir autonome si je sais que l’accompagnement des personnes polyhandicapées ne s’inscrit pas dans une dimension éthique forte? C’est un écartèlement insoutenable : pallier aux carences du système pour protéger ma fille, aux dépens de mon autonomie, ou privilégier mon autonomie aux dépens de ma fille. L’autonomie à quel prix ?
Malgré de très lourdes séquelles et une très grande dépendance, Marie je crois sait qui elle est, sans se confondre avec ceux qui l’entourent, établissant avec les uns et les autres un degré de relation différent.
C’est une belle victoire je trouve qu’elle a su remporter.
C’est dans le présent que s’écrit l’avenir et j’espère que Marie aura encore de belles pages à rédiger.
J’avais imaginé bien sûr partir après elle et pouvoir toujours l’aider à conquérir sa liberté.
« Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé » dit le Petit Prince, et j’ai beaucoup apprivoisé ma rose.
Je me suis souvent accroché au fantasme que peut-être nous pourrions partir ensemble, mais en réalité je refuse que de notre lutte il ne reste plus rien que le néant d’une terre brûlée.
Plus encore que des combattants, le polyhandicap nous oblige, nous parents, à devenir des conquérants et, de toutes les victoires que nous devons remporter, celle de l’autonomie, pour notre enfant et pour nous-mêmes, est essentielle.
 haut de page haut de page
 Le handicapé révolté Le handicapé révolté
Philippe Être
Photographe retraité
Ma grand mère disait « c'est une drôle de chose que la vie ». En effet, si je prends comme exemple l'affaire Vincent Humbert, ce jeune pompier qui était en pleine forme et qui en une seconde est passé à l’état de handicapé profond.
D'ailleurs pourquoi vit-on ? Et s'il y a un créateur, que fait-il d'ailleurs?
Il y a un prêtre qui m'a dit : « Si vous ne priez pas, Dieu va vous punir. » Merci, c'est déjà fait ! Mais je crois qu'il n'y a aucune réponse à ce jour.
Comme dirait l'autre, j'attends de voir…
Pour moi ma vie reste un mystère. Né en 1941 pendant la guerre, enfant prématuré je ne devais pas vivre et étais classé comme incurable par l’hospice de Bicêtre…
Dans mon enfance et après avoir suivi une scolarité assez difficile, j’ai fait un apprentissage de quatre ans au studio STA photo comme apprenti photographe. Cinq ans après j’ai obtenu mon brevet de maîtrise de photographie avec mention bien et une médaille qui doit rouiller tranquillement dans un tiroir.
Ceci m'a donné la possibilité d'être photographe au CHU Bicêtre pendant trente-sept ans, dans le même bâtiment où j'avais entendu que j'étais incurable !
En bref, un éducateur m'avait dit : « Tu as du harceler du monde pour en arriver à une situation extraordinaire… »
J'ai fait partie du jury du CAP photo pendant dix-huit ans. Aujourd'hui je considère l'Assistance Publique comme ma mère adoptive, même si tout n'est pas parfait.
Il est parfois difficile de tenir debout avec les difficultés de la vie, avec parfois certaines réflexions ou des actes surprenants qui finalement vous énervent. Si on y réfléchit on en rigole bien, sinon on risque de le prendre très mal.
Il me reste toujours des souvenirs. L’événement le plus marquant c'est un médecin traitant dans le privé qui me connaissait et m’a dit : « vous êtes un malade mental. » Je lui ai répondu « sans blagues, qui vous a donné votre diplôme ? » Pour toute réponse il m’a frappe de quatre coups de poing sur le visage… A peu près à la même époque, j'ai eu l'occasion de photographier des rats qu'un médecin tuait en les fracassant contre les murs. Il y a douze ans environ.
Le handicap fait peur et j'en ai eu la preuve. Voici quelques remarques qui m’amusent après réflexion. Souvent on me prend pour un grand alcoolique. Avec mon déséquilibre plus mon défaut d'élocution, mon compte est bon…
Un jour, je quitte mon travail et prends le bus pour rentrer chez moi. Une brave dame qui se croyait supérieure à tout le monde me dit : « vous ne tenez même pas debout, vous êtes malade… » Elle insistait tellement que j'ai répondu : « je viens de m'échapper de l'hôpital de Bicêtre et je suis recherché… » En effet je venais de quitter mon laboratoire photo !
Anne Frank n’affirmait-elle pas dans son Journal : « L’homme reste bon » ?
 haut de page haut de page
 Questionnement sur la vulnérabilité des personnes polyhandicapées et de leurs accompagnateurs Questionnement sur la vulnérabilité des personnes polyhandicapées et de leurs accompagnateurs
Laurence Deseigne
Administrateur du Groupe polyhandicap France
Informaticienne dans une autre vie, je suis aujourd’hui administrateur du GPF, membre de la CDAPH de la MDPH du Loiret, de la CDCPH du Loiret, Présidente de l’ASSEPH qui gère Le LEVAIN, EPEAP comprenant un accueil de jour, un SSAD et un internat temporaire à Orléans. Cette reconversion n’est pas le fruit du hasard et si je suis ici aujourd’hui, c’est parce qu’un météore est venu exploser ma vie il y a 15 ans. Mon météore personnel s’appelle Alexandre et il est polyhandicapé.
J’ai été amenée, à la demande du GPF et de l’Espace éthique/AP-HP, à m’interroger sur les facteurs susceptibles d’aggraver la vulnérabilité des personnes polyhandicapées et de leurs accompagnants. J’ai bâti cette intervention en essayant d’avoir une vision globale de la vie d’un enfant polyhandicapé et de tous les acteurs l’accompagnant. J’en ai dégagé 3 volets : la vie familiale, la vie en établissement, les relations avec les soignants.
La vie familiale
Une fois passé le cap de l’annonce du handicap, la famille et l’enfant sont dans une phase de vulnérabilité extrême due à la violence engendrée par l’arrivée du handicap dans leur vie. Mais quels facteurs sont-ils susceptible d’aggraver ou d’atténuer cette vulnérabilité ?
- La prise en charge précoce permet-elle réellement de limiter les risques d’aggravation des troubles physiques de l’enfant polyhandicapé (rétractation, luxation de hanches, etc.) ?
- A contrario, le manque de prise en charge précoce, et donc de soins préventifs, induit-il une augmentation des troubles physiques de l’enfant ?
- Existe-t-il des études faites au sein du secteur hospitalier établissant des corrélations entre les interventions orthopédiques de l’enfant polyhandicapé, l’âge de ces enfants et le type d’accompagnement dont-ils ont bénéficié depuis leur naissance? Si non, ne pensez-vous pas que de telles données pourraient être intéressantes à exploiter?
- Constate-t-on plus d’apparition de sur-handicaps (psychose, trouble du comportement, etc.) chez les enfants suivis précocement que chez les autres ?
- Quel est le risque d’une séparation précoce entre l’enfant et sa famille ? N’entraine-t-elle pas des troubles d’ordre psychologique chez l’enfant ? N’y a-t-il pas un risque de rupture entre l’enfant et sa famille ?
- Le manque de formation et ou d’information des parents n’induit-il pas un risque d’infantilisation de l’enfant ? Voire même un risque de maltraitance ?
- Comment pallier à l’épuisement familial ? Cet épuisement ne fait-il pas courir un grand risque à l’enfant et à l’ensemble de la cellule familiale ?
- Comment aider l’enfant à garder une place d’enfant ? puis à le laisser grandir ? Comment accepter de le voir comme un adulte ?
- Comment aider les parents après la naissance d’un enfant polyhandicapé à envisager l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille ?
- Comment aider les frères et sœurs à se construire malgré les contraintes engendrées pour l’ensemble de la famille par leur frère ou sœur polyhandicapé ?
La vie en établissement ou la vie avec l’établissement médico-social
Lorsque la famille fait le choix de confier son enfant à un établissement spécialisé, là aussi, la situation elle-même met toute la famille en position de vulnérabilité extrême.
Le manque de places en structures spécialisées et donc de choix pour la famille ne fait qu’empirer la situation.
Il me semble indispensable de travailler sur les points suivant afin que l’entrée puis la vie en établissement puisse se faire sans aggraver la situation des personnes polyhandicapées et, par ricochet, celle de leur famille ainsi que celle des professionnels travaillant dans ces structures.
- Comment aider les familles à faire confiance à un établissement ?
- Quelles stratégies mettre en place pour éviter le sentiment des familles, parfois justifié, d’être « dépossédées » de leur enfant ?
- Comment aider les familles à partager leur rôle d’éducateur ?
- Comment aider les familles à faire un choix réel entre domicile et établissement ? Ce choix réel existe-t-il au vu de l’offre d’aide à domicile? - L’arrivée des services marchands dans notre secteur a-t-elle été bénéfique à la situation des personnes polyhandicapées à domicile? Le développement des SAMSAH, des SSIAD et de places d’externat et d’internat temporaire dans les structures ne pourrait-il pas permettre un chois de vie réel aux personnes polyhandicapées et à leurs familles?
Relations avec les soignants
Les relations entre les soignants, les personnes polyhandicapées et les familles, notamment en milieu hospitalier, ne sont pas toujours simples à gérer. Le climat devient parfois houleux et cette situation n’est confortable pour personne. Avec beaucoup de temps et de recul me sont venues en tête ces quelques questions qui pourraient peut-être en partie expliquer ces tensions qui nous rendent tous si vulnérables :
- Comment accepter que de simples parents puissent en savoir plus sur leur enfant que des soignants diplômés ?
- Comment accepter de voir des parents poser des gestes de haute technicité sur leur propre enfant ?
- Comment être soignant face à un enfant non guérissable et même pas malade? Ou éducateur face à un enfant réputé jusque là inéducable ?
Une fois arrivée au terme de cette réflexion c’est alors imposée à moi une question : si la vulnérabilité physique de l’enfant polyhandicapé est incontestable, qu’en est-il de sa vulnérabilité psychique ?
En effet, à vivre depuis plus de 15 ans en compagnie des enfants polyhandicapés, ils continuent à me surprendre au quotidien et je ne peux m’expliquer ceci :
- Comment expliquer que ces enfants si fragiles, si vulnérables, auxquels nous imposons tant de douleurs aient en eux une telle force de vie ?
- Comment expliquer leur joie de vivre, leurs éclats de rire lorsque leur corps leur laisse quelque répit ?
- Comment expliquer la mort de l’enfant ou de l’adulte polyhandicapé dans une période où « tout va bien », où il est au mieux de ses capacités ?
- Ce qui me fait poser une dernière question : serait-il possible de parler de résilience de l’enfant ou de l’adulte polyhandicapé ?
En conclusion, de mon expérience de maman d’un ado de 15 ans polyhandicapé, j’aurai envie de partager ceci avec vous : si la vulnérabilité physique de mon fils est indéniable et inéluctable, je ne suis en aucun cas convaincu qu’il en soit de même de sa vulnérabilité psychique.
Quant à ma propre vulnérabilité, bien sur qu’en certaines occasions elle a été extrême et elle le sera sans doute encore certainement, nos deux vulnérabilités étant intrinsèquement liées. Bien sur, qu’il suffit parfois d’un geste, d’un regard ou d’une parole maladroite pour la réactiver mais, curieusement, ces 15 ans de vie commune avec un enfant polyhandicapé m’ont permis de comprendre que s’il était ma plus grosse faiblesse il était également ma force et ma richesse, mon étoile personnelle en somme!
 haut de page haut de page
|